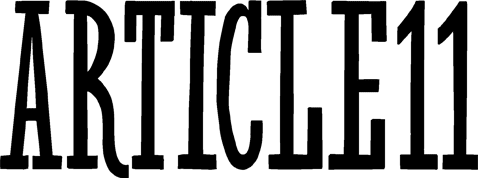L’activiste américain Phil A. Neel a participé aux émeutes qui ont agité Seattle le 1er mai 2012. Il l’a d’ailleurs payé au prix (juridique) fort. Dans ce texte récent, traduit de l’américain par nos soins, il revient sur sa conception de l’insurrection.
Ce texte a été publié dans le numéro 19 d’Article11. Il a notamment été publié en anglais, sous le titre « Why Riot », dans le douzième numéro de Fire To The Prison, très bon canard insurrectionnaliste américain. Il est ici traduit dans une forme condensée. Pour les anglophiles, le texte original, qui développe plus amplement certains aspects, est à lire ICI.
Le 1er mai 2012, de quatre à cinq cents personnes ont participé à la plus importante émeute que Seattle ait connue cette dernière décennie. Des centaines de milliers de dollars de biens privés sont partis en fumée, l’état d’urgence a été décrété, et les Unes des journaux du lendemain ont évoqué d’horribles histoires d’anarchistes « étrangers à la ville » se comportant comme des fous furieux.
Cet épisode a été utilisé pour renforcer à tous les niveaux (fédéral, régional et municipal) les investigations, les opérations de surveillance et la répression ciblant les dissidents politiques. Plusieurs anarchistes de la côte Ouest ont été incarcérés, avant d’être relâchés des mois plus tard sans qu’aucune charge n’ait été retenue contre eux. Leurs maisons ont été fouillées à la recherche de livres anarchistes ou de sweats noirs à capuche. Plus d’un an après, ces activistes étaient toujours sous surveillance policière.
Je suis l’une des cinq personnes initialement inculpées pour crime suite au 1er mai 2012. Pour alléger les charges à mon encontre, j’ai plaidé coupable lors de mon procès, qui s’est tenu à la fin de l’année 2013. J’ai finalement écopé d’une peine de trois mois au King County’s Work-Education Release Unit (WER). Il s’agit en théorie d’une « alternative à l’emprisonnement ». Mais dépendre de la WER signifie en réalité être emprisonné tout le temps où tu n’es pas au travail, à l’école ou en traitement (psy ou médical).
Je suis l’un des deux seuls inculpés à avoir plaidé coupable de certains délits commis le 1er mai 2012, notamment la participation à une émeute. Si bien qu’aujourd’hui, je peux évoquer – et défendre - l’intérêt stratégique de la révolte, ou la nécessité d’une étincelle émeutière pour la déclencher, sans courir les mêmes risques juridiques que des personnes qui n’auraient pas été jugées.
Je ne prétends nullement parler au nom de groupes engagés dans la révolte du 1er mai 2012. À ma connaissance, l’émeute n’avait pas été planifiée en amont, et la marche anti-capitaliste dont elle est partie, liée à Occupy Seattle, s’inscrivait dans le cadre d’une manifestation publique. Je n’entends pas non plus parler de cette seule émeute, mais des émeutes en tant que telles.
J’écris en fait ce texte pour une raison simple : il s’agit de défendre l’émeute comme tactique générale, et non d’expliquer pourquoi untel ou unetelle a pu y participer. Je ne compte pas justifier les vitrines brisées, la destruction de biens, et certainement pas le spectacle médiatique généré, mais l’émeute elle-même – ce mot dangereux, qui effraye tant la société et lui semble si déplaisant qu’elle la voit comme purement irrationnelle.
Nous vivons une nouvelle ère de révoltes. Leur nombre a considérablement augmenté ces vingt dernières années. Elles sont notre futur immédiat, lequel n’épargnera pas plus Seattle qu’Athènes, Londres, Guangzhou ou Le Caire.
*
J’appartiens à la génération la plus pauvre depuis la Grande Dépression. Je suis né au moment où l’histoire finissait1. J’ai assisté à la croissance extatique des années Clinton, puis au retour à la stagflation sous Bush et Obama.
Les membres de ma génération n’ont aucun espoir de vivre mieux que leurs parents. Nous avons hérité d’une économie stagnante, d’un environnement au bord de l’effondrement, d’un système politique créé par et pour les riches, et d’une culture atomisée par une consommation délirante.
Nous sommes aussi ceux qui avons été frappés le plus durement par la récente crise économique. Selon une étude menée par le Pew Research Center, le revenu net médian des moins de 35 ans a chuté de 55 % entre 2005 et 2009, quand celui des plus de 65 ans n’a baissé que de 6 %. L’inégalité sociale est désormais massivement générationnelle.
En dépit de ce que veulent faire croire ceux qui évoquent notre fainéantise et nos privilèges, ce différentiel n’est pas dû à un manque d’effort ou d’éducation. Les Américains blancs d’un certain âge ont simplement bénéficié d’un heureux concours de circonstances. Ils ont grandi dans une période de logement et d’éducation à bas coût, d’État-providence généralisé et de croissance économique sans précédent, laquelle s’inscrivait dans le cycle de destruction créatrice initiée par les deux guerres mondiales et par la dépression.
Mais leurs emplois ne nous ont pas été transmis, à la différence de leur dette. Quand aujourd’hui ces gens partent en retraite, leurs successeurs ne bénéficient pas des mêmes conditions qu’eux, ni même d’un revenu suffisant pour subsister. La totalité des emplois créés depuis la « reprise » ne sont en fait que des boulots à bas salaires, temporaires ou très précaires, qui représentent la seule alternative au chômage.
Cette restructuration économique a également provoqué une concentration spatiale de l’activité économique aux États-Unis. Certaines zones métropolitaines ont tiré leur épingle du jeu en se transformant en plate-formes pour des systèmes logistiques globaux, fusionnant industries high-tech et services aux fabricants. Quelques-unes sont mêmes devenues des « joyaux » urbains, en concentrant le « capital culturel » et en redessinant leurs cœurs de villes (nettoyés des populations « indésirables ») afin d’attirer les touristes et dignitaires étrangers.
À l’inverse, de larges pans du pays ont été tout simplement laissés en friche. L’économie informelle s’y est largement développée – s’alignant sur une tendance générale, plus visible, celle de la croissance mondiale des bidonvilles.
*
Je suis originaire de l’une de ces friches. L’essentiel du travail disponible y est informel ; et quand il ne l’est pas, il s’agit d’industries polluantes. Quant aux taux de pauvreté, de chômage, de maladies chroniques, d’illettrisme et de maladies mentales, ils y sont souvent deux ou trois fois supérieurs à la moyenne nationale. J’ai été élevé dans un mobile-home stationné en plein cœur de l’un des plus pauvres comtés de la côte Ouest. Si bien que ces changements structurels ne sont pas pour moi des abstractions académiques, mais une réalité bien palpable. Je viens de cette partie de l’Amérique – sa plus grande part – où la marijuana est la plus rentable des cultures et où les ados engloutissent du Special K2 comme si c’était des céréales. L’unique revitalisation qu’il m’ait été donnée de voir concernait une entreprise abandonnée reconvertie en meth lab3.
J’ai été l’une des rares personnes de mon milieu à pouvoir étudier suffisamment pour me payer un ticket de sortie. Mais dès mon arrivée à Seattle, et malgré mon diplôme, je n’ai eu droit qu’au pire du marché du travail. Plutôt qu’un membre de la jeunesse péri-urbaine utilisant Seattle comme « terrain de jeu » (ainsi que les commentateurs ont qualifié les émeutiers), j’étais en réalité l’un de ces nombreux travailleurs invisibles dont la ville dépend – qu’il s’agisse de décharger des marchandises sur les quais, de travailler dans les entrepôts au Sud du comté, de nettoyer les immenses immeubles de bureaux du centre-ville ou (dans mon cas) de trimer dans une arrière-cuisine.
À l’époque des émeutes, je travaillais pour dix cents de plus que le revenu minimum dans une cuisine industrielle du Sud de Seattle, où nous produisions des milliers de sandwichs pré-emballés et des salades à destination des cafés haut de gamme du centre-ville et des immeubles de bureaux. Il est probable que les commentateurs hystériques de Kiro-TV, ceux-là même qui affirmaient que des « bandes de l’extérieur » avaient surgi du cœur du chaos pour retourner Seattle, mangeaient régulièrement la nourriture que j’étais misérablement payé à préparer.
Malgré ses prétentions post-industrielles, Seattle, comme d’autres villes globales, s’appuie sur ce qu’on appelle la dualité du marché du travail. L’étage supérieur – travail qualifié, production culturelle, finance et services – en surplombe un autre, sinistré – travail payé au salaire minimum, turn-over élevé et infimes chances de promotion.
Cela crée un problème spatial fondamental propre au capitalisme : malgré l’externalisation des métiers les plus dangereux de l’industrie et de l’extraction des ressources, les riches ne peuvent jamais entièrement se séparer des pauvres. Diverses méthodes de gestion de ces derniers ont donc pour fonction de garantir la coexistence : l’extension de la surveillance, de l’incarcération et de la déportation, la militarisation de la police, le soft power anesthésiant des fondations philanthropiques, la justice sociale des ONG, l’action des syndicats conservateurs et de divers autres proxénètes de la misère. La révolte est ce qui advient quand toutes ces médiations échouent. Dans une période de crise et d’austérité, c’est souvent le cas.
Afin de dissimuler l’objet de la révolte à ceux qui n’en étaient pas, les médias nous ont dépeint comme extérieurs à la ville et ont continuellement déformé les faits. Il s’agissait de masquer un fait évident : les casseurs du palais sont en réalité ses serviteurs.
*
Les médias ont donc cherché à départager les « bons » et les « mauvais » manifestants. Les émeutiers auraient d’une manière ou d’une autre « infiltré » la marche. Ils auraient détourné des « vrais » problèmes et éloigné les personnes « normales », mettant ainsi à mal les tentatives de réforme déjà en cours.
L’hebdomadaire local The Stranger a ainsi opposé les arrestations (négociées) des grévistes des fast-foods à celles des émeutiers du 1er mai – fainéants « dissimulés derrière des bandanas et lançant des pierres ». Ironie du sort, j’étais émeutier et travailleur dans la restauration rapide. J’ai d’ailleurs mené un débrayage sur mon lieu de travail lors de la première grève des fast-foods. Et j’ai même occupé deux semaines un poste rémunéré au syndicat Working Washington.
Mais lorsque j’étais engagé dans cette grève, c’était d’abord en tant que salarié de fast-food, et l’objectif à court terme était d’instaurer un rapport de force au profit des travailleurs de la restauration rapide de la ville. Ce combat ne visait pas le cœur du problème. Et il revenait au fond à essayer de faire un pas en avant au cours d’une avalanche – ça ne sert à rien si le sol lui-même vous emporte dans l’autre sens.
*
L’économie n’est rien d’autre qu’une prise d’otages, dans laquelle la majorité de la population est violemment asservie par une petite minorité. Dès que l’accumulation du profit est remise en cause, que ce soit par des facteurs contingents (par exemple, la pauvreté d’une zone géographique) ou intentionnels (comme la résistance d’une population), ceux qui détiennent le pouvoir (les plus riches) commencent à tuer les otages.
C’est précisément ce qui est advenu au cours de la restructuration économique des cinquante dernières années. Certaines régions qui résistaient à la baisse des salaires, au démantèlement des services sociaux, à l’exportation ou à la mécanisation des emplois et à la privatisation des services publics ont été littéralement sacrifiées. Le paysage américain contemporain se trouve ainsi jonché de cadavres : Détroit et Flint (Michigan), Camden (New-Jersey), Athens (Ohio), Jackson (Mississippi), les villes minières de l’Ouest de la Virginie et le Nord du Nevada.
Une poignée de villes (comme New York ou Seattle) ont échappé à ce destin. Elles se targuent aujourd’hui d’être de bons otages. Mais elles n’ont dû leur survie qu’à ce jeu truqué de la roulette néolibérale, qui s’appuie sur la fortune géographique (il s’agit souvent de villes portuaires et de centres financiers déjà existants) et sur l’acceptation de tous les desiderata des riches. En l’espèce : services publics bradés au détail, cœurs des centres-villes redessinés selon les lubies d’intérêts privés, secteurs de la finance et de l’immobilier partagés entre les gros joueurs comme Nordstrom4 ou Boeing.
À l’échelle globale, il est indéniable que le système économique existant – que nous appelons capitalisme – est un échec. Pour illustrations, ces trois constats : l’esclavage augmente considérablement dans le monde ; la mécanisation pousse une quantité massive de travailleurs hors du processus de production ; et le rôle central de la finance et de la spéculation dans l’économie globale entraîne des pics massifs des prix de l’alimentation, causant des famines et des émeutes de la faim.
Dans le même temps, la production de biens de première nécessité ne cesse de se concentrer – que ce soit entre les mains des entreprises de services des métropoles aux PIB élevés (comme Londres, New York et Tokyo) ou dans cet « atelier du monde » que constitue le Sud-Est asiatique. Non seulement ce marché est dominé par de grands intermédiaires à bas salaires comme Walmart5 et Amazon, mais il dépend aussi de plus en plus souvent des contrats signés avec des industriels comme Foxconn ou Yue Tuen, qui concentrent leur production dans les zones où la vie des travailleurs migrants peut être surveillée et gérée de façon quasi-militaire.
La concentration des processus de production coïncide avec l’accumulation de richesse qu’elle génère. Même dans « la vieille Europe », la pauvreté et le chômage augmentaient bien avant que n’éclate la récente crise. Les cas de la Grèce et de l’Espagne en constituent un bon exemple. Aux États-Unis, la pauvreté et le chômage s’inscrivent en outre dans un contexte de ségrégation raciale des villes. La croissance du système pénitentiaire, devenu l’un des plus importants au monde, a notamment permis ce retour de la ségrégation. Les États-Unis emprisonnent aujourd’hui à peu près la même proportion de leur population que l’URSS au plus fort du Goulag.
Chaque crise fait plus de dégâts que la précédente, et cela ne tient pas seulement aux « cycles économiques ». Ou alors, ces derniers se résument à des sinusoïdes tendant à un déclin total. Et cet effondrement du système économique ne se conjurera que par un processus de destruction créatrice d’une ampleur inégalée.
Face à la catastrophe environnementale, à l’extrême instabilité de l’économie et à la flambée générale des inégalités, il est simplement utopique de croire que le système actuel peut se perpétuer indéfiniment sans générer de violences. Il est désormais temps d’inscrire dans les actes notre opposition au capitalisme.
Ma génération n’est pas seulement née dans l’extatique « fin de l’histoire » des années 1990. Elle est aussi la génération globale – qu’il s’agisse de la jeunesse des bidonvilles ou des diplômés déclassés – qui a provoqué les premiers soubresauts de la renaissance de l’histoire. Et cette dernière a pris le visage d’un émeutier à capuche. La transformation des révoltes de masse classiques en occupations de lieux symboliques a mené à de nouvelles formes de révoltes et, finalement, à la première insurrection majeure du XXIe siècle dans le monde arabe.
La révolte s’affirme déterminante quand elle ne cherche pas à faire triompher des revendications devant lesquelles les progressifs peuvent s’extasier, mais prend une forme sans revendication. Ce qui implique deux choses. Tout d’abord, le rejet des médiations existantes. Pas question de voter pour des partis fondamentalement corrompus ou de jouer le jeu vicié du militantisme. Même s’il peut être important de lutter pour certaines revendications, comme une augmentation de la rémunération horaire, ces réformes par et pour elles-mêmes ne contribuent en rien à l’objectif final – faire advenir un monde meilleur.
Cela implique ensuite de se saisir de la question du pouvoir. Je crois que les révoltes révèlent radicalement notre pouvoir. Soit le pouvoir de ceux qui ont été (et qui sont) continuellement baisés par le monde tel qu’il va mal : les prisonniers, les travailleurs migrants, les endettés, les diplômés au chômage, les employés de bureau suicidaires, les ouvriers des chaînes de montage, les enfants esclaves des plantations de cacao Nestlé ou encore mes amis d’enfance qui ne sont jamais sortis de leur mobile-home ou de leur région. En clair : la Génération baisée.
La question du pouvoir ne se cantonne pas à celle de sa réappropriation populaire – bien que ce soit l’objectif ultime. S’il est évidemment souhaitable qu’augmente la part de la population impliquées dans la destruction de ce spectacle merdique qu’est le statu quo, il se joue aussi autre chose dans l’émergence de ce processus collectif. Ceci : que la pauvreté paraisse inimaginable, que plus personne ne soit clandestin, que le pouvoir lui-même ne soit plus l’apanage d’une minorité, et que la richesse matérielle collective et l’intelligence accumulée de l’espèce humaine deviennent librement accessibles à tous ses membres.
En revendiquant ces idées, nous exerçons notre pouvoir contre ceux qui le détiennent. C’est un moyen d’effrayer les riches, et d’attirer les autres vers un projet allant bien au-delà de la réforme d’un monde qui s’effondre. Ça ne peut fonctionner que dans ces conditions. Et ce fut le cas le 1er mai 2012 : la révolte a créé son propre monde.
L’émeute n’est donc pas un obstacle à la « vraie » lutte ou un accident au cours duquel des gens « raisonnables » mais en colère sortent de leurs gonds. Non, la révolte hors de contrôle est la fondation même sur laquelle un futur digne de ce nom doit être construit.
Et nous serons ceux qui le construiront. Notre génération : celle du millénaire, la Génération baisée, ou, comme nous avons pris l’habitude de l’appeler, la Génération zéro. Zéro parce que nous n’avons rien à perdre, excepté des dettes. Et zéro parce que, comme la révolte, tout commence ici.
Notre futur a déjà été pillé. Il est temps de se le réapproprier.

- Nantes 2014 / Photo A11
1 Le concept de « fin de l’histoire » a été développé par le philosophe étasunien Francis Fukuyama entre 1989 et 1992. Il y affirmait que la démocratie libérale était, dans la période d’après-Guerre froide, l’unique horizon politique commun.
2 De la kétamine.
3 Laboratoire clandestin de fabrication de méthamphétamines.
4 Chaîne de magasins américaine.
5 Multinationale américaine spécialisée dans la grande distribution.