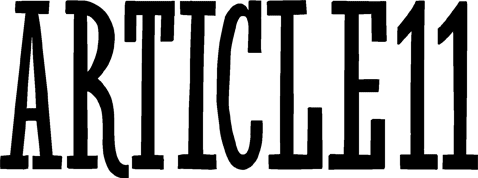vendredi 23 octobre 2009
Entretiens
posté à 15h32, par
28 commentaires
Suite et fin de l’entretien débuté hier avec le journaliste et traducteur Marc Saint-Upéry. Lequel poursuit son brillant décorticage de l’actualité latino-américaine. Au menu : Uribe, Obama, l’ALBA, la Banque du Sud, Cuba, Chavez, le Honduras, les minorités indigènes etc. Un tour d’horizon complet, parfois polémique ou pessimiste, mais d’une richesse analytique indéniable.
On te l’annonçait hier, cet entretien (par mail) avec le journaliste et traducteur Marc Saint-Upéry, auteur du très instructif Le Rêve de Bolivar (éditions La Découverte), était loin d’être fini. Après une première partie (ici) qui égratignait nombre de fantasmes sur la situation politique de l’Amérique Latine, Marc Saint-Upéry s’attarde céans (entre autres) sur la question des minorités indigènes, la situation à Cuba, la viabilité d’institutions telles que l’ALBA et la Banque du Sud ou la nouvelle donne stratégique suscitée par l’arrivée d’Obama au pouvoir.
Autant te prévenir derechef, lecteur, certains propos tenus ici ne te plairont guère ou bousculeront tes convictions. Guidé par un profond souci d’objectivité et d’exhaustivité, Marc Saint-Upéry prend parfois le contre-pied des idées reçues au sein des cercles progressistes/de gauche. De quoi alimenter le débat et, surtout, enrichir la discussion. Comme il l’affirme plus bas : « Il me semble que le rôle des médias alternatifs ne peut pas être seulement de prendre systématiquement le contre-pied du dernier cliché en vogue (la proposition symétriquement inverse d’un cliché pouvant aussi être un cliché). » Démonstration.
Une des grandes spécificités des gauches sud-américaines tient à la prise en compte des revendications des minorités indigènes. La Bolivie et l’Équateur semblent de très bons exemples de cette évolution. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour que s’amorce cette légitime reconnaissance de leurs droits ? Le chemin est-il encore long ?
Pourquoi tant de temps ? D’abord, sans tomber dans la formule mythique des « cinq cents ans de résistance » (la réalité historique est un peu plus compliquée que ça), les révoltes et les rébellions n’ont pas manqué, tant à l’époque coloniale que depuis les indépendances. Cela dit, elles étaient généralement très localisées et sans grandes perspectives stratégiques. Quant à la résistance au jour le jour, elle a toujours existé mais s’accompagnait aussi de stratégies complexes d’adaptation. Il y a toute une série de facteurs qui peuvent expliquent la montée des revendication et des organisations indigènes dans un certain nombre de pays à partir des années 1980 et 1990. Il ne faut toutefois jamais oublier que l’indianité « sociale » plus ou moins stigmatisée ne se traduit pas nécessairement par une indianité « politique » assumée, que l’habit ne fait pas le moine, que le vêtement, la langue et les coutumes « traditionnels » (et il s’agit fréquemment de « traditions » relativement récentes, hybrides ou réinventées) ne font pas nécessairement un indien conscient et militant et que les revendications « culturelles » ou « identitaires » ont souvent un caractère instrumental lié aux luttes pour les ressources matérielles et aux « structures d’opportunités » politiques promues par l’État et les organismes internationaux. Parmi les facteurs du « réveil indien », on peut donc citer : l’effet des réformes agraires qui ont été mises en œuvre – selon les pays – entre les années 1950 et 1970 et qui, malgré leurs énormes déficiences, ont desserré l’emprise des grands propriétaires terriens traditionnels sur les populations indigènes (elles ont de fait eu souvent plus d’effets politiques que de conséquences économiques pour ces populations) ; l’émergence des premières générations de professionnels et d’intellectuels indigènes ; le rôle des mouvements ecclésiaux progressistes ; la fin des dictatures militaires et des formes de gouvernance les plus brutalement répressives, ainsi que les politiques de décentralisation et de démocratisation des pouvoirs locaux. Tout cela a coïncidé de façon remarquable avec les prémices et les suites de la célébration des cinq cents ans de la « découverte » de l’Amérique en 1992, évènement doté d’une forte répercussion symbolique et politique. Quant aux gauches locales, il faut bien dire qu’elles ont souvent et longtemps participé aux discours et aux pratiques racistes ou paternalistes du monde blanc et métis et qu’elles ont parfois eu beaucoup de mal à évoluer sur la question. Enfin, l’émergence indienne a aussi été favorisée dans les années 1990 par un certain « multiculturalisme néolibéral » (notamment en Bolivie) et par la stratégie de « développement avec identité » encouragée par des organismes comme le PNUD, la Banque mondiale et la myriade d’ONG qui travaillent en fonction des mêmes paramètres.
La situation de l’Équateur est aujourd’hui assez différente de celle de la Bolivie. D’abord, la population indienne y est effectivement minoritaire, entre 7 % minimum et 15 % maximum, selon les recensements et investigations les plus fiables, qui posent de toutes façons toutes sortes de problèmes méthodologiques : seuls les Européens romantiques et les amateurs de « bons sauvages » – mais aussi les raciste vulgaires – croient qu’il est facile de définir ce qu’est au juste un indien, voire évident de s’auto-définir comme tel. Ensuite, si la mobilisation indigène a joué en Équateur un rôle politique et social très important dans les années 1990 et au début du nouveau millénaire, on constate depuis un déclin relatif dont les raisons seraient trop longues à expliquer ici, mais qui se reflète dans le mélange de cooptation subalterne et de tension irrésolue qui caractérise le rapport entre le mouvement indigène équatorien et le gouvernement de gauche du président Rafael Correa, avec son imaginaire très jacobin, centraliste et « développementiste ».
« Seuls les Européens romantiques et les amateurs de ’bons sauvages’ – mais aussi les raciste vulgaires – croient qu’il est facile de définir ce qu’est au juste un indien, voire évident de s’auto-définir comme tel. »
En Bolivie, on a des discours politiques indigènes superficiellement similaires mais une tout autre configuration des forces en présence. D’abord, ce sont 62 % des Boliviens qui déclarent être quechuas, aymaras, guaranis ou autres. En même temps, les aymaras et les quechuas auto-déclarés – lors du recensement de 2001 – sont plus nombreux d’un tiers que les Boliviens qui affirment savoir parler ces deux langues ; et lorsqu’on leur propose la catégorie « métis », par exemple, 69 % des « quechuas » s’y classent spontanément. Contradiction ? Pas vraiment. Paradoxe ? Peut-être, mais un paradoxe plein d’enseignements qui a aussi ses équivalents dans la sphère du politique. Ainsi, l’indianisme affiché d’Evo Morales (invocation des ancêtres, de la Pachamama, etc.) a souvent un aspect passablement « décoratif » de discours pour la galerie – la galerie internationale en particulier. Il ne reflète guère la politique réelle de son gouvernement, caractérisée comme en Équateur par de profonds réflexes « national-développementistes », avec y compris un discours modernisateur et industrialisant très marqué, même si parfois un peu irréaliste. Il y a certes aussi un aspect « émotionnel-identitaire » beaucoup plus profond – et certainement positif – dans cette revendication de la Bolivie indienne, mais cela relève plutôt d’une espèce d’ethnicisation symbolique et partielle du nationalisme populaire bolivien, avec des frontières assez floues et poreuses entre indianité, métissage, identité plébéienne et « bolivianité ».
Que faut-il en conclure ? Outre la reconnaissance officielle d’un certain nombre de droits culturels et collectifs, il y a bien en Bolivie une décolonisation de fait de l’imaginaire, au sens entre autres où les gens ont heureusement de moins en moins honte d’être ce qu’ils sont (et ils sont souvent beaucoup de choses à la fois). Mais le discours de l’ethno-fondamentalisme puriste ou de la « contre-modernité » post-coloniale sont surtout le fait d’intellectuels aymaras urbains et de leurs alliés universitaires. Ces derniers font certes parler d’eux à l’occasion et entretiennent parfois des liens avec tel ou tel secteur du pouvoir, surtout au niveau de l’occupation de certains postes administratifs de second plan, mais ils n’ont guère d’influence pratique sur les dynamiques sociales de fond. Car ces dynamiques de fond obéissent à de tout autres critères que ceux des discours politiquement et ethniquement correct. Il faut comprendre que si l’on a bien connu historiquement en Amérique latine une version « blanchissante » et raciste du métissage et de l’occidentalisation imaginaire, visant clairement à oblitérer l’indien et le Noir, il existe aussi un « usage indien » et subalterne très pragmatique du métissage culturel et de la modernisation/occidentalisation, usage qui reste difficilement déchiffrable pour les défenseurs d’une identité ethnique univoque et agressivement militante. Je ne peux pas m’étendre sur tout cela et j’essaie de donner pas mal d’exemples concrets dans le chapitre 4 de mon bouquin, mais disons qu’on a un paysage très mouvant au sein duquel luttes contre l’exclusion sociale, luttes pour la reconnaissance identitaire et stratégies d’assimilation autonomes et sui generis (je sais que le mot « assimilation » fera hurler certains, mais c’est pourtant bien de cela qu’il s’agit aussi) s’entrecroisent et se mélangent de façon souvent paradoxale et inattendue, et dans des proportions assez différentes selon les pays et les contextes.
La révolution cubaine reste un des grands référents des gauches sud-américaines. Morales et Chávez, par exemple, s’en sont souvent explicitement réclamés. La disparition annoncée (et déjà amorcée) de Fidel Castro va-t-elle fondamentalement changer les équilibres stratégiques dans la région ?
Cuba est un référent plus sentimental et symbolique que réel. À part certaines campagnes médicales et d’alphabétisation qui n’affectent guère le coeur des systèmes de santé et d’éducation des pays concernés, il n’y a pas une seule politique publique menée par les nouveaux gouvernements de gauche qui soit inspirée du régime des frères Castro. D’ailleurs, Cuba n’encourage nullement ses « amis » à l’imiter, bien au contraire : le message « ne faites pas comme nous » est quasi explicite dans les échanges d’idées bilatéraux entre La Havane et ses nouveaux alliés. Ce qui se passe, c’est que la révolution cubaine est un mythe politique fondateur pour une bonne partie de la génération aujourd’hui au pouvoir, et aussi un vecteur de cristallisation du contentieux historique entre l’Amérique latine et le grand voisin du nord. Alors dans certains pays gouvernés par la gauche et à certaines occasions rituelles, vous entendrez parler à satiété de l’immense « dignité » du peuple cubain, de sa « résistance indomptable » à l’empire, de l’« exemple sacré » du Che, etc. Mais à Cuba même, la réalité sur le terrain est beaucoup plus prosaïque et assez peu enthousiasmante. Le fait que le système de planification centralisée soit un échec retentissant, que l’économie de l’île soit dysfonctionnelle, que l’agriculture soit sinistrée, que la population soit à bout de forces, sont autant d’idées aujourd’hui admises presque ouvertement à La Havane, même chez les dirigeants. Bien entendu, vous n’entendrez guère parler de tout cela, ni avec cette franchise, dans les cercles d’intellectuels proches du pouvoir à Caracas, Quito, La Paz ou même Brasilia, parce que les gens qui peuplent ces cercles n’ont pas la moindre idée de ce qui se passe vraiment dans l’île, ni même de ce qui mijote dans les rangs du Parti et de la bureaucratie castristes. Ou alors, quand ils en ont des échos, à l’occasion de voyages non superficiels ou par les récits de diplomates amis, ils se refusent prudemment à rendre publiques leurs déprimantes découvertes : « Il ne faut pas faire le jeu de l’ennemi. » En attendant, à La Havane, le quotidien officiel Granma vient de justifier la suppression drastique de toute une série de subsides et services sociaux gratuits en expliquant qu’il s’agissait d’« ouvrir la porte à la rationalité et à l’épargne »2. Faut-il comprendre que le système antérieur était l’expression de l’irrationalité et du gaspillage ? C’est quand même un aveu terrible. Donc, avec toute une série de bémols, de tergiversations et de retards à l’allumage, il est clair que la « vietnamisation » de l’économie et l’introduction d’une ample gamme de mécanismes de marché sont d’ores et déjà à l’oeuvre. Certes, le monopole dictatorial du Parti reste tabou, du moins dans le discours officiel, qui semble en revanche accepter, même si c’est parfois à contrecœur, la libéralisation « culturelle » du pays (il y a en fait une bataille ouverte sur la question au sein du pouvoir). On voit pointer aussi une reconnaissance timide de la nécessité de « débureaucratiser » les relations entre le régime et la population.
Outre ces graves problèmes structurels, Cuba est aujourd’hui en train de traverser une très mauvaise passe due à une série de facteurs conjoncturels : graves dégâts provoqués par une série de cyclones tropicaux, hausse du prix des matières premières et, bien sûr, répercussions de la crise mondiale. Au niveau international, vu les nombreuses difficultés et pénuries économiques dont souffre l’île, l’aide et l’alliance vénézuélienne sont évidemment bienvenues, mais de nombreux indices suggèrent que des secteurs clés de la hiérarchie du pouvoir cubain, et en particulier les militaires, n’ont guère confiance en Chávez et ne le prennent pas très au sérieux. Les interlocuteurs régionaux les plus essentiels à moyen terme pour Raúl Castro seraient plutôt Washington et Brasilia. D’Obama, malgré les revendications officielles, La Havane n’attend pas vraiment la levée de l’embargo (une initiative dont nombre de fonctionnaires du Département d’État admettent en privé la nécessité et la rationalité mais qui reste impossible pour des raisons de politique intérieure américaine), mais certainement toutes sortes de mesures d’assouplissement dont certaines ont d’ailleurs déjà été prises. Et le Brésil de Lula est perçu non seulement comme un allié influent mais comme un partenaire économique plus fiable à long terme que le Venezuela et comme la clé de la réintégration politique de Cuba au continent. Ce du moins tant que le PT sera au pouvoir, mais peut-être même au-delà : on sait trop peu que même sous des gouvernements conservateurs – comme par exemple celui de Jânio Quadros au début des années 1960 –, la diplomatie brésilienne a souvent fait preuve d’un plus grande ouverture à l’égard de Cuba que ses homologues hispano-américains, à l’exception du Mexique. Cela dit, je ne parlerais pas de « changement fondamental des équilibres stratégiques dans la région » à propos de Cuba, parce que franchement, sur le plan géostratégique, le régime des frères Castro ne représente pas grand chose aujourd’hui, ni comme menace pour l’« empire », ni comme alternative positive.
La Colombie et le Pérou sont les derniers régimes conservateurs d’Amérique du Sud. Est-ce pour cela qu’on pardonne tout à Uribe, même ses pires exactions ? Qu’on ferme les yeux sur les récentes répressions menées par le gouvernement d’Alan Garcia à l’encontre des mouvements indigènes ? L’Occident voit ces deux pays comme un rempart à la gauche, un moindre mal ?
Je ne sais pas si « on » pardonne tout à Uribe et j’éviterais de parler de « l’Occident » en bloc. L’Espagne, par exemple, entretient aujourd’hui d’excellentes relations politiques et commerciales avec Uribe, mais aussi avec Chávez, qui a récemment été reçu à bras ouverts à Madrid et a signé de juteux contrats avec la compagnie pétrolière et gazière espagnole Repsol. La France aussi s’entend bien avec Uribe, mais elle vient de vendre au Brésil des armes explicitement destinées par Brasilia à contrebalancer l’alliance colombo-étatsunienne. Qu’est-ce que ça prouve au juste ? Si on doit parler de logique du moindre mal, on pourrait l’appliquer au raisonnement d’une partie de l’électorat colombien à propos d’Uribe : en gros, et comme l’aurait dit Roosevelt de Somoza père, c’est un salaud, mais c’est notre salaud, et nous détestons encore plus les FARC (le niveau d’impopularité de ces dernières est en effet abyssal, y compris dans les secteurs populaires). Il y a même probablement un nombre non négligeable d’électeurs qui votent pour Uribe aux présidentielles et pour un candidat du Pole démocratique alternatif (PDA, gauche) aux élections locales ou législatives. Mais surtout, dans leur écrasante majorité, les électeurs d’Uribe ne veulent pas vraiment savoir ce qu’il en est de son passé, de ses exactions et de ses accointances paramilitaires. Ce qu’ils constatent, c’est qu’il a restauré une apparence de paix civile sur une bonne partie du territoire. En réalité, la majorité de la violence homicide contre des civils en Colombie n’est pas le fait des FARC, mais la perception de la responsabilité politique des FARC dans la perpétuation de la logique de guerre est pratiquement universelle, et elle n’est pas dénuée de tout fondement.
« En réalité, la majorité de la violence homicide contre des civils en Colombie n’est pas le fait des FARC. »
Quoi qu’il en soit, je peux vous dire que l’humble marchande informelle de boissons et de friandises qui peut enfin exercer son office au bord de la route dans tel ou tel village ou petite ville parce que les touristes de la capitale ou de Medellin vont de nouveau a la campagne ou à la plage en voiture éprouve une réelle gratitude envers le président colombien, de même qu’une bonne partie des couches populaires. En outre, par le biais d’une habile pédagogie nationaliste, Uribe a restauré une certaine fierté patriotique et une estime de soi fort mise à mal par l’image peu reluisante de la Colombie dans le monde (narcotrafiquants, violence extrême, etc.). Et chaque fois que Chávez fait une déclaration anti-colombienne outrancière, Uribe gagne des points dans l’opinion. Tout cela ne change évidemment pas grand chose à la triste réalité de la situation sur le terrain. Paramilitarisation rampante de la politique, concentration des terres et des richesses par le biais d’une véritable « contre-réforme agraire » armée, violations des droits de l’homme, harcèlement meurtrier des mouvements populaires (notamment les syndicats) d’un côté, cécité et autisme politique criminels des FARC de l’autre : autant de phénomènes dont on est loin de voir la fin et qui pourrissent la société colombienne. Une société qui se caractérise par des inégalités et des injustices majeures et par l’immobilisme social de ses élites, mais aussi, il faut bien le dire, par leur remarquable dynamisme économique et par leur capacité notable de maintenir leur hégémonie politique et culturelle sur la population.
« Paramilitarisation rampante de la politique, concentration des terres et des richesses par le biais d’une véritable « contre-réforme agraire » armée, violations des droits de l’homme, harcèlement meurtrier des mouvements populaires (notamment les syndicats) d’un côté, cécité et autisme politique criminels des FARC de l’autre : autant de phénomènes dont on est loin de voir la fin et qui pourrissent la société colombienne. »
Pour ce qui est du Pérou, son alignement « réactionnaire » n’est pas aussi tranché. L’antagonisme avec Caracas s’est largement atténué depuis l’élection d’Alan García, et ce dernier entretient d’excellentes relations avec le gouvernement de Rafael Correa, par exemple, et ne participe nullement à de quelconques entreprises de déstabilisation de l’Équateur. En général, d’ailleurs, en matière de « déstabilisation » des gouvernements progressistes et d’« offensive impériale », certains observateurs « anti-impérialistes » racontent n’importe quoi, mélangent les faits réels, les demi-vérités, les hypothèses plus ou moins plausibles et les ragots paranoïaques, et ils sont assez mal informés sur ce qui se passe concrètement dans chaque pays. Bien entendu, la CIA et autres organismes font partout leur boulot, souvent très piètrement bureaucratique et parfois en fait assez peu efficace, voire contre-productif. Et bien entendu, les États-Unis ne nourrissent aucune tendresse particulière à l’égard des gouvernements de gauche latino-américains. Mais quand je lis certains propos sur la « montée de l’agressivité de Washington »sous la plume d’Éric Toussaint, par exemple, je me frotte les yeux. Toussaint cite par exemple comme « preuve » d’une agressivité renouvelée de l’empire et de ses alliés, « le soutien aux mouvements séparatistes en Bolivie (la ’media luna’, capitale Santa Cruz), en Équateur (la ville de Guayaquil et sa province) et au Venezuela (l’état pétrolier de Zulia, capitale Maracaïbo) ». C’est parfaitement fantaisiste. Le séparatisme de la media luna bolivienne (« demi-lune », en référence à la forme des départements orientaux dissidents) est aujourd’hui en pleine débandade du fait de sa bêtise et de son incompétence stratégiques, qui l’ont amené à s’associer avec des menées terroristes d’un amateurisme délirant. Ses partisans sont amèrement divisés et une partie des autonomistes de Santa Cruz plaident aujourd’hui ouvertement pour une réconciliation penaude avec le gouvernement central. Washington n’a strictement rien fait ni rien pu faire pour empêcher cette déroute stratégique et, de toutes façons, les seuls acteurs internationaux qui pèsent vraiment dans le conflit régional bolivien sont les voisins argentin et brésilien, qui soutiennent Evo Morales et refusent toute menée séparatiste. Or, sans appuis régionaux frontaliers, le séparatisme est mort-né. Pour sa part, le mouvement autonomiste guayaquilien a depuis longtemps du plomb dans l’aile ; il est en tout cas bien incapable aujourd’hui de promouvoir de quelconques poussées séparatistes. L’ambassade étatsunienne en Équateur, qui entretient des relations avec tous les secteurs de l’opposition aussi bien qu’avec le gouvernement, se garde bien de les y encourager : une telle bourde serait en fait tout au bénéfice de Correa et les Américains ne sont quand même pas si stupides. Enfin le soi-disant séparatisme de l’état de Zulia – qui certes a toujours nourri une certaine veine autonomiste, et ce bien avant Chávez – est très largement une invention de la propagande chaviste. En tout cas il ne s’agit certainement pas d’un objectif stratégique avoué ou même clandestin de Washington, parce qu’une quelconque entreprise sécessionniste créerait à la Maison blanche bien plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait, y compris en termes d’approvisionnement pétrolier (lequel fonctionne très bien sous l’égide de Chávez, merci). Il serait donc temps que les « anti-impérialistes », aussi bien intentionnés soient-ils, arrêtent de se raconter des histoires.
Enfin, pour revenir au Pérou, les graves incidents de juin 2009 à Bagua, où un nombre indéfini d’indigènes et 24 policiers on trouvé la mort, n’ont pas grand chose à voir avec l’hypothèse selon laquelle le Pérou pourrait être un « rempart contre la gauche ». Ce conflit entre exploitation minière et indigènes reflète une contradiction profonde entre la logique extractiviste et primo-exportatrice de pratiquement tous les gouvernements latino-américains, avec ses répercussions écologiques et sociales, et celle des communautés locales. Or, c’est là une contradiction qui affecte durement aussi bien les gouvernements de gauche que les gouvernements plus conservateurs. Fin septembre 2009, de violents affrontements ont eu lien entre les indiens Shuar opposés à l’exploitation minière et les forces de l’ordre déployées par le gouvernement équatorien dans la province de Morona-Santiago (faisant un mort chez les indiens), et il y a eu tout récemment deux morts indigènes dans la Sierra de Perijá, au Venezuela, en conséquence d’un conflit analogue. L’aspect tragicomique de la chose, c’est qu’au Pérou le pouvoir affirme que les indiens rebelles sont financés par Chávez, tandis qu’au Venezuela et en Équateur, la thèse de certains membres du gouvernement est qu’ils sont forcément manipulés par la droite ou la CIA.
Votre livre ne se penche pas sur le cas de l’Amérique centrale. Cette évolution vers des régimes progressistes ne concerne pas ces pays ? Les logiques y sont différentes ?
La dynamique géopolitique du Mexique et de l’Amérique centrale est effectivement un peu différente, en particulier en termes d’intégration, malgré les nombreuses similitudes culturelles et sociologiques. Cela dit, si je ne les ai pas inclus, c’est aussi pour des raisons beaucoup plus prosaïques : il est déjà assez difficile – et très coûteux – d’essayer de suivre simultanément une dizaine de pays sud-américains (qu’à l’exception du Paraguay, j’ai tous visités plusieurs fois, même si j’ai concentré le projecteur sur les pays gouvernés à gauche), alors j’ai dû de toutes façons me limiter. Et si je m’étais aussi lancé à couvrir l’Amérique centrale, vu le temps et l’argent que j’aurais dû y investir, mon épouse aurait probablement demandé le divorce. Et elle aurait eu raison.
Alors très brièvement, en effet, cette évolution vers des régimes progressistes a aussi commencé à affecter certains pays d’Amérique centrale (mais après que j’ai terminé mon enquête fin 2006, c’est pourquoi je n’en parle succinctement que dans la longue postface de la réédition d’octobre 2008). Même si ce n’est pas nécessairement le facteur principal, la victoire bien méritée du Front Farabundo Martí de Libération nationale (FLMN) au Salvador est probablement due en partie au fait que l’électorat salvadorien s’est senti en quelque sorte « autorisé » à voter à gauche par la vague progressiste continentale, et ce malgré la propagande terroriste de la droite qui agitait l’épouvantail communiste. De façon non pas identique mais analogue, il est vraisemblable que Manuel Zelaya – qui est par ailleurs un personnage pour le moins complexe et « discutable » issu de l’élite économique et de la classe politique traditionnelles, ce qui bien entendu n’ôte rien à sa légitimité présidentielle et à l’infamie du coup d’État tramé contre lui – ait saisi l’occasion de surfer sur cette même vague afin de se forger une profil différent et novateur sur la scène politique hondurienne. Donc là aussi, bien que sous une autre forme, il y a bien un « effet d’autorisation » et de légitimation d’un tournant à gauche. Quant au gouvernement de Daniel Ortega au Nicaragua, il s’agit malheureusement, et ce de l’aveu même de nombre de personnalités lucides et irréprochables de la révolution sandiniste, d’une satrapie parfaitement imprésentable qui gouverne en alliance mafieuse avec la droite réactionnaire5. Là, pour le coup, il y a une marge énorme entre le discours officiel, la manipulation honteuse de symboles historiques respectables et la réalité sur le terrain.
Que vous inspire la situation au Honduras ? Est-ce que l’on peut expliquer l’apathie occidentale (en comparaison du déchaînement médiatique post-élections iraniennes) par le fait que Zelaya se situait à gauche sur l’échiquier politique, et avait notamment fait adhérer le Honduras à l’Alba en 2008 ?
Sur le fond, je n’ai rien de très original à dire. Manuel Zelaya est le chef d’État légitime, Micheletti doit être dénoncé et renversé et l’armée doit rentrer dans ses casernes. Après ça, savoir s’il faut négocier le retour de Zelaya avec les putschistes, et jusqu’à quel point, ou s’il faut aussi continuer à mobiliser en faveur d’une Assemblée constituante, etc., c’est à Manuel Zelaya lui-même et au Front de la Résistance hondurien – dont par ailleurs, je crois, les rôles et les positions ne coïncident pas nécessairement à 100 % – d’en décider. Je suppose qu’un des soucis fondamentaux est quand même d’éviter un bain de sang et de compenser un rapport de forces militaire défavorable par un rapport de force moral et politique suffisamment décisif.
Quant à la question des réactions internationales, je ne pense pas qu’on puisse vraiment parler d’« apathie occidentale » en ce qui concerne le Honduras en comparaison d’un « déchaînement médiatique post-élections iraniennes », car on ne peut pas mélanger le niveau des réactions et des initiatives diplomatiques et celui des discours médiatiques. Paradoxalement, bien au contraire, il y a unanimité formelle dans la condamnation du « régime de fait » au Honduras, alors qu’on est très loin d’une quelconque unanimité formelle dans la condamnation de la supposée illégitimité des élections iraniennes. Et que je sache, le gouvernement d’Ahmadinejad est encore reconnu par tout le monde. De fait, même Washington a été fort embarrassé par toute cette affaire électorale iranienne, car la Maison blanche a un besoin vital de négocier avec Téhéran à cause du caractère explosif des dossiers régionaux et du fait lui aussi paradoxal que, malgré l’épine du programme nucléaire et l’histrionisme d’Ahmadinejad, les intérêts géopolitiques de l’Iran et des États-Unis coïncident très largement sur un certain nombre de points, en particulier en Irak et en Afganistan-Pakistan (il faut quand même savoir que l’Irak est en réalité aujourd’hui pratiquement co-gouverné par Washington et Téhéran). Et puis bon, quand même, il est clair aujourd’hui qu’il y a bien eu en Iran un coup d’état interne a l’élite politico-cléricale, ainsi qu’une répression féroce qui mérite toute la condamnation morale du monde. Vous savez, si Fox News ou TF1 disent qu’il fait beau quand il y a du soleil, ce n’est pas une raison pour prétendre qu’il pleut contre tout évidence ou pour se faire un point d’honneur mal embouché à sortir avec un parapluie.
« Il y a unanimité formelle dans la condamnation du « régime de fait » au Honduras, alors qu’on est très loin d’une quelconque unanimité formelle dans la condamnation de la supposée illégitimité des élections iraniennes. »
Alors pour revenir au Honduras, derrière cette condamnation quasi unanime – que j’ai décrite comme « formelle », mais la formalité compte en relations internationales –, il y a bien entendu des stratégies sous-jacentes assez différentes, ainsi que des contradictions ouvertes au sein de l’administration Obama. Bruxelles, Washington, Caracas et Brasilia, par exemple, ont chacun des approches distinctes, parfois divergentes, parfois convergentes, parfois opportunistes et temporisatrices, parfois plus agressives ; ça n’empêche pas que les putschistes honduriens ne sont pas vraiment à la fête et qu’on sait que la pression internationale a engendré de sérieuses fissures dans le front anti-Zelaya. Après ça, ce que disent ou ne disent pas les journaux et les marchands d’opinion éditoriale en Occident, c’est une autre affaire.
Le problème de l’absence d’équilibre informatif et des fixations crypto-idéologiques obsessionnelles des médias dominants sur tel ou tel thème est bien réel, et je comprends que ce soit très agaçant, mais je vous avoue que je suis parfois perplexe en lisant les réactions souvent assez répétitives ou pavloviennes des médias dits alternatifs à ce sujet. La critique des médias dominants, c’est bien et c’est nécessaire, mais il me semble que le rôle des médias alternatifs ne peut pas être seulement de prendre systématiquement le contre-pied du dernier cliché en vogue (la proposition symétriquement inverse d’un cliché pouvant aussi être un cliché), ni d’écumer de rage chaque fois que des bouffons comme Adler, BHL, Finkielkraut, Slama ou Val profèrent une connerie plus grosse qu’eux sur les ondes nationales ou que tel ou tel éditocrate parisien pontifie sur les destinées de l’Orient et de Occident. Sans compter qu’on peut parfois avoir des surprises, à savoir des journalistes qui font bien leur métier même dans les « médias dominants ». Sur l’Amérique latine, par exemple, le travail de Lamia Oualalou – je précise tout de suite que je ne l’ai jamais rencontrée – au Figaro est sans doute une des meilleures choses qu’on trouve dans la presse quotidienne française. Quoi qu’il en soit, consacrer toutes ses énergies à dénoncer le cirque médiatique franco-français, c’est encore un peu faire partie du cirque médiatique franco-français. Internet offre justement l’avantage de pouvoir faire autre chose, de plus intéressant et de plus utile à mon humble avis. Par exemple, relayer et mettre en relief la véritable pluralité de voix et richesse d’analyse qui existent aujourd’hui dans le monde sur toute une série de sujets. Ces voix sont parfois difficiles à dénicher – je viens d’observer qu’il est difficile d’identifier des sources d’analyses sobres, rationnelles, fiables et sérieusement documentées sur le Venezuela, par exemple7 -, mais elles existent. Sur l‘Iran et alentours, voyez le blog du professeur Juan Cole par exemple : on y apprend plus en cinq minutes de lecture, y compris à travers les liens qui renvoient à des analyses opposées aux siennes – qu’il a fréquemment l’honnêteté de signaler – qu’en cinq heures de lecture de la presse et de la blogosphère françaises sur les mêmes sujets.
« Il me semble que le rôle des médias alternatifs ne peut pas être seulement de prendre systématiquement le contre-pied du dernier cliché en vogue (la proposition symétriquement inverse d’un cliché pouvant aussi être un cliché). »
Vous mentionnez des « contradictions ouvertes au sein de l’administration Obama ». Quelle est au juste la position de Washington sur le Honduras ? Les accusations portant sur leur rôle dans le coup d’état sont-elles crédibles ?
À ce sujet, vous avez publié en juillet dernier une interview assez intéressante d’Hélène Roux, qui insiste sur le poids des facteurs internes et dont je partage pour partie les analyses. Mais pour montrer à quels points certains réflexes idéologiques conditionnés sont à côté de la plaque, je reviendrai encore une fois sur l’article d’Éric Toussaint cité précédemment. Toussaint affirme qu’« au moment où ces lignes sont écrites [8 octobre 2009], Washington refuse toujours de considérer qu’il y a eu un coup d’état le 28 juin 2009 au Honduras ». C’est faux : dès la fin du mois de juin, Obama avait déclaré que le renversement de Manuel Zelaya était « illégal » et qu’il considérait toujours ce dernier comme le président légitime du Honduras. Et il avait pris des sanctions à la clé : suspension de l’aide militaire et de l’assistance économique bilatérale à hauteur de 20 millions de dollars. Plus récemment, Washington a suspendu les visas de 21 membres du gouvernement de Micheletti. Ce dernier point peut paraître assez anecdotique pour un lecteur français, mais il faut savoir que la plupart des membres de l’élite hondurienne – et des élites latino-américaines en général – ont des appartements, des propriétés et parfois des entreprises aux États-Unis, le plus souvent à Miami, et que les séjours réguliers de vacances, de santé et d’affaires en territoire étatsunien sont un élément fondamental de leur prestige et de leur statut. Supprimer les visas, ce n’est donc pas simplement décoratif. Et début septembre, le Département d’État a suspendu des crédits supplémentaires. Toussaint écrit encore : « Par ailleurs, Hillary Clinton n’a pas condamné le couvre-feu prolongé décrété par Micheletti ». Il est exact qu’Hillary Clinton a d’abord tergiversé à propos du couvre-feu, mais le Département d’État a ensuite fait bien plus que le déplorer puisqu’il a publié un communiqué condamnant formellement l’état de siège et les violations des droits civiques au Honduras. De fait, aujourd’hui, l’opposition républicaine et même certains membres de l’aile droite du parti démocrate considèrent qu’Obama s’est scandaleusement aligné sur Chávez ! Ce qui n’est évidemment pas du tout vrai non plus, mais est très symptomatique. Il y a actuellement au Congrès une opération de lobbying bipartisane tout à fait officielle qui se propose explicitement de renverser la tendance en faveur de Micheletti et a déjà dépensé plus de 400 000 dollars à cet effet. Tout cela ne serait pas nécessaire si la position de la Maison Blanche était du goût des anti-Zelaya.
« Dès la fin du mois de juin, Obama avait déclaré que le renversement de Manuel Zelaya était « illégal » et qu’il considérait toujours ce dernier comme le président légitime du Honduras. Et il avait pris des sanctions à la clé. »
Alors bien entendu, Washington ne contemple pas Zelaya avec des yeux énamourés, et il est assez probable que ce que la diplomatie étatsunienne essaie d’obtenir, c’est un compromis qui assurerait son retour tout en lui rognant les ailes politiquement parlant. Par ailleurs, et ce n’est pas tout à fait la même chose, il semble bien qu’il y ait eu des complicités directes avec les putschistes au sein même de l’establishment diplomatico-militaire américain, même si c’est à l’insu de la Maison blanche. Avant d’être expulsé au Costa-Rica, Zelaya captif a transité par la base américaine de Palmerola, par exemple. Plus généralement, ce ne sont pas seulement les vieux routiers républicains de la guerre froide comme Otto Reich qui s’agitent en coulisse en faveur des putschistes, mais des gens comme Lanny Davis, avocat et lobbyiste d’une bonne partie de l’oligarchie hondurienne, qui est aussi un intime du clan Clinton. Ce qui peut expliquer qu’Hillary Clinton ait pas mal tergiversé et traîné des pieds sur le Honduras, de même qu’en son âme et conscience de faucon pro-israélienne, elle est beaucoup plus partisane du bâton – opération militaire incluse – que de la carotte à l’égard de Téhéran. Mais en dernière instance, elle est obligée d’obéir aux injonctions stratégiques de la Maison blanche parce c’est ce à quoi elle s’est explicitement engagée dans le deal de 2008 qui lui a permis d’accéder à son poste prestigieux : « C’est Obama le patron, loyauté absolue, pas de double jeu et de stratégie clintonienne parallèle. »
« Il semble bien qu’il y ait eu des complicités directes avec les putschistes au sein même de l’establishment diplomatico-militaire américain, même si c’est à l’insu de la Maison blanche. »
Pour conclure, je dois dire que je trouve un peu bizarre la position des gens qui discourent constamment sur les noirs desseins de l’« empire » et leur implacabilité mais qui, en même temps, se mettent à dénoncer l’« hypocrisie » de Washington quand la Maison blanche désavoue le coup d’état en Honduras tout en n’adoptant pas une position aussi ferme que Chávez, ou même simplement que Brasilia ou Bruxelles. Hypocrisie ? L’hypocrisie est le pain quotidien de la vie politique, surtout dans le domaine des relations internationales, et en réalité elle est un facteur de progrès moral quand elle oblige les puissants à respecter certaines formes et modérer ou limiter de fait leur domination.
De manière plus globale, l’arrivée au pouvoir d’Obama a-t-elle vraiment changé la donne des relations entre l’Amérique du Sud et les États-Unis comme l’espéraient certains avant son élection ? Ou bien continue-t-il dans la droite ligne impérialiste de ses prédécesseurs ?
Obama n’a pas été élu pour démanteler l’ « empire » étatsunien en tant que tel, ni n’en a la moindre intention. C’est un patriote américain, certes sur des bases plutôt centristes et « à visage humain » si on le compare à Bush, et même avec quelques pointes (rares et fort timides) de progressisme rooseveltien en politique intérieure et de multilatéralisme sincère en politique extérieure. Mais le patriotisme américain, comme celui de n’importe quelle puissance majeure – ce qui vaut bien entendu aussi, avec des modalités diverses, pour la Chine, la Russie, l’Inde, le Brésil, etc.–, suppose la défense du prestige, de l’influence et des intérêts économiques et géopolitiques des États-Unis dans le monde. Et donc de l’« empire », si on souhaite l’appeler ainsi. Le problème, c’est qu’une bonne partie de la gauche latino-américaine, et de la gauche radicale européenne, ont une conception parfaitement infantile, conspirative et sous-informée de l’« empire » étatsunien et de son fonctionnement. Elles pratiquent abondamment à cet égard ce que Bourdieu appelait le « fonctionnalisme du pire », méconnaissant et sous-estimant totalement les contradictions, les frictions, les pesanteurs et les inerties politico-militaires, économiques, idéologiques et même bureaucratico-administratives (ces dernières jouent un rôle assez important tant dans le fonctionnement du complexe militaro-industriel que dans celui de la diplomatie) qui gouvernent l’interprétation et la mise en œuvre concrète du « hard power » et du « soft power » des États-Unis dans le monde, ainsi que les différents calculs des coûts et bénéfices inhérents à telle ou telle stratégie impériale. Plus globalement, en matière de conceptualisation des relations internationales, il faut bien dire que la gauche anticapitaliste est souvent passablement inepte. Il y a longtemps que l’on sait que les théories classiques de l’impérialisme, comme celle de Lénine ou même de Rosa Luxembourg, sont très insatisfaisantes parce qu’elle n’arrivent à rendre compte ni de la diversité des configurations de pouvoir dans le champ international, ni des véritables relations entre facteurs économiques, facteurs politico-militaires et dimensions idéologiques. Mais ces théories avaient au moins le mérite d’une certaine cohérence matérialiste. Ce qui les remplace par défaut chez leurs supposés héritiers, c’est le plus souvent un mélange contradictoire, conceptuellement instable et intellectuellement indigent d’économisme vulgaire et de moralisme bon marché qui ferait se retourner Marx dans sa tombe.
« Le problème, c’est qu’une bonne partie de la gauche latino-américaine, et de la gauche radicale européenne, ont une conception parfaitement infantile, conspirative et sous-informée de l’« empire » étatsunien et de son fonctionnement. »
En tout cas, ce qui est clair aujourd’hui, certes sans doute pas pour toute le monde – puisqu’on l’a vu, les néoconservateurs continuent à s’agiter furieusement et à manoeuvrer ce qui leur reste de pions sur des thèmes comme l’Iran ou le Honduras –, mais pour une majorité sensible d’analystes et d’acteurs politiques appartenant au mainstream de l’establishment étatsunien, c’est que la stratégie Bush-Cheney d’unilatéralisme offensif et de « regime change » non seulement n’a pas donné les résultats escomptés, mais s’est traduite par une diminution drastique du prestige, de l’influence et même de la capacité d’intervention directe et indirecte des États-Unis dans le monde. C’est de cette constatation que part Obama – d’où sa position sur le Honduras –, qui se trouve en outre confronté aux conséquences matérielles et géopolitiques désastreuses de cette stratégie sur le terrain moyen-oriental où, à mon avis, toutes les options qui s’offrent aujourd’hui à Washington sont des impasses. (Ce dont on pourrait se réjouir si la relative impuissance américaine offrait des perspectives émancipatrices dans la région, mais ce n’est pas vraiment le cas….. )
Alors vous savez, à côté du défi chinois, du problème israélo-palestinien ou du casse-tête « Af-Pak » (et de ses vastes et effrayantes prolongations sud-asiatiques), l’Amérique latine est un problème relativement bénin… Ce qui préoccupait le plus la Maison blanche dans la région, ces derniers mois, ce n’était pas les gouvernements de gauche, mais la crainte d’une spirale incontrôlable de violence et de déstabilisation des institutions par les bandes de narcotrafiquants au Mexique. À côté d’un « allié » traditionnel ultra-problématique comme le Pakistan, un « ennemi » comme Chávez, qui livre son pétrole rubis sur l’ongle et dont la « bolibourgeoisie » fait régulièrement ses emplettes à Miami, c’est du gâteau…
Le problème, c’est que cet état de distraction moyen-orientale, de surcharge stratégique et de négligence relative de l’arrière-cour latino-américaine, s’il laisse certainement une marge de manœuvre plus grande aux initiatives autonomes des gouvernements progressistes de la région, ouvre aussi la voie aux intrigues des éléments les plus réactionnaires et aux cafouillages diplomatiques, tel que celui qu’on perçoit à propos du Honduras. Elle n’exclut pas non plus la perpétuation inertielle, voire l’accentuation automatique, de certaines tendances lourdes de la politique sécuritaire régionale (anti-drogue, anti-terroriste, sécurité énergétique, etc.). C’est me semble-t-il ce qui se passe avec la Colombie. Pour finir, je crois qu’à moyen terme, les deux facteurs fondamentaux qui décideront du poids de l’influence des États-Unis dans la région sont, d’une part, la possibilité d’un enlisement catastrophique en Afghanistan, avec toutes ses répercussions en termes de consensus interne et de crédibilité externe, et le résultat des élections brésiliennes de fin 2010.
L’annonce du renforcement de la présence militaire des États-Unis en Colombie a été très mal reçue par la majorité des pays de l’UNASUR. Cristina Kirchner a ainsi déclaré : « Nous ne pouvons pas admettre que les USA, après avoir exporté la crise économique et la grippe porcine chez nous, apportent encore une situation de guerre dans notre région. » L’ingérence américaine ne serait plus bienvenue ? Washington risque-t-il de hausser le ton en représailles ?
D’abord, je vous dirai qu’il y a quelque chose qui me laisse un peu perplexe dans cette histoire des « sept bases » américaines. Bien que les termes de l’accord entre Washington et Bogota soient encore secrets, il faut bien comprendre qu’il ne va pas s’agir de sept base de l’US Air Force ou des Marines, mais pour l’essentiel d’infrastructures de l’armée colombienne établies ou renforcées avec l’aide financière des États-Unis et offrant diverses facilités logistiques et opérationnelles à des personnels et des équipements étatsuniens, la question étant de savoir à quel niveau. Mais ce genre de coopération étroite (logistique, transport, intelligence, communication, approvisionnement, encadrement, etc.) est depuis longtemps la règle entre les deux pays. On sait aussi très bien que diverses unités militaires colombiennes d’élite sont entièrement formées et financées par les États-Unis, non seulement au niveau des équipements de combat, mais de la première paire de chaussettes à la dernière brosse à dents. Bref, les « sept bases », qui ne seront peut-être même pas vraiment sept au sens strict (je doute fort que les Américains, sans parler des Colombiens, disposent aujourd’hui de la capacité de financer un tel déploiement), ce n’est que la continuité pas nécessairement spectaculaire de choses qui se font déjà amplement et qui, si elles sont bien connues des observateurs attentifs, sont menées de façon plus discrète et ne suscitent pas tant de scandale diplomatique. Alors pourquoi le crier sur tous les toits et alerter les voisins, comme l’ont fait les Colombiens9 ? Il y a là peut-être des motivations politiques internes – ou externes – que je ne me sens pas encore à même de discerner.
Il y a autre chose à remarquer à propos de l’alliance entre Bogota et Washington. Des trois grandes alliances politico-militaires traditionnelles dans des régions « sensibles », à savoir Pakistan, Israël et Colombie (l’Égypte est un peu à part parce qu’elle n’est engagée dans un conflit armé), c’est la seule qui ne présente pas aujourd’hui d’aspects gravement dysfonctionnels. Disons qu’Uribe et les généraux colombiens ne risquent pas trop de faire à Washington un enfant dans le dos, comme Netanayahu avec son inflexibilité sur la politique de colonisation, voire sur l’Iran, ou bien les militaires et les services d’intelligence pakistanais avec leur double ou triple jeu machiavélique à l’égard du terrorisme islamique. Ce n’est certes pas l’idylle absolue, il y a quelques frictions sur les questions commerciales sous la pression des lobbies agricoles américains, et certains syndicats mènent de leur côté aux États-Unis une forte campagne anti-Uribe qui mélange opportunément protectionnisme et défense des droits de l’homme et se voit répercutée par quelques congressistes démocrates. Mais disons que ces motifs d’irritation restent marginaux. Comme on dit en espagnol (et je crois aussi en arabe), si on vous fait cadeau d’un cheval, vous ne vous plaignez pas de sa dentition. La Colombie d’Uribe est un cadeau géostratégique qui ne se refuse pas, même pour un gouvernement qui peut nourrir dans certains cas une sensibilité assez différente de celle de Bush et favoriser une approche plus conciliatrice à l’égard des autres gouvernements latino-américains.
« La Colombie d’Uribe est un cadeau géostratégique qui ne se refuse pas, même pour un gouvernement qui peut nourrir dans certains cas une sensibilité assez différente de celle de Bush. »
Maintenant, pour ce qui est de hausser le ton, ce sont plutôt les sud-américains qui ont donné de la voix jusqu’à présent. On l’a vu avec Chávez, qui de toutes façons ne sait pas vraiment baisser le ton ; on l’a vu avec Brasilia, qui nous avait plutôt habitué à une courtoise suavité diplomatique ; et les propos de Cristina Kirchner que vous citez sont éloquents. Par ailleurs, je ne vois pas trop quelles représailles Washington peut exercer. À l’occasion, les tensions dans telle ou telle négociation commerciale peuvent donner lieu à des sanctions ou à l’élimination de traitements préférentiels, mais cela n’a pas grand chose à voir avec les bases en Colombie. Il y a aussi les processus dits de « certification », liés à l’obsession de la « guerre contre la drogue », laquelle est par ailleurs un échec retentissant – ce que reconnaissent aujourd’hui en privé nombre de représentants de l’establishment étatsunien, républicains compris. Mais en fait, les seuls systèmes de représailles institutionnelles exercées actuellement par Washington sont l’embargo contre Cuba, qui est certainement absurde et critiquable mais n’a rien de nouveau, et les sanctions timides mais bien réelles contre… le gouvernement de Micheletti ! Alors très franchement, je ne pense pas qu’un récent prix Nobel de la Paix qui n’est même pas capable de promouvoir la paix là où il prétend souhaiter le faire (Israël-Palestine) et qui est probablement en train de s’enliser tragiquement en Afghanistan aura la moindre légitimité, sans même parler des ressources militaires et logistiques disponibles, pour pratiquer de façon systématique et soutenue une politique du gros bâton en Amérique latine. Sans compter que je ne sache pas qu’aucun approvisionnement énergétique ou qu’aucun intérêt économique vital des États-Unis soient menacés par les gouvernements de gauche latino-américains pour l’instant, Chávez compris. On peut donc faire l’hypothèse que ce qui va continuer, en gros, c’est la navigation à vue, la gestion à la marge des foyers de tension, les alternances aléatoires et sans grandes conséquences pratiques entre froncements de sourcil impérial et discours multilatéralistes conciliateurs, les tergiversations diplomatiques et les adaptations pragmatiques en attendant que des vents idéologiquement plus favorables à Washington soufflent dans la région.
« Je ne pense pas qu’un récent prix Nobel de la Paix qui n’est même pas capable de promouvoir la paix là où il prétend souhaiter le faire (Israël-Palestine) et qui est probablement en train de s’enliser tragiquement en Afghanistan aura la moindre légitimité, sans même parler des ressources militaires et logistiques disponibles, pour pratiquer de façon systématique et soutenue une politique du gros bâton en Amérique latine. »
Que vous inspirent des initiatives comme l’ALBA ou la Banque du Sud ? Forment-elle déjà des alternatives crédibles aux institutions néo-libérales telles que le FMI ou la Banque Mondiale ?
L’ALBA est un projet vénézuélien dont le caractère est extrêmement flou et qui ne représente pas grand chose en termes de poids économique et de volume d’échanges à côté d’organismes comme la Communauté andine ou le Mercosur, pas plus qu’il n’entre en concurrence avec l’UNASUR en termes de perspectives d’intégration politique. Si l’on excepte Cuba, qui est un cas assez spécial, et les minuscules îles des Caraïbes qui y ont adhéré dans le but de bénéficier de certaines largesses pétrolières vénézuéliennes, les pays membres de l’ALBA ont chacun pour principaux partenaires commerciaux des nations qui ne sont pas membres de l’ALBA. Par exemple, pour chaque dollar qui entre au Venezuela, environ 80 cents proviennent des États-Unis, et 20 du reste du monde, dont une fraction infime des pays de l’ALBA. Et les projets d’investissement « durs » de Caracas en Amérique latine ne passent pas par l’ALBA, mais par des mécanismes classiques de coopération et de commerce bilatéraux. Par ailleurs, l’ALBA, qui affirme vouloir favoriser les « échanges non marchands », encadre symboliquement des projets de coopération « solidaire » ou humanitaire cubano-vénézuéliens qui existeraient de toutes façons sans elle. Enfin, si on prend le cas de l’intégration récente et tardive de l’Équateur, qui est l’économie la plus importante de l’alliance après le Venezuela lui-même, il suffit de l’étudier de près pour se rendre compte qu’elle visait surtout à activer et « fluidifier » un certain nombre de projets et contrats bilatéraux souscrits avec Caracas hors du cadre de l’ALBA, et qui se sont miraculeusement « débloqués » une fois confirmée l’adhésion de Quito. Bref, l’ALBA est une arme de la politique étrangère de Chávez et un effet d’annonce passablement surdimensionné, comme beaucoup d’aspects de la geste bolivarienne.
Comment des gauches si différentes que celle de Chávez et Bachelet, Lugo et Morales, Kirchner et Correa, etc. parviennent-elles à coopérer au sein de ces institutions ? L’unité est-elle appelée à durer ?
Parfois, elles n’arrivent pas à coopérer, et ce n’est pas à cause de divergences idéologiques, comme le démontre le cas du conflit environnemental frontalier entre l’Argentine et l’Uruguay à propos de l’installation d’une usine papetière défendue par le gouvernement de Tabaré Vázquez. Vous savez, les gouvernements de gauche sont comme les autres, ils ont peut-être des « amis », mais ils ont surtout des intérêts. La question est de savoir si ces intérêts peuvent être rendus compatibles de façon coopérative, et pas seulement s’affronter à travers une concurrence sauvage. Mais le danger, ça peut être aussi que ces leaders de gauche s’entendent finalement « trop bien » et que les processus d’intégration dépendent exagérément du volontarisme politique de quelques chefs d’État et de la « diplomatie inter-présidentielle », au lieu d’être une construction collective favorisée par des mécanismes institutionnels établis de façon amplement délibérative. Si vous prenez l’UNASUR, par exemple, ce n’est pas en soi un mécanisme d’intégration « de gauche » ou « socialiste ». Pourtant, outre le fait qu’elle est censée comporter des volets de coopération sociale, sa seule existence va dans le sens d’un monde multipolaire (son intervention, par exemple, a joué un rôle important pour désamorcer le conflit régional bolivien et renforcer la position du gouvernement de Morales tout en maintenant Washington à l’écart). Il faut espérer que les pratiques de consultation et de coopération qu’elle promeut s’institutionnaliseront et s’enracineront suffisamment pour survivre aux diverses figures qui incarnent aujourd’hui la gauche latino-américaine.
1 Evo Morales, à Tiwanaku, cérémonie d’investiture Aymara la veille de son intronisation en tant que président de Bolivie.
2 NdA : Cf, cet article.
3 Fidel et Raúl Castro.
4 Intervention de la police à Bagua.
5 NdA : Cf. par exemple : Dora María Téllez, « Le gouvernement a polarisé le pays et la crise économique rend un dialogue national urgent », Problèmes d’Amérique Latine, n°73, juillet 2009, p. 101-115 ; Entrevista a Gioconda Belli, « El Frente Sandinista del 79 tenía alma ; el de ahora es desalmado », El Nuevo Diario, 18-07-2009, plus d’informations ici.
6 Zelaya et Micheletti, au lendemain du coup d’état.
7 NdA : J’en profite pour signaler et recommander au lecteur une exception méritoire, le livre collectif édité par Olivier Compagnon, Julien Rebotier et Sandrine Revet, Le Venezuela au-delà du mythe. Chávez, la démocratie, le changement social (Éd. De l’Atelier, 2009). Notons que cet excellent ouvrage comporte quand même des lacunes importantes, comme la sociologie de la nouvelle élite politique bolivarienne ou la cartographie des réseaux de pouvoir économiques du chavisme ; on ne peut toutefois guère le reprocher à ses auteurs et compilateurs, qui ne sont pas responsables de l’absence apparente de chercheurs disponibles pour explorer ces questions pourtant cruciales.
8 Chávez offrant à Obama l’excellent livre d’Eduardo Galeano, Les Veines ouvertes de l’Amérique Latine, dont Article11 parlait ici.
9 NdA : Il faut savoir qu’aux États-Unis, les médias de référence et les centres d’analyse stratégique n’ont pratiquement pas mentionné ce thème et qu’il est totalement absent des débats politiques publics.
10 Réunion des présidents de l’ALBA en juin 2009 : Morales, Zelaya, Ortega, Chávez, Correa.