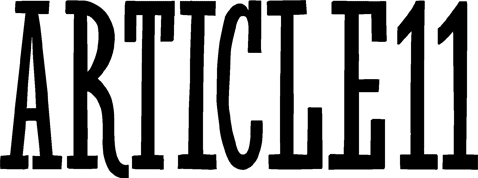Où il est question de Robert Wyatt, de lapins morts, de techniques d’envol, des mystères de la pop et de quelques autres considérations existentielles suscitées par l’écoute amoureuse du grand et barge barde anglais.
Correctif lundi matin : Suite au commentaire de Freakfeatherfall qui a mis le doigt sur une maousse erreur de traduction (bad tripes), quelques passages de cette chronique ont été modifiés.
Première banderille, ce monologue fou, récité d’une voix badine de promeneur étonné :
« Oh, regardez, un lapin mort... Tout écrasé... Complètement écrasé... Oh, il y en a un autre... Et il y a quelque chose dans le caniveau... Oh c’est... Une de ces boîtes en... Hum, polystyrène... Ca ressemble aux... Emballages de nourriture à emporter... Et il y a des frites dedans... Je n’ai pas vraiment envie de finir ces frites... Ce n’est pas banal.1 »
Comme prologue à un morceau cristallin, parangon d’alchimie pop, on a connu plus vendeur. Moins taré. T’as pas forcément envie d’entendre parler de lapins aplatis quand tu te prélasses musicalement en quête de sonorités apaisantes. Tu viserais plutôt des trucs parlant de couchers de soleil, d’amour à la plage – ahou, cha cha cha – ou d’arcs-en-ciel virevoltants. Combien de fois les Beatles ont-ils mobilisé le thème des lapins écrasés dans leurs ballades ? Je te le donne en mille : zéro fois. N’est pas Baudelaire qui veut.
Mais Robert Wyatt peut tout se permettre. C’est le roi. Un croisement entre Robert Desnos et Georges Harrison, orfèvre azimuté décollant vers le ciel aux commandes de ce fauteuil roulant auquel il est condamné depuis une sombre soirée de juin 1973, laquelle le vit basculer d’une fenêtre au quatrième étage vers le plancher des vaches.
LSD, alcool, dépression, tout a été dit sur ce saut de l’ange sans filet, et au vrai on s’en tamponne. C’était peu après l’époque Soft Machine, celle où il malmenait sa batterie comme on polit un galet et où déjà il avait la voix la plus triste du monde. Privé de jambes suite à l’accident, Monsieur Wyatt apprit alors à voler sur son lit d’hôpital en composant Rock Bottom, album tutoyant la stratosphère qu’on ne résume pas d’un simple adjectif – merveilleux, fantastique, génial – parce que ce serait blasphème. Empruntons plutôt ces paroles de « Sea song », qu’un jour j’aimerais lui gribouiller sur une carte postale envoyée depuis une île déserte aux eaux tourmentées, en guise de reconnaissance de dette : « Ta folie s’accorde joliment à la mienne. […] Nous ne sommes pas seuls.2 »
Bref. Revenons à nos lapins. Le préambule en question est tiré de « A beautiful place », morceau beaucoup plus tardif, présent sur l’album Comicopera (2007). Un titre sobre, à l’instrumentation dépouillée – deux guitares folk, une contrebasse, une voix, quelques claquements de doigts –, qui tutoie les cimes de la perfection mélodique3. Comme une évidence. Il chante et l’univers s’ouvre en deux.
Il est toujours difficile de comprendre ce qui déclenche dans un cerveau l’emballement neuronal poussant à remettre encore et toujours une chanson sur le sillon, à l’écouter tant de fois qu’inéluctablement on finira par s’en lasser. Une consolation : dans ce cas précis, ce jour est lointain. En attendant, je m’interroge : pourquoi ce morceau ? Qu’est-ce qui s’accorde si parfaitement à ma propre folie ? L’intonation de sa voix ? La structure mélodique ? Les paroles ? Le sublime dépouillement ? No lo se.
Après tout, c’est une chanson d’apparence très simple. Jusqu’aux paroles qui une fois le préambule surréaliste évacué, se font d’abord presque banales, conformes aux canon pop. « Cela fait des heures que je marche / Une pause serait bienvenue / J’observe les environs / Aucun endroit où se poser4. » On the road, un thème tout ce qu’il y a de plus classique.
Puis sans prévenir débarque l’étrange. Ou plutôt le non-formaté pop. « Il y a un magasin / Qui vend des costumes pour hommes chics / Et un peu plus loin / Un ou deux agents immobiliers / Et un panneau ’vente à emporter’ / Posé sur une porte poussiéreuse / Des clichés éclatants de nourriture / Légèrement passée au micro-ondes5 ».
Allons bon. C’est gris. Méchamment gris. Wyatt décrit un environnement urbain d’une notable morosité. Des snacks et des magasins fatigués. Le genre que tu croises au Kremlin-Bicêtre un après-midi de semaine. Ou à Melun, te dirait Pete. Même « l’église méthodiste » évoquée un peu plus loin, avec son « côté sinistre », ne convoque pas vraiment de décor rieur.
Comme de juste, le morceau se conclut sur un constat désabusé, que je ne te fais pas l’affront de traduire : « It’s a beautiful day / But not here ». Oui, ça n’incite pas exactement à la transcendance.
Alors quoi ? Quelle particularité brandir pour démêler le mystère du magnétisme ?
Eh bien aucune en particulier, en fait. Et c’est peut-être là toute la beauté du constat. Contrairement à des morceaux cultes et virtuoses de Wyatt comme « Sea Song » précédemment cité, ou bien ce « Shipbuilding » qui tirait à boulets rouges6 et éclatants sur la toute fraîche guerre des Malouines, il est quasiment impossible de situer précisément le point d’attraction de « Beautiful Peace ».
« J’aime la pop à mort », a un jour déclaré Monsieur Wyatt. Ce n’était pas des paroles en l’air. Mais ce n’était pas non plus à lire de manière littérale. Selon moi, le message peut se lire ainsi : j’ai beau avoir trempé dans le rock expérimental et le jazz d’avant-garde, je sais bien qu’au fond il n’y a qu’une vérité, qu’une grille de lecture, celle que te renvoie ton âme quand tu touches du doigt le mystère sacré de la Sainte Mélodie et que l’espace d’un morceau tu es immortel. J’extrapole à fond les ballons, évidemment, mais j’y crois aussi un peu. Car c’est bien là l’essence de la pop si tu l’envisages non pas comme une récréation ensoleillée sauce MTV merdique, mais comme art ultime de condensation des sentiments les plus élevés.
Il y a dans la légèreté maîtrisée une dimension qui touche à l’immortel, transcende la triste vanité de ce monde abonné au gris. Les Beach Boys, les Beatles, les Kinks, Lennon solo, tous les monstres sacrés de la pop l’ont été parce qu’ils insufflaient une magie presque paranormale dans des paroles aussi sucrées et niaises que « I want to hold your hand ». Je t’apprends rien, je sais, j’enfile même les perles à vitesse grand V. Reste que ce lieu-commun – le mystère du frisson qui te saute au cou en babillant comme un bébé panda sous kétamine et que la seule raison ne saurait expliquer – ne sera jamais intégralement percé. Et c’est tant mieux.
C’est sans doute après ça que courent tous les fondus de musique. Cette sensation d’avoir trouvé une maison idéale alors même qu’elle est tout à fait brinquebalante et plus sobre qu’un terrier de renard. De se sentir chez soi sans raison, assis comme un con sur ta chaise de bureau grinçante, simplement parce que tes oreilles battent la mesure.
1 Oh look, there’s a dead rabbit,… all flat,… completely flat... Oh there’s another one… What’s in the gutter... oh it’s a… one of those polystyrene… um boxes… that’s all… take away... there’s chips in there… didn’t really want to finish the chips… that’s unusual…
2 You’re madness fits in nicely with my own ... / We’re not alone.
3 A noter : Brian Eno a participé à la composition de ce titre.
4 I’ve been walking for hours, / Needed a rest. / Take a good look around, / Nowhere to rest.
5 There’s a shop / Selling gentlemen’s suits. / Further along / An estate agent or two. / And a take-away sign / Over a dusty door. / Shiny photos of food, /Slightly microwaved.
6 Robert Wyatt fut un temps porte-parole du Parti Communiste anglais.