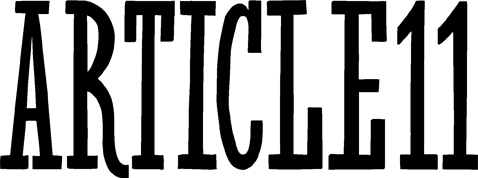Sévice social, c’est normalement les chroniques d’un éducateur de rue dans un quartier populaire de la banlieue parisienne. Sauf que l’éducateur n’a pas toujours été banlieusard : aujourd’hui, l’on plonge donc dans le passé et hors la capitale. Direction la lointaine Lorraine où les gens ne sont pas forcément moins rudoyés par l’existence qu’aux alentours de Paris.
Début des années 2000, dans un foyer Sonacotra situé au cœur d’une zone commerciale un peu sordide ; il y a moins de vieux travailleurs immigrés que de gens un peu paumés, abrutis par les médocs et le chômage d’une Lorraine qui a, comme ailleurs, foiré sa reconversion industrielle. Des grands fous, aussi, depuis qu’il n’y a plus assez de lits en psychiatrie ; des grands fous qui vont une fois le mois prendre leurs narcoleptiques à l’hosto du coin. Et des demandeurs d’asile en attente du précieux papier que la République française, l’universelle patrie des droits de l’homme voudra bien leur offrir pour enfin reconnaître leur qualité de réfugié politique.
Il y a Timur, le titulaire de la chaire d’histoire à la faculté de Grozny, Tchétchénie, spécialiste de la Révolution française et de Robespierre. Les soldats russes vinrent brûler sa maison et lui laissèrent cinq minutes pour aller chercher sa femme et ses deux enfants qui dormaient à l’intérieur. Cachés sous les essieux du premier camion venu, ils étaient si heureux de débarquer à Strasbourg, cinq jours plus tard.
Il y a Durukan, le Kurde de Turquie, militant communiste et partisan d’Abdullah Öcalan, dont le dos reste marqué par les séances de torture, barre à mine chauffée au fer rouge et méthodiquement appliquée.
Il y a des Arméniens et des Azéris qui arrivent presque à se parler, et Magomed, dont le seul rêve est d’avoir des papiers ainsi qu’un petit bout de jardin pour pouvoir faire pousser un peu de paprika. Je passerai mon temps à essayer de lui expliquer que, pour ces deux choses-là, le sol lorrain est aussi peu prodigue que la République française.
Et puis il y a Fikret, et toute sa bande de Bosniaques. Les cousins, les femmes, et tant d’enfants. Les cafés au matin quand nous allons le voir, les clopes de contrebande dont il nous régale, l’atelier de mécanique clandestin qu’il chapeaute pour gratter quelques dizaines d’euros.
Les gosses, comme pour la plupart des demandeurs d’asile, sont sa fierté et son honneur. Élevés à l’école de la République, ils parlent déjà français et traduisent les courriers officiels que reçoivent les parents. Ça ne va pas sans remettre en question la méditerranéenne fonction paternelle, mais au moins, comme ça, ils pourront s’en sortir dans leur nouveau pays.
Et, à tout prendre, on se comprend plutôt pas mal, entre mauvais anglais et allemand bancal. On parle de Tito et de 1914 ; la terre de Lorraine se fait alors le prolongement de celle de Yougoslavie, entre lignes de front et guerres absurdes.
C’est l’hiver et la neige qui tombe sur le plateau fait penser aux montagnes vers Sarajevo ; Fikret pleure déjà en sachant que s’il obtient son statut de réfugié, il ne pourra jamais rentrer dans son pays.
Tous les matins, nous apportons le courrier. Les enfants traduisent les documents officiels et les parents attendent les nouvelles des quelques membres de la famille restés au pays. Fikret nous ressert un café et fait tourner les clopes. Il écrit au pays, aussi : « Je vais bien, ne t’en fais pas », de sa plus belle plume cyrillique.
Ça ne va pas quand il n’y a pas de lettres. Ça gueule contre l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui ne répond pas, alors que putain, le dossier a été envoyé voici huit mois, ça gueule contre la grand-mère qui n’écrit plus et dont on ignore si les Serbes ont eu la peau ; mélange de résignation slave et de mektoub musulman, on reprend un café et j’éprouve la vieille fonction du vaguemestre.
Un matin, le conseil de famille se tient dans les douze mètres carré de la chambre paternelle. Tous les enfants sont là, alors qu’ils devraient pourtant être à l’école ; il y a aussi des femmes et des cousins que je n’ai jamais vus. Les regards sont tendus et mon entrée passe presque inaperçue.
Au bout de quelques minutes, Fikret me remarque et prend la lettre du pays qui pend à ma main. Il la lit, prend un bol et se sert une rasade de liquide jaunâtre. Boit une grande goulée.
Je lui demande de me rejoindre, un peu à l’écart, je baisse la voix : « Tu sais, Fikret, j’ai rien à te dire, mais quand même, un bol de pastis pur à onze heures du mat’ devant tes gosses, je sais pas si c’est le meilleur truc à faire… En plus, t’es musulman, non ? »
Il me regarde, impose le silence et un cercle, m’invite à le rejoindre au milieu. Il commence à parler, dans son français tâtonnant : « Faut je te dise quelque chose, ami. Quelques années, à Sarajevo, vu mon frère tué mort sous mes yeux par mitraillette. Vu sa femme prise nue par soldats et les yeux de ses enfants. Je suis déjà mort, tu comprends, je suis déjà mort. Alors alcool, cigarettes, je sais que mourir plus vite mais, de toute façon, c’est que mieux parce que je suis déjà mort. Tu comprends ? »
Tout le monde me scrute ; silences.
Je souris à Fikret, tends la main vers le bol.