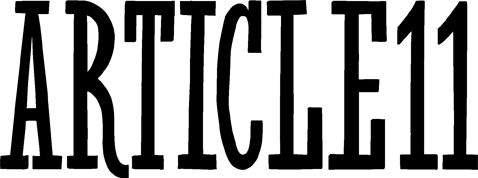Il s’appelle Mark Van Nierop et c’est un fou dangereux. Pendant des années, ce dentiste hollandais a massacré la dentition des habitants de Château-Chinon. Recruté par le Conseil général, il a fait des centaines de victimes, aux gencives explosées. Le scandale a fini par éclater. Avides d’histoires tordues, les journalistes ont rappliqué en masse. Puis ils sont repartis. Le « désert médical » est resté. Premier volet d’un reportage en deux parties.
Ce reportage a été publié dans le numéro 18 de la version papier d’Article11. La deuxième partie, imprimée dans le numéro 19, sera mise en ligne d’ici peu sur ce site.
*
2 septembre 2014. J’en reviens pas. J’en reviens toujours pas de partir au travail. Ça faisait sept bonnes années qu’un événement pareillement déroutant ne m’était pas arrivé. Dans un moment d’égarement, L’Humanité Dimanche m’a embauché pour quelques semaines et, de manière tout à fait curieuse, demande ma présence au bureau. Sidéré par cette invraisemblable audace, j’écoute de très bon matin les infos sur France Inter en buvant un peu plus d’un litre de café. J’en apprends des belles ! Une bien forte ! « Mark Van Nierop, surnommé ’’le dentiste de l’horreur’’, vient d’être arrêté au Canada. Ce professionnel hollandais s’était installé en 2008 à Château-Chinon, dans la Nièvre, un désert médical. Accueilli en sauveur – le village n’avait plus de dentiste depuis six ans –, Van Nierop se transforme en boucher, arrache des dizaines de dents saines, perce des sinus, coud des joues aux mâchoires... Un collectif d’une centaine de victimes se constitue. Mis en examen l’année dernière pour violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, Mark Van Nierop disparaît. Un mandat d’arrêt international est lancé. La police canadienne a mis fin hier à sa cavale d’un an et la justice française demande son extradition. Nicole Martin, la présidente du collectif dentaire, s’est dite très soulagée. En Irak, le Premier ministre... »
Maintenant que j’ai fumé quatre clopes, je peux courir jusqu’au métro.
Au bureau, je me renseigne, parce que me renseigner, c’est mon métier. Plus de 120 articles de presse ont été consacrés au « boucher de la Nièvre », à « Mark l’édenteur », au « dentiste psychopathe ». Je n’avais pourtant jamais entendu parler de cette histoire, invariablement classée dans la rubrique faits divers. Y’avait un truc, pourtant. Quelque chose à creuser. Le truc, c’était le « désert médical ». Ça n’avait rien d’un fait divers, ça. Mais manifestement tout le monde s’en foutait, puisque la même centaine d’articles détaillait gaiement les sinus fracturés, les morceaux de roulette laissés dans les gencives, les AVC sur le siège du cabinet, les mâchoires disloquées des victimes, relevant seulement en passant que Mark Van Nierop était parvenu dans ce « désert médical » par l’entremise d’un « chasseur de têtes hollandais financé par le Conseil général de la Nièvre ».
Ça tenait en une ligne, ça m’a déchaîné.
« Dominique ! On a un putain de sujet ! Y’a un dentiste hollandais cinglé qui a défoncé la tronche de plein de gens dans la Nièvre. C’est un désert médical, là-bas, comme chez moi, en Ardèche ! »
Elle me regarde anxieusement, ma rédactrice en chef. Je me demande bien pourquoi.
« Oui, Pierre ?
- Et ce type a été recruté à Château-Chinon par un chasseur de têtes ! C’est le Conseil général socialiste qui paye un chasseur de têtes hollandais pour trouver des toubibs, et il en a trouvés une cinquantaine, dont ce dentiste marteau !
- Oui, Pierre ?
- Ben, faut qu’on y aille, c’est un putain de sujet, non ?
- T’as raison. Prends la voiture du journal, et file. »
Elle est vachement super, Dominique. Ça trace, avec elle. Et lorsque n’importe quelle idée fumeuse peut lui permettre de ne plus me voir au bureau, elle trouve immédiatement que c’est une excellente idée.
*
Je passe un coup de fil, avant de partir, parce que téléphoner, c’est aussi mon métier.
« Nicole Martin ? Bonjour madame, je suis Pierre Souchon, je travaille pour L’Humanité Dimanche. Je viens de découvrir ce qui vous est arrivé...
- C’est terrible. Il y a encore quelques mois, la police criminelle me conseillait de ne pas me déplacer toute seule, vous imaginez ? Il était fou, Van Nierop ! Vous êtes au courant qu’il a dit aux flics canadiens qu’il avait tué sa femme, en 2006, aux Pays-Bas ?
- Ah bon ?
- Oui, c’est nouveau, ça vient de sortir ! Ça fait qu’ils le renvoient en Hollande et pas chez nous, pour enquêter sur ce meurtre ! Et il y a eu un crime à Autun, dans notre région, il y a quelque temps... Il pourrait être impliqué aussi, ça fait froid dans le dos ! Moi, il m’a arraché des dents saines... Facturé dix-neuf soins en cinq minutes de consultation... On reste sur le dentaire, nous, on ne veut pas faire les justiciers pour la mort de sa femme et l’histoire d’Autun.
- Je comprends... Vous êtes dans la vie active, Mme Martin ?
- J’étais prof d’histoire-géo, je suis retraitée. Ça m’a bien aidée, dans toute cette histoire. Quand vous allez à Paris pour remuer les ministères, voir un procureur ou un juge d’instruction, il s’agit pas de se présenter n’importe comment. C’est pas n’importe qui. »
On a pris rendez-vous, avec Mme Martin. J’étais vachement content qu’elle ait un empêchement le 17 septembre. Du coup, j’ai réussi à négocier de rencontrer ce jour-là et sans sa présence plusieurs adhérents du collectif de victimes. Nous deux, on se verrait le lendemain, et ça m’emballait pas franchement. Dans les médias, on ne trouvait que « Nicole Martin, présidente du collectif dentaire de Château-Chinon » qui intervenait, et généralement ça me court sévèrement, les présidents, délégués et porte-parole qui en plus de la porter la confisquent. Et puis elle avait été prof. Et ça lui avait servi, hein, Monsieur, pour « se présenter correctement » aux magistrats et gens de haute compagnie. Parce que contrairement à un tas de gens, les profs présentent bien, donnent de bonnes leçons, expliquent tout bien, et font une quantité de choses tellement bien que parfois on a envie qu’ils ne fassent plus rien.
Derrière l’abcès
« D’abord, je... Je vous remercie vraiment de me recevoir... Parce que... Enfin, ce que vous avez vécu, c’est... C’est vraiment pas facile, quoi. » Dans la salle Louise-Michel de Château-Chinon, ce 17 septembre, je suis pas tellement à l’aise. Je suis même pas à l’aise du tout face à Sylviane, Danièle, Marie-Jo, Françoise, Tony, Christophe, Denise, Dominique et Bernard, venus expressément pour me raconter leur odyssée dentaire fait-diversière – qui ne m’intéresse pas vraiment.
« Le truc, c’est que je viens d’Ardèche.
- Ah c’est joli, l’Ardèche ! J’y suis allée en vacances !
- C’est le plus beau pays du monde, enfin après Château-Chinon, quoi... Et vous voyez, chez moi, c’est un désert médical aussi. Y’a plus de toubibs, y’a plus de dentistes, et y’a plus rien non plus, plus d’agriculture, plus d’industrie, il nous reste que le tourisme et c’est trois mois dans l’année. Donc y’a plus de boulot pour les jeunes du pays, du coup on est tous obligés de partir.
- Ah ben, c’est comme ici ! Le Morvan était florissant avant, maintenant y’a plus rien...
- Oui, et en fait c’est ça qui m’intéresse. C’est-à-dire qu’en fait, bon, ce qui vous est arrivé c’est hyper dur, et tous les journaux en ont parlé. Ils détaillent les trucs que Van Nierop vous a fait aux dents, mais personne ne parle de vous, de votre coin. Parce que ce que je me dis, c’est qu’un désert médical, ça n’arrive pas par hasard. Et aussi que vos politiques déconnent un peu en salariant un chasseur de têtes...
- Ça, c’est sûr !
- Du coup, j’aimerais surtout que vous me parliez du pays, de vos vies, de si y’a du boulot ici... Parce que l’histoire de Van Nierop, tout le monde la connaît, maintenant, finalement. »
Françoise enchaîne immédiatement, sa vie marquée dans ses traits fatigués :
« Vous savez, notre association représente cette France profonde oubliée depuis des décennies. On s’imagine qu’on est paysans, arriérés, sans aucun intérêt économique... Si Mitterrand n’avait pas été député-maire ici pendant longtemps, y’aurait rien eu. Notre association, elle est née de l’éveil d’une conscience tardive. C’est les sans-voix qui donnent de l’élan...
- Les sans-dents, tu veux dire, comme il a sorti le président ! », se marre Danièle.
L’imbécillité méprisante de Hollande donne le signal. C’est le déluge immédiat des canines foutues en l’air, le terrible festival des défuntes molaires. On n’évite pas un fait divers.
Dominique était éducateur spécialisé à l’hosto. « Ma fille est allée voir Van Nierop pour une carie. Il lui a bousillé 19 dents. Elle a vingt ans, elle est traumatisée. »
Virée à la fermeture de l’usine de caoutchouc locale où elle était ouvrière, Danièle a ensuite été femme de ménage dans les écoles. « Van Nierop a déplombé toutes mes dents saines et scié celles du dessus. Maintenant, je mange sur mon palais. »
Femme au foyer, Marie-Jo a un mari maçon retraité. « Je suis allée le voir pour refaire mes implants. Ça coûtait tellement cher que j’ai raclé tous mes fonds de tiroir, j’ai vendu mes bijoux et des pièces en or... Pour en arriver là où je suis, avec un abcès permanent, et devoir tout refaire... J’ai honte, honte, honte... Je... Je vais te dire le pire. » Un lourd silence. « J’ai une amie parisienne qui a eu un cancer, elle avait les mâchoires abîmées par la chimio – personne ne voulait lui poser d’implants à la capitale... Elle m’en parle : “Attends !, je lui dis, j’ai ce qu’il te faut !” Faut s’imaginer la misère que c’est d’avoir les dents défoncées, on accepte tout. Mon amie débarque ici, Van Nierop lui pose des implants direct. Elle paye au black, elle était ravie ! Un an après, elle me téléphone : “J’ai une petite douleur à l’implant...” Elle retourne voir son dentiste de Paris. Quand il lui a enlevé ses implants, il y avait une plaque de pus de deux millimètres, elle était à deux jours d’une septicémie. J’en ai pleuré : “C’est pas vrai, je t’ai envoyée à l’abattoir...” Elle m’en veut pas, elle dit que je ne pouvais pas savoir. Tu sais, dans la tête de tout le monde, un médecin, ça ne peut pas nuire... »
Christophe était menuisier. « Les anesthésies de Van Nierop, c’était du costaud... Pour te donner une idée, un jour que je sortais de chez lui, je suis resté deux heures assis dans ma bagnole avec les vitres ouvertes, le vent dans la tronche, en plein hiver, avec la musique à fond pour me réveiller ! J’étais chargé comme une vache. »
J’explose !
« Putain, Christophe, mais c’est dingue ! Il t’avait endormi comme un âne ?
- J’étais camé jusqu’aux yeux, il renchérit. Des heures pour me réveiller ! Je sais pas à quoi il nous endormait, cet ahuri, mais je te jure que... Remarque, on aurait dû se méfier. Il t’endormait au rez-de-chaussée, et il montait en courant à l’étage pour soigner l’autre type qui s’y trouvait ! Des allers-retours en courant dans les escaliers, tu vois le truc ? »
J’étais content qu’on arrive à se bidonner, parce que tout ça c’était pas du tout bidonnant, finalement. Mais je piétinais. Je n’arrivais pas à sortir du fait divers, à politiser l’affaire. Politiser, m’a-t-on seriné dans les écoles de journalisme, à grand renfort de colossales considérations sur l’objectivité, ce ne serait pas du tout mon métier. J’essayais, pourtant, cancre accablant, pseudo-intello insupportable, désespérément : « Mais les élus sont responsables, quand même, vous ne pensez pas ? » Et puis : « Est-ce que le problème, c’est pas aussi que la Sécu rembourse presque rien sur les soins dentaires ? » Et encore : « Vous n’aviez plus de dentiste depuis six ans, mais toutes les usines se sont barrées aussi, non ? » Sylviane, Danièle et leurs copains répondaient rapidos, me disaient deux trois trucs pas cons très vite torchés et revenaient sur leurs dents déchiquetées. Mais on s’entendait bien quand même, on rigolait. Au bout de trois heures de récits dentaires hallucinés, j’ai annoncé que je payais ma tournée. On s’est installés à six pour l’apéro chez Nono, à la Brasserie de l’agriculture.
*
Loin de me décourager, les verres de blanc additionnés m’ont propulsé dans de hautes sphères socio-politiques insoupçonnées. J’en ai mis une pleine couche à Danièle, à Denise, à Christophe, Tony et Sylviane sur le thème ardéchois, nivernais et national de la désindustrialisation des pays ruraux, de la disparition des paysans, des toubibs, des commerces, des services publics et des restaurants qui suivaient par conséquent. J’ai pas été déçu de leur retour.
Avant d’être gouvernante chez le sous-préfet de Château-Chinon, Denise, aujourd’hui retraitée, a bossé dans toutes les taules du coin. « À seize ans, je suis rentrée chez Dim, les sous-vêtements. On était 500 ouvriers en 1960, et si tu te plaisais pas chez Dim, t’allais chez Morvan !
- C’est sûr !, dit Danièle, j’y ai bossé, on était 600 ! Puis y’a eu la concurrence des pays où c’est moins cher, on l’a sentie vite, vu qu’on fabriquait du caoutchouc. Y’avait plus que 70 gusses dans les années 1980, puis ça a fermé complètement.
- Pareil chez Dim, reprend Denise, c’est passé à 90 ouvriers dans les années 1980, ensuite c’est parti définitivement en Roumanie. Mais attends, Pierre, c’est pas fini ! L’armée de terre avait ouvert une imprimerie à Château-Chinon, 90 emplois, ils ont mis la clé sous la porte en 2009... La même année que le tribunal d’instance !
- On avait aussi le service des ressortissants résidant à l’étranger, ajoute Christophe pour la peine. Ça a fermé y’a trois ans, 22 postes supprimés. Et les paysans, t’en avais un tas, t’en avais plein quand j’étais gamin ! Maintenant, les rares qui restent, c’est des énormes cheptels, tous les petits ont crevé. »
Je pose une question renversante, parce que poser des questions renversantes, c’est mon métier : « Pourquoi tout est parti en confiture, comme ça, dans nos pays, ici ou en Ardèche, et vachement rapidement, en plus ? »
Alors commence la grande danse du grand flou. « On fait plus rien pour les petits bleds... », « Y’a plus de boulot... », « Y’a des gens qu’on aide et qui ne travaillent pas... » Denise précise un peu l’analyse : « C’est la première fois qu’on voit un président de la République défaire ce que l’autre a fait. Ici, Mitterrand a longtemps été député-maire, puis président. Il a fait venir plein de trucs à Château-Chinon, l’imprimerie de l’armée, le service des ressortissants à l’étranger... Et Sarkozy a tout bazardé ! C’est dégueulasse, j’ai pas peur de le dire. C’est une vengeance. »
Finalement Tony a offert tous les verres, en me remerciant vivement de m’intéresser à autre chose qu’aux dents, de m’intéresser « aux gens ». J’étais flatté, encore plus quand Sylviane m’a invité à manger un bout de gâteau chez elle : « Viens ! J’habite vraiment pas loin. »
Sylviane et le Président
« Regarde, Pierre, c’est Niki de Saint Phalle. Ça aussi, c’est Mitterrand qui l’a fait venir. »
Sylviane me montre des sculptures compliquées avec plein de fer et de flotte, installées juste devant la mairie.
« T’aimes bien, ce truc, toi, Sylviane ?
- Oh... Avec le temps, je suis habituée. »
Un drapeau tricolore flotte sur un bâtiment désaffecté.
« Tu vois, c’était ici, les locaux de l’armée de terre. J’y ai fait le ménage pendant vingt ans, longtemps à temps partiel puis à temps complet, jusqu’à ma retraite en 2010. Ça a fermé un an après. »
L’entrée de son HLM très propret est juste à côté. Un joli chat énorme miaule derrière la porte.
« Mais qu’est-ce que tu fais ? Il est fou ? Garde tes chaussures, les enlève pas !
- Ah non, c’est trop propre ! Un Ardéchois, ça te salirait tout... »
Sylviane rigole, « assieds-toi ! assieds-toi ! » – je suis tout juste installé à la table du salon que je me retrouve en face d’un verre de sangria, d’une tranche de gâteau, d’une pile de documents et d’un dentier.
« Voilà ce que Van Nierop a voulu me poser. T’as vu ça ? C’est un machin de farces et attrapes, on dirait ! Et il m’a arraché huit dents saines... Ça coûtait tellement cher que j’ai fait un emprunt. Elle me tend une feuille. Je remboursais 70 euros par mois, regarde...
- C’est dingue... Mais c’est quoi, ça, “AEP-APE” ?
- C’est l’Association d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l’État, une mutuelle pour les gosses de l’Assistance publique. C’est à eux que j’ai emprunté 1 300 euros pour Van Nierop, parce qu’il n’y avait pas d’intérêts. Ma banque m’en aurait fait payer, et j’avais pas tellement les moyens. »
Sylviane a deux jours d’écart avec ma mère. Deux jours de mars 1950 les séparent. « Ah, c’est marrant, on est vraiment toutes proches ! », Sylviane rigole encore. Sylviane rigole tout le temps, et je rigole aussi, bien jaune en-dedans, en pensant à ma mère choyée par l’existence, au sale gouffre de fracture creusé entre ces deux femmes. Elle emprunte de l’argent pour payer les dévastations de l’autre enfoiré à une mutuelle des gens de l’Assistance, Sylviane, parce c’est de là qu’elle vient, avec sa maman vite morte de leucémie à Marseille, « je ne sais pas où elle est enterrée, peut-être dans une fosse commune », et son père chauffeur routier, « il a eu un accident en levant une roue, elle lui est tombée sur le dos, du coup il pouvait plus faire son boulot ».
Lorsque Sylviane a 11 ans, les services sociaux l’abandonnent aux bons soins d’une famille d’accueil de la Nièvre. « J’aurais pu rester en foyer... Mais je voulais me reconstituer une famille. » Une famille. La dame qui l’accueille dans le Morvan vient elle-même de l’Assistance. Elle était folle, dit Sylviane, c’était une saloperie, et elle n’osait pas dire à son instituteur pourquoi elle avait très mal au dos et souvent des coquards. Une remplaçante de l’instit’ prend un jour les choses en main et réussit à faire parler la petite, « n’aie pas peur, tu peux me dire ce qu’on te fait ». Sylviane se retrouve placée ailleurs. Une autre famille, encore, une famille en or, alors, une famille vraiment ordinaire, avec une « mère nourricière couturière » qui considère Sylviane comme sa fille. « Tu vois, Pierre, elle refusait que je porte les habits de l’Assistance. » Y’avait le colis d’été et le colis d’hiver en provenance de Paris qui étaient censés l’habiller pour l’année, Sylviane, et elles étaient terribles, ces grandes capes noires, ces blouses à carreaux rouges et bleus. Ils étaient repérés tout de suite, eux, les mômes de l’Assistance, et les copains de classe gueulaient bien fort que leur père devait être alcoolo et leur mère putain. La maman, la mère nourricière refusait que Sylviane porte ces saloperies d’habits, elle voulait pas qu’on montre sa petite du doigt, et ses doigts de couturière travestissaient en jolis vêtements les habits infamants, méconnaissables.
Ensuite, il y a eu le certificat d’études, et ciao l’école : « Mon certificat, j’aurais peut-être pu aller plus loin, Pierre, je veux pas me vanter, mais je crois que j’aurais pu faire des études, attention, hein, c’est pas pour me pousser du col. » Le directeur de l’Assistance de Château-Chinon la propulse chez un notaire, bonne à tout faire. Sylviane a 16 ans. « À l’époque, c’étaient des maisons bourgeoises, alors ils avaient des bonnes. On bossait sans arrêt. Le parquet à la paille de fer, les fers à repasser que tu faisais chauffer sur le poêle, les repas à préparer, l’étude qu’il fallait nettoyer tous les jours pendant que le linge bouillait. Ils n’avaient pas de machine à laver parce que ça coûtait, et pas d’aspirateur non plus. Les enfants avaient de la moquette dans leurs chambres, c’est long, tu sais, la moquette au balai-brosse. Heureusement, ils étaient sympas, les trois enfants Migaud, sauf celui qui est connu, là, Didier, tu sais, il est à Paris...
- Celui qui est à la Cour des comptes ?
- Voilà ! C’est son père qui était notaire ici, à Château-Chinon. Didier, il a deux ans de moins que moi. Il était vraiment pas sympa, lui, il se prenait pour un monsieur. Il me criait de lui cirer ses chaussures, à quatorze ans ! “Tu te les cires toi-même !”, je répondais ! Odieux, le gamin. »
Je remarque un tas de bouquins de cuisine sur les étagères. Hop ! Sylviane en met dix en éventail sur la table. « Regarde ! C’est ma passion, ça, Pierre, depuis toute petite ! Je me souviens, un jour que Mitterrand était venu manger chez les Migaud, j’avais 17 ans, j’avais fait une lotte à l’américaine, un gigot d’agneau et deux tartes ! Mitterrand avait adoré. J’étais folle de cuisine, ça m’a pas quitté ! »
Sylviane a quitté la famille Migaud après trois ans et demi de boulot, pour son mariage où elle a « eu le livret ». Parce que le salaire faramineux qu’elle percevait chez maître Jacques Migaud était placé d’autorité sur un livret par l’Assistance, qui lui laissait généreusement de l’argent de poche. Le jeune mari de Sylviane était de l’Assistance, aussi, et il était franchement gâté, lui, pour le coup, de trois ans son aîné : « De son temps, les gosses de l’Assistance avaient encore un collier en bois, des grosses perles de buis avec dessus leur numéro, même pas leur nom, leur numéro. Il a connu ça. Moi, j’y ai échappé. »
Elle est née trois ans après, Sylviane, comme ma mère, seulement deux jours d’écart, mais quand mon papa à moi finissait sa brillante carrière de fonctionnaire, il y avait longtemps de malheur que le mari de Sylviane était mort, à 56 ans, le plâtrier-peintre. Un sale cancer, « certainement avec toutes les peintures et les produits qu’il avalait, on saura jamais ».
Ce qu’on sait, c’est que Sylviane a 1 065 euros de retraite net. « Tiens, regarde, ça se voit bien, la différence entre les deux années : Hollande l’a fait baisser de 35 euros. Et la complémentaire aussi, l’Ircantec. C’est cette feuille-là... Tu vois, là aussi, cinq euros de moins. Je peux te dire que je le sens. »
Ce qu’on sait aussi, c’est que Didier Migaud a été placé jeune, comme Sylviane.
Placé par François Mitterrand à 24 ans chez Louis Mermaz, député-maire-président du Conseil général de l’Isère-président de l’Assemblée nationale-plusieurs fois ministre. Didier a été son chargé de mission-directeur de cabinet-directeur des services-conseiller, et puis un tas d’autres choses très intéressantes, jusqu’à la première présidence de la Cour des comptes. Comme Sylviane, Didier est très économe. « Il se contente au déjeuner d’une salade à emporter. Déjà, quand il était [président de l’agglomération] de Grenoble, il rendait les traiteurs fous en chipotant sur le prix du moindre petit-four »1. Didier n’aime vraiment pas du tout dépenser des sous, du coup il souhaite que les chômeurs et les retraités comme Sylviane « ne soient pas tenus à l’écart de l’effort nécessaire pour redresser les comptes publics »2, alors Sylviane les redresse en baissant nécessairement sa retraite.
Aujourd’hui encore, Sylviane ne rate jamais l’anniversaire de la maman de Didier Migaud.
Elle lui téléphone chaque année pour le lui souhaiter.
Elle est très âgée, maintenant, madame Migaud.
La dernière fois, elle a félicité Sylviane : « On peut dire que vous en avez fait, des lessives ! Vous faisiez un sacré travail à la maison ! »
Sylviane soupire qu’elle aurait bien aimé que madame Migaud lui dise la même chose à l’époque. Mais elle ne faisait pas de compliments, « elle donnait des ordres. C’était Madame, quoi. Tu reprends un peu de gâteau, Pierre ? »
Je me ressers, « t’as un bon appétit ! », elle se marre et moi aussi.
*
« Tu seras encore ici, demain ?
- Oui, le matin je vois Nicole Martin, on...
- Elle est acharnée, Nicole, elle fait plus que ça. Sans elle, on n’en serait pas là. Tu sais qu’au début de cette histoire, personne ne nous croyait ? La gendarmerie voulait même pas prendre nos plaintes ! »
J’ai envie de la voir, maintenant, Nicole.
*

- Gerrit Van Honthorst, 17e siècle
[À suivre dans quelques jours sur le site d’A11. L’article dans L’Humanité Dimanche est – lui – paru le 23 octobre 2014.]
1 Capital, 4 septembre 2014. Dans cette même enquête passionnante, on découvre que Didier Migaud aime manger des pizzas. Ce journalisme d’investigation féroce a ses raisons que la raison journalistique connaît : « Vénéré par les médias français, Didier Migaud est le légat de l’orthodoxie financière élaborée à Bruxelles ou au Fonds monétaire international » (Sébastien Rolland, « La Cour des comptes, cerbère de l’austérité », à déguster dans Le Monde diplomatique, novembre 2013).
2 Europe 1, 17 février 2013.