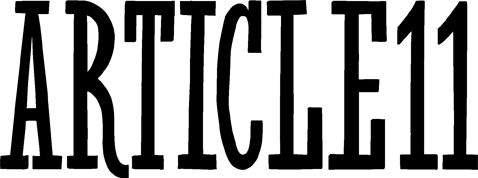mardi 27 décembre 2011
Sur le terrain
posté à 23h05, par
19 commentaires
Algérie, Égypte. À vingt ans d’intervalle, les contre-révolutions se suivent et se ressemblent. Militarisation de la lutte politique, stratégies de gestion par le manque, cooptation de nouveaux acteurs pour figurer la représentation : le précédent algérien, cartel s’ingéniant avec succès à ne pas perdre sa mainmise sur le pouvoir, renvoie par bien des points à ce qui se passe aujourd’hui en Égypte. Parallèle.
L’année 2011 a vu le monde arabe connaître une série de soulèvements populaires qui sont parvenus à ébranler les fondements de régimes autoritaires établis depuis plusieurs décennies. Et l’étonnement qui a souvent accompagné ces soulèvements interpelle à juste titre : dans la mesure où l’illégitimité, le cynisme et la corruption des gouvernements jusqu’alors en place étaient de notoriété publique, où la précarité sociale et économique de la majeure partie de la population de ces pays était évidente aux yeux de quiconque daignait y prêter attention, cette réaction emprunte à l’irrationnel plutôt qu’aux faits. En vérité, la surprise et la méfiance à l’égard de ces mouvements spontanés de révolte traduisent la force d’une croyance fortement ancrée dans l’imaginaire occidental, à coup de déclarations culturalistes et d’analyses tronquées sur la nature tyrannique de l’Islam : les « Arabes » auraient jusque-là naturellement accepté l’inacceptable, soit leur domination par des États réunissant en leur sein des groupes mafieux seulement concernés par l’accaparement du bien public et la perpétuation de leur mainmise sur les outils de la domination.
Comment s’étonner alors qu’en dépit de la violence de la contre-révolution en cours en Égypte, l’attention se porte davantage sur des processus électoraux censés clore la période révolutionnaire en amenant au pouvoir des partis islamistes que sur les moyens employés par les réactionnaires au sein de l’État ? Les observateurs et autres experts oublient à dessein la réflexion éclairante de Pascal Ménoret, selon qui, « plutôt qu’une revanche de Dieu, l’islamisme est une revanche de la société sur le pouvoir »1. Ils préfèrent se replonger avec délectation dans leurs analyses sur la compatibilité des sociétés « musulmanes » avec la démocratie, en ramenant cette dernière au système de représentation bourgeois dont la critique est par ailleurs exclue.
Cette insistance à poser la question de la compatibilité des « arabo-musulmans » avec la démocratie libérale traduit le décalage entre la réalité du terrain et les fantasmes. Les médias s’affolent de voir s’exprimer le conservatisme et le mécontentement social dans un vote qui n’a rien de surprenant puisque s’inscrivant dans une tendance mondiale à l’arrivée au pouvoir de mouvements favorables à l’économie de marché et à l’ordre moral. La mise en œuvre d’une réaction militaire meurtrière en Égypte est au contraire dépeinte comme s’inscrivant dans le cadre d’un retour à la normale et ne génère qu’une légère inquiétude quant au manque de modération du Conseil Supérieur des Forces Armées. Contre pareils errances analytiques, je voudrais mobiliser ici les enseignements hérités de la contre-révolution victorieuse menée en Algérie il y a une vingtaine d’années. Isoler certains facteurs permet de déterminer de quelle manière les mécanismes de défense de l’État ont pu triompher des processus électoraux, de la mise en place d’un champ partisan pluraliste, et se servir avec habilité d’une conjoncture de crise pour rétablir l’ordre.
Configuration révolutionnaire algérienne
L’Algérie a connu tout au long des années 1980 une crise protéiforme, à la fois économique, politique et culturelle. La chute du cours des hydrocarbures a placé l’État-développeur socialiste au bord de la cessation de paiement. Dans le même temps, le sous-prolétariat urbain se trouvait confronté aux problématiques multiples nées d’une transition démographique et économique mal gérée par un pouvoir corrompu : chômage, habitat précaire, crispation identitaire. Dans ce contexte, les organisations relais du régime, le parti unique FLN et la centrale syndicale UGTA,, étaient confrontées à une crise de légitimité croissante, du fait de leur soumission, et donc de leur incapacité à faire écho aux demandes urgentes de la population. Enfin, la nature hétérogène du régime a entraîné une série de confrontation au sommet, impliquant le président Chadli, les prétoriens de l’Armée Nationale Populaire, les technocrates réformateurs et enfin la vieille garde orthodoxe du FLN. Dans ce contexte, le pays a connu une série de contestations tout au long de la décennie, souvent sous forme d’émeutes. A partir de 1986, l’augmentation du prix des denrées alimentaires – majoritairement importées – a encore accentué la pression sur une population déjà précarisée. Le 19 septembre 1988, le président Chadli décida de réagir aux bruits de palais annonçant sa démission pour cause médicales. Il le fit à travers un discours lapidaire prononcé depuis le Club des Pins, lieu de résidence de l’aristocratie militaire situé dans les environs d’Alger. Au début du mois d’octobre, une vague d’émeutes sans précédent, véritable soulèvement de la jeunesse, éclatait dans tous le pays, et notablement à Alger.
À partir de cette date, le régime s’est trouvé dans l’obligation de céder aux exigences pressantes de sa population pour survivre. Il a donc procédé à une ouverture contrôlée, fait adopter une nouvelle constitution en février 1989 et, sous l’impulsion du réformateur Mouloud Hamrouche devenu Premier ministre, soutenu de manière volontariste la création d’une presse plurielle. Dans un contexte international qui semblait annoncer le triomphe de la démocratie bourgeoise et libérale, il s’est conformé aux dogmes esthétiques de la représentation : légalisation d’une myriade de partis (une soixantaine), libéralisation de l’expression et de la critique publique, tenue régulière de scrutins (municipales de 1990, législatives de 1991).
Dans le contexte partisan, les islamistes fondamentalistes du FIS se sont affirmés comme les compétiteurs naturel du vieux système. Ils ont largement profité du contexte de crise internationale alimenté par la seconde Guerre du golfe, en se posant à la fois comme les défenseurs des frères arabes et des lieux saint de l’islam, et comme les pourfendeurs du taghout (tyran) étatique inféodé aux puissances occidentales. Une partie de la population arabophone se reconnaissant dans l’idée de nation arabe s’est appropriée le sentiment d’agression et s’est crispée sur une offre politique défensive et identitaire2. Si l’on ajoute à ce contexte international le charisme des prédicateurs du Front, leur popularité dans les quartiers et la force du sentiment de revanche sociale dont le mouvement était porteur, on comprend mieux son succès aux scrutins de 1990 et 1991. D’autant que les élections législatives de 1991, les premières de l’Algérie libre et plurielle, enregistrèrent une abstention située aux alentours de 40 %.
La suite est connue. Le 11 janvier, les rues de la capitale sont occupées par l’armée et le président Chadli poussé à la démission. Le 12, le Haut conseil de sécurité (HCS) décide de l’annulation du second tour du scrutin. Le 14, un Haut commissariat d’État (HCE) est créé pour parer à la vacance du pouvoir exécutif. A sa tête est placé Mohamed Boudiaf, l’un des leaders historiques de l’insurrection du 1er novembre 1954, rappelé pour l’occasion d’un exil de près de trente ans. Il sera assassiné le 29 juin à Annaba, victime de son empressement à corriger de l’intérieur les vices du système. Le 26 août 1992, un attentat à la bombe à l’aéroport d’Alger officialise l’entrée du pays dans la guerre civile.
Vingt ans plus tard, deux constats s’imposent. D’une part, celui de la permanence du régime, sous couvert d’une représentation de façade. D’autre part, celui de sa capacité à mettre en scène, tout au long de l’année 2011, une série de réformes politiques et de gestes économiques censés parer au mécontentement populaire. La situation de fond n’a pas véritablement changé depuis la fin des année 1980. En dépit de la remontée des cours du pétrole et donc du gaz, le mouvement de protestation agite toujours le pays, à coup d’abstention, d’émeutes et de grèves. L’embellie macro-économique ne profite qu’à un petit nombre, tandis que le malaise matériel et culturel des masses confine à un profond mal-être, fragilisant un peu plus un sous-prolétariat urbain qui vit aux portes du Parlement3. Le mépris des élites (hogra) et leur corruption sont sur toutes les lèvres, ou presque. L’État persiste pourtant dans la même voie, en dépit de la profonde crise de légitimité des politiciens, des institutions et du système dans son ensemble. La fatigue sociale est telle que l’irruption brutale d’un mouvement de contestation ayant une portée mondiale n’a pas suffit à redonner à la population l’espoir d’un changement rapide par le biais de l’action collective. Dans ce contexte, il n’est pas vain de chercher à relever quelques moyens utilisés par la contre-révolution en Algérie.
Militarisation de la lutte politique
La première et, à mon sens, la plus importante des raisons de la réussite de la contre-révolution en Algérie tient dans le rôle capital joué par l’armée dans la gestion de la contestation. L’état-major avait jusqu’alors exercé son influence sans recourir à l’ensemble de son potentiel coercitif. Il laissait aux généraux retraités, aux technocrates et aux politiciens le soin de gérer le pays. Mais l’extrême illégitimité des civils du régime et leur incapacité à gérer la contestation a poussé l’armée à intervenir pour sauvegarder les privilèges de son aristocratie. Elle l’a fait avec les outils qui sont les siens. On a dès lors constaté en Algérie la militarisation de facto de la lutte politique et l’usage de la violence comme moyen de gestion de la société4.
Si le coup d’État de janvier 1992 peut apparaître a posteriori comme le point de départ de l’usage de la violence militaire à des fins politiques, la période qui s’étend de 1988 à 1992 a été le théâtre d’une dramatisation croissante de la situation sécuritaire du pays, utilisée par l’ANP pour servir ses prétentions à contrôler le jeu politique au nom de la défense du peuple, des institutions et de la nation. Dès octobre 1988, les émeutes ont été matées dans le sang par l’armée de terre et les forces de sécurité, celles-ci n’hésitant pas à recourir à la torture et au viol aux dépens des jeunes tombés entre leurs mains. L’armée de terre était alors dirigée par le général Khaled Nezzar, futur ministre de la Défense de Chadli Bendjedid, par ailleurs l’un des principaux artisans de la chute du raïs au nom de la sauvegarde de la démocratie en 1992. Toute ressemblance avec le maréchal égyptien Tantaoui est absolument fortuite...
Tout à son entreprise de dramatisation, l’armée a trouvé dans le FIS son ennemi et partenaire désigné. Le radicalisme teinté de millénarisme du parti fondamentaliste le différenciait grandement des autres mouvements islamistes plus bourgeois et pragmatiques, à l’image notamment du Hamas des Frères musulmans algériens. Pendant la seconde Guerre du golfe, Ali Benhadj s’affichait ainsi en treillis militaire et appelait les jeunes à aller défendre les lieux saint de l’Islam contre la présence occidentale. La même année, les grèves insurrectionnelles de juin offraient une nouvelle occasion d’entretenir la crise pour justifier la répression. Réclamant l’abrogation de la nouvelle loi électorale favorable au pouvoir et des élections anticipées, Abassi Madani donna au président un ultimatum d’une semaine. En réponse, le 5 juin, Chadli instaura l’État de siège et le couvre-feu à Alger, Blida et Tipaza. Finalement, le 30 juin 1991, Ali Benhadj et Abassi Madani étaient arrêtés. Après avoir participé pleinement à l’entreprise de dramatisation du régime, les shuyukh du FIS trouvèrent dans les geôles du régime la récompense de leur action.
La militarisation de la lutte politique s’est poursuivie après le coup d’État, avec l’ouverture en février 1992 de onze centres de détentions dans le Sud du pays. Elle a débouché sur la guerre civile que l’on connaît, dont le bilan extrêmement meurtrier (150 000 morts) ne suffit pas à dépeindre les formes particulièrement horribles de la violence mise en œuvre5. L’État, subordonné pour un temps à l’armée et renfloué par le FMI, est sorti vainqueur du conflit. Pour cela il a eu recours aux techniques classiques de la guerre contre-insurrectionnelle, aux unités spéciales, aux groupes paramilitaires, aux enlèvements, aux centres de torture et aux tribunaux militaires. Il ne faisait en cela que préfigurer les options prises par des régimes soit-disant démocratiques au nom de la lutte mondiale contre la « terreur ». Dans le même temps, la guérilla « islamiste » s’est fragmentée, ses courants politiques étant éliminés et marginalisés (AIS) tandis que ses franges excommunicatrices (takfiri) s’engageaient dans une dérive irrationnelle et meurtrière qui persiste encore sous la forme franchisée d’AQMI.
Plus important encore, la multiplicité des acteurs de la violence et la difficulté à cerner les responsabilités ont contribué à généraliser une posture défensive. Les relations de confiance entre concitoyens en sont sortis profondément et durablement altérés. Cette situation perdure d’autant plus que le règlement bureaucratique de la guerre a empêché toute recherche de vérité, toute fixation des responsabilités. Par exemple, dans le contexte des soulèvements arabes, ce n’est pas la réussite – certes relative – des Tunisiens et des Égyptiens qui attirait le regard en Algérie, mais la guerre en Libye. Lors d’une manifestation du Comité National pour la Défense des Droits des Chômeurs en mai dernier à Alger, je questionnais ainsi les spectateurs sur l’éventualité d’un changement6. Alors que les cohortes de policiers anti-émeute (CNS) circonscrivaient sans peine la petite soixantaine de manifestants, les badauds n’avaient qu’une seule inquiétude à l’esprit : la situation en Libye. Et une affirmation subséquente, synonyme d’une terrible appréhension : « Ici ce sera pire. »
Gestion par le manque
La deuxième stratégie de la contre-révolution algérienne réside dans la capacité du cartel qui tient l’État à organiser la redistribution des ressources en sa possession en entretenant la demande sociale. Il tire ainsi profit de ses carences en terme de services publics pour créer une forme de dépendance à son égard. Soit une véritable stratégie de gestion par le manque reposant notamment sur les obstacles bureaucratiques que l’État est en mesure de poser ou de lever, afin d’imposer une situation d’instabilité et de précarité7..
Cela conduit à entretenir la soumission d’élites soucieuses de préserver leur éminence sociale et économique, et les avantages qui y sont liés. L’attribution des marchés publics et la corruption permettent de répartir les bénéfices et d’étendre le cartel qui tient l’État à de nouveaux acteurs, et d’ainsi élargir le soutien dont il peut jouir par le biais de l’intéressement. Dans le même temps, les classes populaires précarisées sont maintenues dans une situation d’insécurité économique telle qu’il est possible de contenir leur mécontentement par une distribution sociale des ressources. En Algérie, la majorité de celles-ci proviennent de la rente des hydrocarbures - cela ne signifie évidemment pas que seul les états disposant d’une pareille entrée de devise peuvent pratiquer la gestion par le manque. Le plus important est de maintenir la situation de précarité, et donc les carences des services publics. Dans la crise permanente et le manque, l’aumône d’État devient un moyen d’acheter une loyauté temporaire.
La distribution sociale de la rente sous la forme d’investissements massifs permet d’acheter une paix sociale a minima. Elle n’empêche nullement les émeutes. Au contraire, celles-ci deviennent un moyen d’exiger, dans le cadre d’un rapport conflictuel avec le pouvoir qui reste synonyme de dépendance. De son côté, le régime peut mettre en scène sa générosité en répartissant les excédents budgétaires. Le plan quinquennal algérien pour la période 2010-2014 prévoit ainsi pas moins de 286 milliards de dollars d’investissement et la construction de 800 000 logements pour faire face à la saturation du marché. En jouant sur ses ressources et sur la précarité qu’il entretient, le régime peut prévenir une soudaine inflation de la contestation, comme il l’a fait au cours de l’année passée. Après une vague d’émeute en janvier 2011, Bouteflika a annoncé le mois suivant une série de gestes économiques en direction de la jeunesse. Parmi ceux-ci, l’annulation des intérêts sur les crédits destinés aux jeunes et la distribution de 242 000 logements au cours de l’année. Devant un telle démonstration de générosité étatique, le quotidien Ennahar (proche du pouvoir) n’a pas manqué de noter que le raïs « est très au courant des aspirations de la jeunesse » et qu’il est « différent des présidents égyptien et tunisien déchus, Hosni Moubarak et Ben Ali, qui n’avaient rien entrepris pour calmer la colère de leurs citoyens »8.
Cette stratégie de gestion par le manque conduit à une situation paradoxale où les manquements de l’État à l’égard de la population qu’il prétend servir servent la stratégie de perpétuation des groupes qui le contrôlent. Or la capacité du régime à acheter les fidélités ou du moins à calmer la colère populaire par le biais de la distribution de ses ressources suffit à suggérer l’idée de l’omniprésence des khobzistes, ceux qui ont pour seul but la prédation du bien public. Cette suspicion étend l’impression que toute action exercée sur la place publique, même quand il s’agit d’une action de contestation échappant au contrôle des institutions, est liée à la poursuite égoïste d’un bénéfice personnel. Ce sont les motivations mêmes de l’action qui en viennent alors à être dégradées.
Cooptation de nouveaux acteurs pour figurer la représentation
La dernière stratégie notable de la contre-révolution algérienne est la recomposition des groupes qui composaient le cartel aux commande de l’État. Il s’agissait notamment d’en modifier le visage en écartant le président de la République, mais aussi et surtout de coopter de nouveaux acteurs afin de réussir à figurer la « transition démocratique », comprise en fait comme l’établissement d’un système d’allure représentative. La problématique du cartel algérien était alors de réussir à justifier un coup d’État contre une procédure électorale légale et un parti bénéficiant du suffrage populaire. La cooptation s’est donc appuyée dans un premier temps sur la récupération du mouvement de la « société civile » en faveur de la laïcité, notamment à travers le Comité National pour la Sauvegarde de l’Algérie (CNSA). En fait, il s’agissait de recruter parmi les défenseurs de la laïcité des démocrates autoproclamés partisans de la répression des islamistes. Durant la guerre civile, les membres recrutés étaient ainsi d’anciens communistes, des fonctionnaires, des « patriotes » à l’origine de la constitutions des Groupes de légitime défense, ou encore des figures du milieu associatif. Avec le retour d’une paix relative, l’État s’est ensuite attaché à séduire les islamistes modérés pour bâtir le dispositif permettant de verrouiller la représentation à son avantage. Le parti HMS (ou MSP), anciennement Hamas, est ainsi devenu l’un des piliers de l’alliance présidentielle qui soutient la politique de Bouteflika depuis onze ans. Il complète harmonieusement la frange islamo-conservatrice du régime déjà présente au sein du FLN depuis l’Indépendance.
Le passage au multipartisme, présenté comme une condition de la « transition démocratique », implique une extension et une recomposition du cartel. Les partis sont devenus les moyens du recrutement des nouveaux membres et de la répartition du bénéfice, de la mise en scène d’un débat politicien sans enjeu supposé représenter le peuple9. L’institutionnalisation de la démocratie a permis de la conformer aux exigences de l’Ordre, sans régler les questions de fond et sans impliquer davantage la population dans les procédures de décisions politiques. La représentation a ainsi conduit à réduire le politique à la politique, une activité de négociation entre partenaires réglée par les réflexes oligarchiques et bureaucratiques des organisations partisanes10.
Tandis que le ralliement des acteurs au système s’est fait au nom de la raison, du juste milieu (wasatiyya), de l’intérêt général et du retour à la paix civile, le conflit essentiel qui oppose une population privée de son droit à choisir librement son destin et à jouir des trésors de sa terre au cartel qui contrôle l’État n’a jamais été réglé. Les institutions permettent la mise en scène. Les acteurs cooptés y jouent un rôle, certains de bonne foi, et donnent ainsi vie au simulacre. Si ce dernier ne trompe plus grand monde, il suffit à faire perdre foi dans l’idée de changement. En Algérie, la capacité du système à coopter de nouveau membres alimente une croyance presque mythique dans son omnipotence corruptrice. Cette mythologie, qui met en scène un système monstrueux et pervers, contribue à encourager le développement d’un fort sentiment d’impuissance, alimenté de surcroît par la peur d’un retour de la violence et une suspicion généralisée à l’égard des motivations des protagonistes de toute action publique.
Le déroulement de la contre-révolution en Égypte
L’Égypte de 2011 n’est évidemment pas l’Algérie de 1988. Nombre de différences existent entre les deux pays au-delà du gouffre temporel. Pour ne citer que les deux plus évidentes, notons la forte minorité copte et la proximité d’Israël. Il ne serait guère étonnant d’ailleurs que l’un et l’autre fournissent les ennemis intérieurs et extérieurs dont raffolent les discours contre-révolutionnaires en cette année 2011. Dans les deux cas, cependant, l’armée constitue une composante essentielle du cartel étatique. De surcroît, les deux pays ont connu dans les années 1990 une forme de violence takfiri, mais avec une intensité bien moindre en Égypte. Enfin, l’urbanisation chaotique, la crispation identitaire, le désespoir de la jeunesse et les inégalités économiques sont également omniprésents, à Alger et au Caire. La configuration égyptienne reste bien sûr particulière, je laisse aux connaisseurs le soin de la décrire plus précisément. L’objectif ici est d’analyser la contre-révolution en cours à la lumière des trois facteurs précédemment évoqués pour l’Algérie.
Concernant la militarisation de la lutte politique, elle est apparue évidente en Égypte dès la chute de Moubarak : l’État-major l’a déposé et s’est emparé du pouvoir dans la foulée. L’intervention des militaires, qui ont temporairement réussi à faire croire à leur attachement à la défense des intérêts du peuple, avait pour but premier la défense de leurs privilèges. Il n’est guère surprenant de constater que les principes supra-constitutionnels que l’état-major s’est chargé d’établir impliquent que le budget de l’armée ne soit jamais soumis au contrôle du gouvernement ou que celle-ci soit consultée avant toute loi la concernant. Pour protéger ses intérêts, le CSFA n’a eu de cesse d’intensifier la répression en ayant recours aux tribunaux militaires et en pratiquant une coercition de masse dépassant en intensité les pratiques des policiers de Moubarak. Il a de surcroît joint l’humiliation et l’agression sexuelle à la violence. Des photos montrent ainsi un militaire urinant sur les manifestants depuis le toit du Parlement lors des récentes contestations contre le CFSA. Les révolutionnaires sont dans le même temps soumis à des tests de virginité qui ne sont rien d’autres que des viols policiers11.
Pour justifier la militarisation de la lutte politique, l’Etat-major a eu recours à une vieille ruse prétorienne déjà expérimentée en Algérie : la dramatisation. A force de répondre par la brutalité aux exigences populaires, la dégradation de la situation sécuritaire renforce le sens des valeurs d’ordre qui motivent la contre-révolution, au nom de la « sauvegarde de la nation ». Dans le même temps, la dramatisation donne du sens à des discours de justification relevant de la plus complète mystification. C’est ainsi que s’est produit samedi 17 décembre une spectaculaire acrobatie discursive, par laquelle le ministre de la Justice s’est permis de justifier la répression meurtrière aux dépens des jeunes contestataires en qualifiant ceux-ci d’éléments « contre-révolutionnaires ». En Égypte, la dégradation de la situation, favorable aux détenteurs des outils de la violence massive que sont les militaires, leur permet donc de travestir la réalité et de se poser en défenseurs des valeurs tels que la liberté ou l’idéal révolutionnaire, comme les putschistes algériens l’avaient fait en 1992 en s’appropriant la défense de la laïcité. Il est dans la nature même du discours étatique de dégrader les actes des révolutionnaires. Ceux-ci sont alors accusés d’être des voyous, des fainéants, des opportunistes ou encore des victimes d’une manipulation. Ce discours révèle le conflit social propre à la situation révolutionnaire, et fait écho aux craintes d’une élite soucieuse de conserver ses privilèges12.
Avec la dégradation de la situation, la crise permettant la dramatisation, on retrouve sans surprise en Égypte une forme de la stratégie de gestion par le manque mise au service de la contre-révolution. Dès le début du mois de février, alors que le soulèvement contre Moubarak entrait dans sa deuxième semaine, les témoignages de citoyens soucieux de la pénurie grandissante, de la difficulté à faire face à la vie quotidienne, et donc demandeurs d’un retour à la normale, ont commencé à se multiplier. L’agitation révolutionnaire s’est vue propulsée au rang de responsable des carences, alors même qu’elle vise à mettre fin à la situation de domination et d’injustice sociale. Sans surprise, le Conseil Supérieur des Forces Armées, une fois arrivé au pouvoir, a fait du rétablissement de la situation économique du pays son leitmotiv. Face à la récession et à l’image donnée aux touristes, la réponse se résume au rétablissement de l’ordre et au retour au travail. C’est l’argument qui justifie la répression des grévistes et le maintien de l’emprise des militaires afin de sauver le pays. Dans le même temps, l’armée peut faire la démonstration de sa générosité envers la nation dont elle promet de défendre les intérêts. Son pouvoir économique n’est pas à démontrer : les entreprises qu’elle contrôle disposent d’un statut aménagé, ne payent pas d’impôt, et compteraient pour 10 à 15 % du PIB. Compte-tenu de la situation financière catastrophique du pays, elle a récemment accordé à la Banque centrale égyptienne un prêt de un milliard de dollars13.
De fait, la chute du Raïs et le discrédit du PND ne signifient nullement que l’ordre ancien s’est soudainement évanoui. Nombre de ses composantes demeurent, notamment au sein de l’État lui-même. Le maréchal Tantaoui incarne cette permanence, lui qui a été pendant vingt années le ministre de la Défense de Moubarrak. Mais l’armée n’est pas la seule composante du cartel à être persistante. Le Procureur général nommé par l’ancien Raïs est toujours bien à sa place, et avec lui de nombreux hauts fonctionnaires soucieux de préserver leur situation. C’est dans ce contexte qu’il faut prévoir la troisième stratégie contre-révolutionnaire précédemment isolée : le recours à la cooptation pour figurer la « transition démocratique ». Pour ne pas disparaître, le cartel va être amené à se refonder. Des alliances sont alors susceptibles de se nouer, notamment entre les représentants d’une bourgeoisie conservatrice attachée à l’ordre et les composantes sécuritaires de l’ancien cartel. C’est ainsi que Rémy Leveau pronostiquait dès le milieu des années 1990 que la permanence autoritaire des régimes arabes passerait par une alliance entre islamistes bourgeois et militaires14. Sous cet angle, on peut noter la grande prudence des Frères musulmans dans la gestion de la « transition » dont ils savent qu’ils seront amenés à être les grands bénéficiaires. La distance qu’ils ont prise à l’égard de la contestation contre le CFSA illustre leur pragmatisme souvent négligé par les observateurs occidentaux. La façade institutionnelle du cartel est à refaire, et il ne serait guère étonnant que les islamistes et les militaires, en tant que défenseurs naturels de l’Ordre, trouvent un terrain d’entente.
Je souhaite ici m’opposer à l’idée que « les révolutionnaires d’aujourd’hui sont les réactionnaires de demain », pour reprendre la conclusion désabusée de Robert Michels. Simplement : ceux qui profitaient de l’ancien ordre chercheront dans la révolution les moyens de perpétuer leurs privilèges, quitte à nouer de nouvelles alliances et à user de la violence et de la misère comme arguments en faveur de la réaction. Une fois cette observation réalisée, on ne peut que se désoler de constater le peu de soutien apporté aux jeunes Égyptiens qui ont tenté ces dernières semaines de s’opposer à l’emprise du CFSA. Il faut croire que la lutte de ces révolutionnaires pour leur liberté a moins d’attrait que le succès acquis d’avance de formations islamistes, ne faisant pas écho aux fantasmes occidentaux sur la soumission naturelle des masses arabes.
1 Pascal Ménoret, L’énigme saoudienne : les Saoudiens et le monde, 1744-2003, Paris, La Découverte, p 139.
2 Hugh Roberts, The Battlefield, Verso, Londres, 2003, pp 63-81.
3 De la Casbah ou de Bab el-Oued à l’Assemblée populaire nationale, il n’y a que quelques minutes à pied.
4 Luis Martinez, La Guerre civile en Algérie, Khartala, Paris, 1998.
5 En plus de l’ouvrage de Luis Martinez cité plus haut, voir Abderahmane Moussaoui, De la Violence en Algérie, Paris, Actes Sud, 2006.
6 Voir l’article publié le 7 novembre sur A11, « Alger-Ain Bessem : chroniques algériennes ».
7 Lamia Zaki, « Le Clientélisme, vecteur de politisation en régime autoritaire », in Autoritarismes démocratiques et démocraties autoritaires au XXIè siècle (sous la direction de) Olivier Dabène, Vincent Geisser, Gilles Massardier, Éditions La Découverte, Paris, 2008, p 160
8 Ennahar, 24 février 2011.
9 Les travaux de Richard S. Katz et Peter Mairs sur les partis de gouvernement européens les ont conduit à théoriser le modèle d’un parti-cartel. Les deux auteurs évoquent comme caractéristiques notables de ce modèle d’organisation sa dépendance économique vis-à-vis de l’État et son entente tacite avec ses homologues pour s’assurer le partage des ressources et du pouvoir politique. Richard S. Katz et Peter Mair, Changing Models of Party Organization and Party Democracy : the Emergence of the Cartel Party, Party Politics, n°1,1995, pp 5-28.
10 Robert Michels, Les partis politiques, Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties, Flammarion, Paris, 1914
11 Mohamed Elshahed, Urbanizing the Counter-Revolution, Jadaliyya.com, 17 décembre 2011.
12 Voir pour le contexte français la très complète étude de Charles Tilly, La France Conteste, de 1600 à nos jours, Fayard, Paris, 1986.
13 Égypte : l’armée vient à la rescousse des finances de l’État, RFI, 3 décembre 2011.
14 Rémy Leveau, Islamisme et populisme, Vingtième Siècle, n°56, octobre-décembre 1997, pp. 214-223.