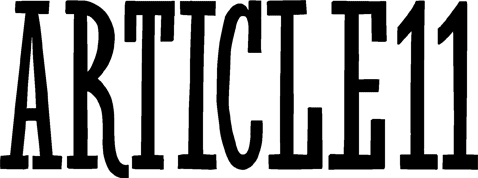mardi 10 juillet 2012
Sur le terrain
posté à 18h35, par
4 commentaires
Alger, jeudi 5 juillet. Jour de commémoration pour l’Algérie, qui fête les cinquante ans de l’Indépendance. Une fête ? C’est selon. Des titres de journaux à une grande soirée de festivités en passant par un cycle de conférences, portrait en demi-teinte - et sur une journée - d’un pays bien éloigné des rêves de ceux qui se sont battus pour le libérer.
L’alarme du portable sonne, emmerdeuse impénitente, maudite sirène qui m’arrache au navire doux et moelleux où je devrais à jamais demeurer. Je me retourne et appuie avec l’énergie du désespoir mon oreiller sur ma tête. Disparais ! Peut-être vais-je réussir à dissiper les vapeurs éthyliques qui embrument encore mon cerveau et mettre au repos les tourneurs-fraiseurs cérébraux qui martyrisent mes tympans. Trêve de poétique indigente, j’ai la gueule de bois, God damn it ! Et de surcroît le jour où l’amie Algérie souffle ses cinquante bougies. En dépit de mon ardent désir de passer les cinq prochaines heures à maugréer dans mes draps et à boire de la flotte, je vais devoir émerger. Il faut sortir et voir, et puis le raconter.
Les journaux
Un bref café et quelques gouttes d’eau sur le visage plus tard, je suis dans la rue. Alger centre, boulevard du colonel Amirouche. Première initiative, en ce jour historique : se procurer quelques-uns de la pléthore de journaux francophones. El Watan a la bonne idée d’organiser trois jours de conférence, pendant lesquels seront distribués des exemplaires gratis ; le journal critique de référence (pour parler comme un membre de la corporation) titre : « Un passé glorieux, une liberté confisquée ». Compte tenu des habitudes de la presse écrite locale, la critique paraît assez neutre. À côté, Le Soir d’Algérie a pris le parti d’habiller sa première page de noir, clamant sans nuance en Une : « Des espoirs fous à la réalité sordide ». Ok... Comme je m’émerveille de cette brutalité, un type arrive, me demande où est Le Soir d’Algérie. Je lui montre. Il sourit, me tape sur l’épaule, en prend quatre et paye le mien en prime. Saha.
La critique s’exprime sur la place publique en Algérie, parfois de manière bien plus radicale qu’en France. De toute façon, la capacité du régime à convaincre la population que tout était bien dans le meilleur des mondes a dû disparaître quelque part au milieu des années 1970, avant même que le Za’ïm Boumédiène ne fasse de même. Plus de trente années de crise économique, sociale, politique et sécuritaire n’aident pas à convaincre les gens de l’intérêt d’un gouvernement. Le cartel qui tient l’État en Algérie est incapable de renvoyer une image positive1, et je soupçonne certaines composantes de ce régime de s’en foutre éperdument. Ce n’est pas un hasard si les officiels faisaient en ce jour la fête à part, du côté de Sidi Fredj, une coquette ville balnéaire où les français débarquèrent en 1830. On ne se mélange pas au peuple, en Algérie, mais on parle néanmoins en son nom.
Ce serait une bêtise, pourtant, que de ne pas prendre le temps de lire le plus grand de tous les quotidiens nationaux, « l’excellent » El Moudjahid, jadis organe du FLN. Sa devise, à jamais gravée dans le marbre de l’histoire algérienne : « La révolution par le peuple et pour le peuple ». Amputé très tôt de la partie critique du cerveau, El Moudjahid sait mettre en scène, avec la plus grande des finesses, son amour du Président. Pour ce cinquantième anniversaire, la première page du quotidien offre une leçon d’iconographie officielle (ou de marketing démagogique) à faire pâlir de jalousie l’équipe de France de football. En haut à droite de la Une, en noir et blanc, une femme au regard inquiet, le visage couvert du haïk traditionnel, incarne le peuple au moment de la guerre d’indépendance. Faisant le lien entre ce glorieux et douloureux passé et le temps présent, son Excellence le Président de la République Abdelaziz Bouteflika tient un drapeau algérien, prenant sous son aile protectrice un enfant accoutré d’un survêtement de l’équipe nationale de foot. En bas à gauche, une grand-mère berbère et sa petite-fille, en costumes traditionnels, attendent, assises, sous la protection du Raïs. Il y a tant à dire sur cette photo – ce sera peut-être l’objet d’un futur papier. Pour l’instant, contentons-nous de remarquer que le passé douloureux, le paternalisme bienveillant, le folklore régional et cette obsession du lien entre les vieux de la famille révolutionnaire et une jeunesse impubère sont autant d’éléments du discours officiel du régime algérien pour ce cinquantième anniversaire.
La conférence
Khallas en ce qui concerne les journaux. Le temps de faire cette lecture critique, et nous sommes arrivés au pied du Maqam E’chahid, le Monument du Martyr qui domine Alger. C’est là que doit se tenir la conférence organisée par El Watan pour le cinquantenaire de l’Indépendance. En prenant le téléphérique, nous découvrons que les transports publics sont gratuits pour l’occasion. Une belle initiative, si ce n’est qu’un agent de la Ratp-El Djazaïr vient de nous faire payer les tickets pour prendre le métro.
Pour ce 5 juillet, le programme de la conférence est avant tout historique. Des professeurs de renommée internationale (dans le milieu des algérianistes, entendons-nous bien) ont fait le déplacement. Pour la plupart, les conférenciers sont algériens, américains ou français. Dans la salle, des gens venus avec leurs enfants pour assister à cet événement. Difficile de ne pas plaindre des petits qui, plutôt que d’aller à la plage, de taper le football ou de mater la télé, doivent se coltiner une journée de palabres sur la guerre juste dans le discours colonial, le rôle des saint-simoniens ou les explications d’un historien communiste septuagénaire sur la création de l’État algérien et l’influence du modèle soviétique.
Du point de vue strictement universitaire, c’est une conférence tout ce qu’il y a de plus classique. Il y a de bons papiers, d’autres moins. La gueule de bois n’aide sûrement pas à se sentir captivé... Quand je sors à midi de l’amphithéâtre où se déroule l’événement, je retrouve des militants croisés lors de précédentes manifestations. Deux d’entre eux m’expliquent leur frustration devant le format de la conférence : « Je ne suis pas venue pour écouter une leçon », « ils parlent de truc qui n’ont rien à voir avec la réalité ». En faisant l’économie d’une explication pontifiante sur les liens entre processus historiques et configurations politiques2, il faut bien admettre que leur frustration fait sens. Les questionnements plus politiques seront abordés samedi. Pour le moment il est difficile d’opérer un lien entre le plan de croisade d’un évêque flamand du XVIIe siècle et le désespoir de la jeunesse algérienne.
« Et en plus, il n’y a pas moyen de poser des questions directement. » C’est vrai. Plutôt que de faire tourner un micro pour que le public puisse interroger les conférenciers, les organisateurs du Watan ont fait le choix de collecter les questions écrites anonymement, avant de les faire remonter sur l’estrade où chacun répond à tour de rôle. À cela, plusieurs explications. D’abord l’idée que, par ce biais, le timing sera mieux tenu, ce qui est le Graal de toute conférence. Il s’agit également de parer à une tendance du public à intervenir pour partager des anecdotes personnelles, sans grand intérêt d’un point de vue de la « Recherche », et parfois à se livrer à une critique sans nuance du travail présenté. Déjà très ancrée en France, cette tendance est d’autant plus marquée quand on parle de l’histoire de l’Algérie tant le sujet est, pour des raisons évidentes, vécu passionnément par tous ceux qui sont concernés.
Ce choix organisationnel parvient à remettre doucement en branle la pénible machine critique qui me sert de cerveau. Refuser l’interaction directe entre les conférenciers et l’assistance lors d’une conférence soit-disant publique n’est pas un choix neutre. D’une part parce que cela permet de censurer certaines questions perçues comme trop agressives, trop polémiques ou tout simplement trop longues et personnelles - cela, des universitaires qui exposent à longueur d’année devraient pourtant pouvoir y faire face et même le mettre à profit. D’autre part, parce qu’en institutionnalisant la séparation entre public et spécialistes, entre profanes et clercs, les organisateurs affirment la structure hiérarchique de la conférence. Dans le même temps, et c’est le plus gênant, ils refusent l’idée que le vulgus puisse s’élever au niveau du spécialiste sans une médiation, sans un contrôle préalable. L’initiative extrêmement louable du Watan ne s’affranchit ainsi pas totalement de cette tendance des élites algériennes à mépriser le peuple, à craindre sa nature anarchique, et donc à ériger des barrages et de hauts murs pour s’épargner un contact trop direct, trop hasardeux.
Le stade
La conférence se termine et, en compagnie de quelques camarades, nous nous dirigeons vers une de ces oasis marquées du sceau « Tango »3 où les Algérois viennent en vitesse et le profil bas se procurer quelques doses d’alcool. Après maintes discussions, et compte-tenu de l’état de fatigue dans lequel Alger plonge naturellement ses habitants, nous ne serons finalement que trois à assister au spectacle officiel qui a lieu au stade du 5 juillet. Le programme parle de lui-même : plus de dix milles enfants et des centaines de comédiens de toute l’Algérie sont mobilisés pour mettre en scène les plus grand moments de l’histoire algérienne, la grandeur de la nation et la participation de la jeunesse pour un avenir radieux. La Corée du Nord attend de voir, confiante dans ses capacités à ne pas pâtir de la concurrence...
Nous arrivons au Stade aux alentours de 20 h 15. La cérémonie a commencé depuis quelques minutes, et le terrain est rempli d’une marée d’enfants qui semblent classés par uniforme, sans qu’aucun ordre ou motif géométrique ne se dégage avec certitude. Le stade est à moitié vide. Je prends peur : ce n’est pas tant que je sois attaché à la mise en scène officielle, mais l’idée d’une cérémonie bâclée par des autorités indifférentes au cinquantenaire me renvoie au titre du Soir d’Algérie. Ce serait, assurément, « un anniversaire sordide ».
Le spectacle finit pourtant par commencer. Deux draps bleus tendus de part et d’autre du terrain par des acteurs qui les agitent pour figurer une mer démontée, des coups de feux, une musique dramatique, le navire français arrive, annonçant la terrible nuit coloniale. S’ensuit la représentation des années de vexation, de déportation et d’exploitation, puis le rassemblement du peuple qui se dresse comme un seul homme face au colonisateur, tandis que l’Armée de Libération Nationale le met en déroute. Passons sur les insuffisances de l’histoire officielle, notamment sur ce mythe forcené de l’union du peuple et du mouvement indépendantiste. La représentation semble susciter l’enthousiasme de ceux qui ont fait le déplacement, c’est le plus important.
Bien sûr, le spectacle parle de patrie chérie, de martyrs, de sang et de douleur. Comment pourrait-il en être autrement ? Mais très vite, la mise en scène de la légitimité révolutionnaire (ou de ses lambeaux) laisse la place aux nouvelles préoccupations de l’actuel pouvoir gérontocratique : l’avenir et les traditions. Les enfants défilent à nouveau, déguisés en papillons, en poneys ou en poulpes. Des adolescents accoutrés dans les uniformes des différents corps de métiers incarnent le futur d’une nation productive. Puis vient le tour des danses de tout le pays (et tout particulièrement du sud) : l’État centralisateur concède à ses périphéries le droit de devenir traditionnelles, typiques, folkloriques. C’est cette culture que l’on aime promouvoir depuis Alger.
Tandis que le stade continue de se remplir, désormais plein aux deux tiers, quelques concessions sont faites aux goût du public. Une vingtaine de danseurs de « hip-hop » surgissent et entament un numéro de danse qui, à bien y regarder, tient surtout de la capoeira. Le stade en redemande. L’un des danseurs, grisé par son succès, oublie de quitter le terrain et doit être rappelé par l’un de ses camarades. Pendant ce temps, quelques spectateurs lancent leurs propres feux d’artifice, et un type dans la tribune en face de moi allume un fumigène. Ce n’est certes pas grandiose mais le stade rugit de plaisir. Je pense à l’un des deux militants qui me disait, le matin même, qu’il avait assisté le jour précédent à son premier feu d’artifice à Béjaïa. C’était, expliquait-il, l’un des plus beaux spectacles qu’il avait eu l’occasion d’admirer de sa vie.
On oublie souvent à quel point le manque de loisir et la routine étouffante pèsent sur les Algériens. Malgré le chômage et l’insécurité, les gens sont particulièrement demandeurs de distractions. Le chorégraphe du show de ce soir en était apparemment conscient. Les danses traditionnels et les enfants déguisés en papillon, ça va trente seconde : il faut envoyer du fun, que diable ! À ce moment-là, l’esprit des cinquante ans de l’Indépendance rencontre réellement celui de l’Algérie contemporaine. Le discours officiel se dilue de lui-même. Assez de martyrs et de souffrance, donnez-nous du spectacle et des voyages ! Une légion de karatekas investit soudain le terrain et entame des démonstrations de katas sur fond de musique japonaise. Au premier abord, on ne voit pas le rapport avec le sujet, mais le plus important est de comprendre que ce besoin d’évasion est constitutif de l’histoire du pays.
Pour finir, les jeunes de l’Armée Nationale Populaire, habillés de blanc, dessinent sur le terrain la forme d’une colombe. S’il y a bien une chose sur laquelle tout le monde tombe d’accord dans un pays qui se relève encore difficilement des années de braise, c’est bien la paix. Les Généraux, qui jouent un rôle essentiel dans la marche du cartel4 qui tient l’État, n’allaient pas manquer de faire endosser à leur institution le rôle le plus consensuel. En même temps, il vaut mieux que les militaires dessinent une colombe, connaissant leur habitudes passées...
Il est 23 h passé et il nous faut maintenant revenir sur Alger centre. Je l’avoue, nous étions tous trop crevés pour assister au méga-concert annoncé. À voir la foule qui quitte le stade en même temps que nous, le sentiment est partagé. Il reste maintenant à trouver un taxi, ce qui sur le papier tient du miracle. Un flic nous dit qu’on va devoir marcher, et que c’est la merde : l’embouteillage au sortir du stade est impressionnant. Au moment de traverser la route, un mini-bus arrivant en sens inverse fait un écart et fonce droit sur nous. Nous l’évitons, non sans un moment de frayeur. Sous le coup de l’énervement et de la fatigue, je peste contre la chère cinquantenaire. Une fois arrivé à bon port et lové dans mes draps, je m’en repentirai. Quelles que soit ses aliénations, ce pays n’a pas son pareil pour vous interpeller, vous remuer, vous transformer. Il est intense, parfois trop. Et addictif aussi, sans que l’on sache jamais ce qui nous fait revenir encore et encore. En tous les cas, en ce jour anniversaire, je peux dire que je suis heureux de le connaître. Tayah El-Djazaïr !
1 Le sociologue, toujours à l’affut de termes aussi précis que pénibles, pourrait parler d’une incapacité à s’euphémiser. Chez Bourdieu, le processus d’euphémisation est largement lié à la notion de pouvoir symbolique. Il recouvre « le travail de dissimulation et de transfiguration qui assure une véritable transsubstantiation des rapports de force en faisant méconnaître-reconnaître la violence qu’ils enferment objectivement et en les transformant ainsi en pouvoir symbolique, capable de produire des effets réels sans dépense apparente d’énergie ». Pierre Bourdieu, Langage et Pouvoir Symbolique, Éditions du Seuil, Paris, 2001, pp 210-211.
2 Foucault aborde la nécessité d’un travail sur les origines historiques des limites socialement reconnues dans un texte intitulé « Qu’est-ce que les Lumières ? » disponible ici.
3 Bière de fabrication algérienne.
4 Sur l’idée de cartel, une explication rapide est donnée par Hamit Bozarslan, dans « Les révolutions arabes. Entretien avec Hamit Bozarslan », Sciences humaines, n°226, 2011/5, p 46.