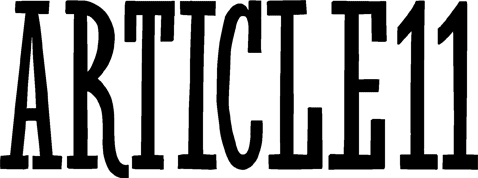lundi 20 septembre 2010
Sur le terrain
posté à 19h57, par
4 commentaires
Décrire le processus bolivien en se focalisant sur la région la moins connue et la plus réactionnaire du pays ? Instructif, voire passionnant. Grégoire a passé plusieurs mois dans les environs de Riberalta (province du Béni, au Nord de l’Amazonie bolivienne), à l’écoute de la lente « révolution » vécue par les communautés paysannes et indigènes. Il en a ramené ce reportage.
Bienvenue au paradis sur terre, dans les provinces du Béni et du Pando, en pleine Media Luna2. Bienvenue - donc - en Amazonie bolivienne, au creux des arbres, là où bat (pour combien de temps ?) le poumon de la planète. Mais : bienvenue, aussi, dans une terre sauvage (capitaliste) d’aventure (néocoloniale) et de périls (multinationaux).
C’est que la formule est malheureusement toujours la même : des ressources (le caoutchouc, puis le bois ou la noix du brésil), des oligarchies qui les exploitent et des peuples qui se soumettent, le couteau (économique) sous la gorge. Un schéma simpliste ? C’est pourtant celui qui tenait lieu de viatique jusqu’à aujourd’hui dans cette région ignorée des administrations et des politiques nationales. Sauf que… les choses sont enfin en train de changer.
L’Amazonie bolivienne, donc. Dans ce coin oublié du reste du monde, une lutte désespérée est menée depuis des siècles par des indigènes allègrement massacrés et par des paysans sous domination des grands propriétaires. Des siècles, et puis… à partir de 1990 et de la première grande Marche pour la Terre, le Territoire et la Dignité, les choses ont commencé à bouger. En 1996, la loi de réforme agraire, dite loi INRA, voit le jour. Cinq ans plus tard, la répartition des terres débute concrètement. Certes, elle est limitée (80 % des terres restent aux mains des héritiers des grands propriétaires, les 20 % non spoliés allant aux communautés paysannes et indigènes) ; mais de rien à un peu, l’avancée est historique. Surtout, elle mérite d’être prolongée.
D’Evo president au massacre de Porvenir
En 2005, dans la continuités de cinq années riches en luttes, Evo Morales est élu président de Bolivie, et initie illico un processus de changement radical sur le plan économique (nationalisations), social (éducation et santé gratuites) ainsi que culturel (reconnaissance du caractère pluri-ethnique de l’État bolivien). Pour aller plus loin, néanmoins, il lui faut modifier la structure de l’État et donc la Constitution. Une perspective qui déclenche l’ire de l’opposition politique : très puissante dans les provinces de l’est du pays, elle met en place une véritable stratégie de terreur pour repousser l’échéance. Les comités civiques3 bloquent ainsi les voies de communications et s’emparent des Institutions et entreprises d’État ; en Amazonie, ils prennent d’assaut l’Institut de la réforme agraire (INRA). La Bolivie est alors dans une situation de quasi-guerre civile, et c’est justement le but recherché : que le pays soit ingouvernable et que s’impose la nécessité d’une (prétendue) « transition démocratique » (et la tête d’Evo au bout d’une baïonnette au passage).
A ce point de l’histoire, les paysans s’organisent, et la fédération paysanne de Pando appelle à une marche vers Cobija. Une marche annoncée comme pacifique avec pour seule arme cuchara, plato y caneco5. Face à eux se rassemblent propriétaires terriens, comités civiques, fonctionnaires des institutions occupées, ainsi que toutes les bonnes volontés désireuses de casser indifféremment de « l’indien », du « paysan » ou du « communiste ». Bref, des miliciens. Eux sont armés par la préfecture, qui leur fait livrer des armes via ses propres véhicules.
11 septembre 2008, dans la localité de Porvenir : affrontement sanglant. Selon la presse locale et nationale, l’agression n’est pas unilatérale, les torts sont partagés ; mais étrangement, les morts ne sont que des paysans… En réalité, c’est un massacre en bonne et due forme : 18 paysans perdent la vie et 65 autres sont gravement blessés. Pendant deux jours, les « civiques » pourchassent les paysans réfugiés dans la jungle ; et une quarantaine de disparus s’ajoute au décompte macabre des victimes.
Pour éviter tout scandale, les civiques procèdent de manière précise : « Ils ont attrapé des paysans et après les avoir tabassés, ils les ont obligé à dire - sous la menace - que nous étions armés, et donc responsables. Tous les médias ont répercuté le mensonge, ici comme dans tout le pays. Et ce sont ces mêmes médias dont ils sont propriétaires ! », raconte avec colère une rescapée du massacre. Imparable ? Oui. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu. L’absence totale de victimes chez les civiques fournit au final la preuve évidente de l’innocence des paysans. De plus, on apprendra rapidement que des mercenaires venus du Brésil ont été embauchés pour l’occasion et que les armes venaient d’Équateur (via les circuits du marché noir et de la drogue). Et aussi - cerise sur le gâteau empoisonnée - que la CIA a financé l’opération, via sa déjà trop fameuse Agence Internationale pour le Développement, ou USAID.
Au final, le massacre de Porvenir constituera l’un des points culminants d’une sombre page de séparatisme insurrectionnel, et débouchera paradoxalement sur la cessation - provisoire - des troubles dans le pays. L’ambassadeur des États-Unis - coordonnateur central de l’opération depuis le bureau officiel de la CIA en Bolivie - en fera d’ailleurs les frais, expulsé par le gouvernement de Morales. Quant à la machination, elle ne portera pas ses fruits : quelques semaines plus tard, la nouvelle constitution de l’État plurinational de Bolivie est adoptée à 70 % des voix, avant qu’Evo Morales ne soit triomphalement réélu en décembre 2009 avec 65 % des suffrages.
Yes we can / Ya viene el tiempo del cambio
D’un point de vue électoral, le Movimiento Al Socialismo6 n’a cessé de prendre du poids dans les provinces de la Media Luna, jusqu’aux municipales et régionales de mars 2010 qui lui ont donné le pouvoir dans six régions (contre trois avant les élections), notamment dans le Pando et dans certaines villes du béni comme Riberalta. Mais il serait malvenu d’euphoriser outre-mesure ce renversement électoral : en devenant un parti de masse, le MAS (sans mauvais jeu de mot) a admis en son sein des opportunistes corrompus afin d’élargir sa base électorale. Il reste d’ailleurs un parti pyramidal traditionnel, et les luttes en son sein sont intenses pour tenter d’imposer par le bas une véritable représentation populaire.
Pour autant, le renouvellement politique récent ne doit pas être non plus négligé : dans cette région, qui reste une des plus pauvres du pays, la population semble désormais dire tout haut « Ya Basta ». « Riberalta a 100 000 habitants et c’est le centre économique bolivien de l’exportation de la noix du Brésil, mais seulement 20 % de la population dispose de l’électricité. La ville n’a toujours pas d’eau potable, alors qu’elle est inondée la moitié de l’année par les pluies tropicales. Les déchets infestent les rues de terre, toujours pas goudronnées, les maladies (paludisme, dengue …) restent virulentes et la misère est omniprésente dans les quartiers périphériques », m’explique un habitant de Riberalta, ajoutant :« Mais on s’estime heureux parce qu’ils y encore pire : le Quart Monde ». Ici, on se contentera donc d’être du Tiers.
Ce n’est pourtant pas faute d’argent. Outre la noix du Brésil, la région est une des mieux dotées par l’État en terme de subventions ; mais ces dernières bénéficient toujours aux mêmes privilégiés. Les détournements de fonds se chiffrent en centaines de milliers de dollars, et la justice récemment réformée reste une justice de classe. Soit l’envers noir d’un tableau faisant sinon la part belle aux soins et à l’éducation gratuits, aux aides aux femmes enceintes et aux personnes âgées – liste non exhaustive. Autre avancée : le lancement de l’entreprise bolivienne d’amande (EBA), façon pour l’État de prendre en main la production et de casser la domination des familles oligarques, tout en garantissant un prix d’achat plus élevé pour les producteurs. Malheureusement, un demi-succès. Voire un échec : « le prix de vente de la noix du Brésil a bien augmenté, mais le paysan reçoit toujours la même somme » Où est passé tout cet argent ? Pas à chercher bien loin : les industrieux locaux et les cadres du MAS ont pris du poids dans l’entreprise...
Le changement arrive aussi par d’autres voies moins directes, comme cette grande Marche des peuples originaires d’Amazonie. Le but ? Faire entendre la situation dramatique des peuples amazoniens, qui se considèrent encore comme les oubliés du processus. Sauf qu’une semaine plus tard, le gouvernement fournit la preuve que la marche a reçu des financements… de l’USAID, officine de la CIA. Oui : on n’en sort pas…
Des ONG et des lois
La lutte pour la titularisation des terres prend des formes peu communes en Amazonie, notamment grâce aux organisations non gouvernementales. Mais attention : il ne s’agit pas de ces organisations, si nombreuses en Bolivie et au Pérou, qui combinent la politique d’assistanat (si l’ONG s’en va, il n’y a plus rien) à un néocolonialisme larvé. Non, il s’agit d’organisations boliviennes, qui s’affirment comme les (presque) seuls instruments de changement face à l’atonie et au blocage total de cette société patronnée. Elles ont contribué, durant les années 1990, à la création et à la constitution des organisations dans les communautés, des syndicats paysans et des coordinations de peuples indigènes, sans lesquels peu de changements seraient aujourd’hui possibles. Ces ONG ont d’ailleurs été particulièrement visées - plusieurs sièges incendiés par les civiques - lors des évènements insurrectionnels de 2008 et la plupart d’entre elles ont dû quitter la région - voire le pays.
Les luttes pour la terre ont également un aspect très légaliste. Aussi imparfaite soit elle, la loi INRA est la seule base juridique qui existe actuellement face à la toute puissance de l’oligarchie : la majorité des communautés disposent enfin d’un titre de propriété collectif sur leurs terres. Après des siècles de spoliation, c’est par la voie légale que les communautés paysannes et indigènes d’Amazonie vont enfin pouvoir donner sens à la formule consacrée : « La terre est à ceux et celles qui la travaillent. »
La bataille n’est pas gagnée pour autant. Les propriétaires héréditaires, aristocratie du coin, cherchent à maintenir la limitation maximale de l’étendue des propriétés à 30 000 hectares, pas moins. Mais les communautés exigent que l’on revoie la copie : « Ce ne sont pas ces propriétaires qui travaillent ces 30 000 hectares, ce sont les gens qui travaillent pour eux. Couper un arbre ce n’est pas travailler la terre ». Les paysans cherchent à l’inverse à étendre leurs terre. La lutte victorieuse des années 2000 s’ancra ainsi sur la question des « 500 hectares ». La loi reconnaît désormais qu’une communauté doit au minimum disposer d’un territoire de 500 hectares.
En Amazonie, il fait « bon vivre »
Pour les communautés cherchant à préserver leur territoire et à empêcher le désastre écologique, il y a un besoin criant de protéger ce qui reste et de sauver ce qui peut encore l’être. En 2010, l’organisation regroupant paysans et indigènes amazoniens (la BOCINAB) a ainsi porté les revendications des communautés et de la société civile à la conférence de Cochabamba7.
Désormais, le changement climatique affecte directement les populations locales : dans certaines communautés, la moitié des dernières récoltes de riz ont été perdues, ici à cause d’une sécheresse précoce, là-bas à cause des inondations tardives. C’est justement ces populations affectées directement qui demandent désormais des comptes aux responsables : les pays industrialisés et les multinationales. Surtout, au delà de la critique radicale du système capitaliste et du productivisme, de nouvelles formes de développement sont expérimentées. Ainsi de la « gestion intégrale des forêts », consistant à appréhender la forêt comme un organe vivant qu’il faut respecter et non plus comme un stock de ressources à exploiter. En sus du riz et de la yucca (manioc) qui fournissent l’alimentation de base, les familles rurales diversifient peu à peu leurs productions, se rapprochant ainsi de la souveraineté alimentaire. Si toutes réclament l’accès aux besoins basiques - eau électricité, santé, éducation -, elles exigent que ces progrès ne se fassent pas au détriment de l’environnement et de leurs savoirs ancestraux.
C’est ce processus de progrès/sauvegarde qui est en jeu aujourd’hui dans toute la Bolivie. Le concept de « vivir bien », le bien vivre, articule les revendications, situation dont l’Amazonie donne l’exemple le plus marquant. Le vivir bien est difficile à décrire : il ne s’agit pas de décroissance, de réduction du mode de vie à ses besoins vitaux, étant donné que les besoins vitaux ne sont toujours pas satisfaits. Mais ce n’est pas non plus un développement économique du tiers-monde, à la brésilienne. Le processus prend ses racines dans le mode de vie communautaire, traditionnel des paysans et indigènes qui l’expliquent très bien eux-même : « vivir bien, ce n’est pas mettre au centre de tout le profit, comme avec le capitalisme, ni l’homme, comme le veut le communisme : ce qui prime, c’est la vie. La Terre n’a pas besoin de l’Homme pour vivre mais l’Homme a besoin de la Terre pour exister », ce que l’Amazonie leur rappelle constamment. La Terre, ils en tirent leur habitat, leur nourriture et leur mode de vie.
Il y a un mois, dans la communauté Villa Union, des indigènes à la peau blanches, m’expliquent ce qu’est l’identité joaquinienne (de San Joaquin). Je leur demande alors ce que signifie être indigène : « c’est avoir une culture, une langue, des traditions, c’est travailler et vivre de la terre, vivre avec la terre. Et puis, les indigènes ils sont comme ça, comme nous, un peu moches, enfin indiens, tu vois quoi », me dit Tiburcio dans un éclat de rire. Son frère raconte comment il a fui San Joaquin et la peste qui, dans les années 1980, extermina des villages entiers. Il explique ensuite comment il est venu former une communauté ici, rassemblant les Joaquiniens dispersés. Il prit en charge « deux années durant l’éducation des enfants sans le sou, alors que la mairie ne voulait pas me donner de salaire ». A sa suite, un autre frère de Tiburcio fustige « cette jeunesse qui oublie tout, qui perd nos valeurs morales et nos traditions et se fait envahir par la culture étrangère ». Vieux cons ? Même pas. Ceux qui me parlent ne sont pas seulement les fondateurs de la communauté, ce sont aussi les membres du groupe de musique Los Pinchones ; ils ne tardent pas à se lancer dans un air traditionnel, armés de flûtes, bombilla, tambourins et castagnettes. Eux le disent bien mieux que n’importe qui : « On vit tranquille ici, on vit bien ».
Grégoire est étudiant en journalisme à Toulouse et a travaillé 4 mois au sein d’une institution d’appui aux paysans et peuples indigènes du Béni et du Pando, produisant un programme de radio communautaire, à Riberalta, Bolivie.
1 Une version différente de ce texte a déjà été publiée sur Alter-info, ici. Si le début est similaire, la suite ne se focalise pas sur les mêmes problématiques.
2 Plus de 60% du territoire bolivien se situe dans les terres basses de l’est du pays formant la media luna (demi lune), (Béni, Pando, Santa Cruz, Tajira). Au nord de celle-ci : l’Amazonie.
3 Organisations dépendant des préfectures régionales, et rassemblant bien souvent le « gratin » de la droite et de l’extrême droite locale.
4 Hormis celle-ci, toutes les photos sont de Grégoire.
5 Cuchara plato y caneco : tradition des mouvements sociaux boliviens, chacun amenant sa cuillère, son assiette et son verre, tandis que le syndicat gère la nourriture. L’expression est également le titre d’un documentaire réalisé par le syndicat paysan local sur le massacre de Porvenir ; le présent article y a pioché une partie de ses informations.
6 MAS, parti d’Evo Morales.
7 N.d.R. : voir sur Article11, les articles de Grégoire traitant de la conférence de Cochabamba, notamment ici, ici et ici.