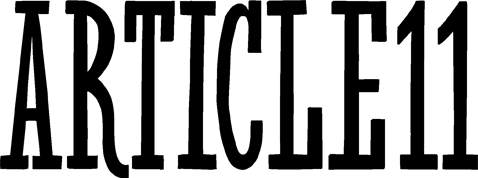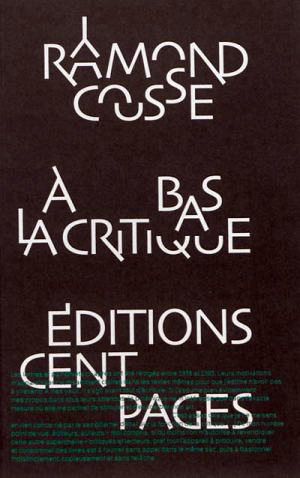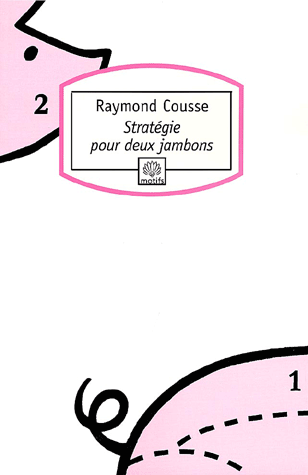lundi 23 février 2015
Littérature
posté à 20h27, par
11 commentaires
Ignoré en son temps, le ténébreux, l’intègre, l’audacieux Raymond Cousse s’est suicidé à 49 ans. Dans le silence. Depuis, pas grand monde ne s’est attardé sur son œuvre. Cela en vaudrait pourtant la peine.
« Donner aux exploités le sentiment que leur utilisation est leur propre élévation est le vice suprême des exploiteurs. »
(Raymond Cousse, Stratégie pour deux jambons)
*
Le murmure des voix macabres : Raymond Cousse y a cédé un nuit de 1991, où il mit fin à ses jours après une fête de réveillon. Cousse n’était pourtant pas lâche. Il y allait comme aucun autre, frontalement quand la forme le commandait, avec plus de subtilités en d’autres occasions. Il faisait mouche à chaque fois, alignant pour le compte ses ennemis, victimes d’un art subversif qu’il avait élevé à des exigences morales qu’à pareille époque méprisaient les cuistres et les dévots des lettres, les professionnels en léchouille de babas, les coureurs de dotes littéraires, toute la sainte putasserie qui faisait en France, la meilleure exposition médiatique et la Légion d’honneur...
Cousse m’est tombé dans les mains au début du siècle. C’est-à-dire en plein cœur de cette inversion du monde induit par le totalitarisme du profit. Tout menaçait d’y être aliéné, jusqu’au plus petit détail, et aucun des mots qu’on se cherche à vingt ans - « sentiments », « amours », « espoir » - ne recouvrait le moindre sens, même pour un homme ou une femme ayant passé l’essentiel de sa vie à les chercher inlassablement dans les interstices qui laissent passer la lumière ou sur un visage qui n’était en fin de compte pas disposé au « crime » qu’exige la totalité triomphante pour arracher à cette vie le peu qu’on lui consent. J’étais sot dans ma vingt-troisième année, et vierge, y compris de tout soupçon d’avoir à faire la putain. Je n’étais pas bien beau, et c’est pourquoi Cousse m’est tombé dans les mains au début de ce siècle. Là où mènent les chemins de la disgrâce, il y a la terre fraîche du caveau, les cellules froides de béton, la rue et la mendicité ou la littérature. J’ai lu après avoir dangereusement frayé avec toutes ces alternatives qu’offre avantageusement le régime totalitaire des margoulins souriants qui font la morale pour le voile, la sécurité routière, le tabac, l’alcool, etc., et qui font main basse sur tout ce qu’ils peuvent à loisir pervertir.
Je me souviens de cette pièce de la rue Mercœur, à Nantes, qui était le plus souvent le lieu de fêtes, « ces petits suicides collectifs », comme disait Calaferte. C’est là que j’ai vu, cigarette au bec, regard franc, le visage de Cousse, sur la couverture d’un ouvrage qu’un ami me recommandait de lire. Un ami qui en était encore un, avant qu’il ne réussisse à son tour dans les affaires du monde en se changeant imperceptiblement d’une façon qui convient pour y réussir, c’est-à-dire en faisant profession de la parole quand on en a moins, en multipliant les amours quand on est moins sincère, en jouant habilement des ressorts de son humanité quand on en est moins pourvu.
Cousse, donc. Raymond Cousse vitupérait si bien qu’il n’a eu de reconnaissance qu’à l’étranger. Sa pièce Stratégie pour deux jambons1 a ainsi connu un succès international. Mais en France, le public et la critique l’ont méthodiquement ignoré. Il est vrai que le public est moutonnant, il fait généralement où on lui dit de faire, comme Cousse n’aurait pas manqué de souligner. Quant à la critique, aux Lettres, sous la plume vitriolée de Cousse, ça ne fait pas dans la demi-mesure, dans la circonspection, ça ne s’embarrasse d’aucune « complexité », ni d’aucune exceptions à une règle qu’il dépose nette, précise et tranchante : « Telle est de nos jours la recette de la gloriole littéraire. Elle découle du banal constat que partout, toujours, ce sont les plus pourris, les plus nuls, les plus lâches et les plus salauds qui l’emportent. » Et d’ajouter un peu plus loin, dans la préface d’À bas la critique !, une de ces noirceurs qui ne sont effectivement jamais convoquées au tableau d’honneur médiatique : « Je sais aujourd’hui qu’il est impossible de se vomir jusqu’au bout sans vomir simultanément l’espèce entière. »
C’est qu’il les avait taillés en pièce, les critiques courus de l’époque. Il leur adressait des lettres senties, imparables, drôles et percutantes, des lettres accompagnées de jambonneaux ou de capotes anglaises. Pivot, Ezine, Nourissier ou Rinaldi : aucun ne lui a jamais répondu. Ces pamphlets corrosifs et terriblement intelligents forment l’édition présente d’À bas la critique !. Elle s’évertue à démontrer une évidence plus criante et plus désespérante aujourd’hui qu’au temps de Cousse, à savoir que le mercantilisme le plus poussé s’appuie sur des fondations idéologiques qui travaillent à la disparition, à l’étouffement, à la mise à mort de toutes subversions, et la valetaille qui tient lieu de critique y est si manifestement indispensable qu’elle se trouve largement rétribuée pour ces services.
« L’espèce » humaine que haïssait Cousse, c’est l’espèce aliénée, l’espèce dans toute la suffisance de son aliénation. Pompier à la Bibliothèque nationale, le futur écrivain dévorait les livres de Beckett. Il en naîtra une amitié orageuse - malgré les efforts de Beckett. Cousse fut encouragé à écrire, élogieusement commenté, aidé matériellement, par l’auteur d’En attendant Godot. Mais ses coups de gueule et son goût immodéré pour la boisson ont porté ombrage à cette amitié.
« Je hais l’espèce humaine en général, écrivait Cousse, mais ne puis m’empêcher de l’aimer dans le détail. Je tourne en rond dans cette névrose. J’ai cent raisons de ne pas me suicider, mais aucune de survivre. »
On peut supposer que Cousse a trop tôt éprouvé sa propre solitude affective, morale et intellectuelle face au déchaînement de forces contraires. On peut aussi se demander s’il n’a pas mal passé un cap, celui marquant le passage d’une époque transgressive à une époque régressive, de l’âge libertaire au « néo-fascisme ». Il avait à peine 30 ans dans cette période d’effervescence politique et créatrice, et une fois le souffle révolutionnaire retombé, une fois la seule alternative possible au régime de terreur enterrée, la fascisation progressive de cette société l’a peut-être glacé. Pour un sensible comme l’était ce fumeur et ce buveur invétéré, les signes de l’amoncellement progressif de la jeunesse, des illusions et de « la parenthèse enchantée » (qu’était l’avant et l’après 68) ont dû être perçus avec acuité, impuissance et dégoût.
C’est la parole qui distingue l’Homme de l’animal. Et le cochon de Stratégie pour deux jambons qui la prend à proximité de l’abattoir n’était ni tout à fait bête, ni sûrement fasciste (puisque le fasciste est bien doté d’une parole, mais déshumanisée).

- Peinture de Zoo Project, Belleville
Dans ce roman, on suit un cochon dont la vie est réglée dans ses moindres détails. Elle est pré-destinée, de l’engraissement à l’abattoir, dans un réduit de deux mètres carrés : « L’endroit que j’occupe suffit à mes besoins comme à la satisfaction de mes désirs. Je ne saurais dire si la longueur du local l’emporte sur la largeur, ou vice versa. Mais il me plaît d’imaginer que la largeur ne le cède en rien à la longueur. Je ne sais pourquoi, l’idée d’exercer ma liberté à l’intérieur d’un carré m’est d’un précieux réconfort. »
Dans Les thèses sur Feuerbach, Marx précise que l’esprit religieux est à la fois « EXPRESSION de la misère réelle et PROTESTATION contre cette misère ». Le cochon philosophe et « religieux » malgré lui de Stratégie pour deux jambons exprime les solides principes qui l’ont guidé pour atteindre au but de toute une vie : livrer à l’humanité des jambons de premier choix, pour l’honneur de la race porcine. Mais il proteste aussi contre le porcher qui vient régulièrement saper son intimité. La métaphore est évidente, et dit encore beaucoup aujourd’hui de l’effondrement progressif et inéluctable de la société marchande.
En somme, Cousse ne pouvait rien dire qui fût entendu, éprouvé et qui change à la fois le destin individuel d’un auteur ignoré de tous (en France) et le destin politique, littéraire et social d’une société avançant déjà en marche triomphante vers ce que nous connaissons, en 2014, de plus profondément régressif sur le plan politique, littéraire et social.
« Essayez, si vous le pouvez, écrivait Jacques Rigaud, d’arrêter un homme qui voyage avec son suicide à la boutonnière. »
*
Extraits de À bas la critique ! (lettre adressée à Bernard Pivot – octobre 1978) :
« Écoutez, Bernard Pivot, il y a un mois je vous ai envoyé un livre, ça s’appelle Stratégie pour deux jambons, l’histoire d’un cochon qui raconte sa vie à huit jours de l’abattage, avec gros travail sur le langage, aperçu philosophico-politique par-derrière et rigolade tout du long.
Aussi, quand j’ai appris que vous faisiez une émission sur l’amour, j’ai pensé que vous réclameriez mon concours, à cause des performances du verrat, dont je parle abondamment dans mon livre. (Saviez-vous, et la France sait-elle, que l’éjaculat d’un verrat atteint le quart de litre ? Je vous jure je ne me vante pas, c’est dans tous les manuels). Au lieu de quoi, nous avons eu droit à de la périphrase, des minauderies, des sourires à peine grivois, quelques bouches en cul-de-poule tout au plus. Mais pour ce qui est de dire la vérité aux Français, je veux dire le nombre et la quantité, rien, absolument rien. Si c’est ça l’amour, reconnaissez qu’il y a de quoi s’en retourner la queue entre les jambes.
Pourtant je ne vous en veux pas. La preuve, je vous envoie mon meilleur jambonneau afin que le plaisir de la dégustation soutienne celui de la lecture. »
*
En rapport sur Article11 :
De l’art (et) du cochon
Gilles Châtelet : un berger-voyou dans la porcherie
*
Illustration de vignette / détail de « Fiesta pig », d’Andy Warhol (1979) :