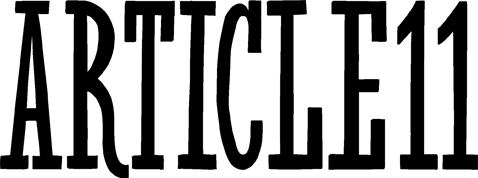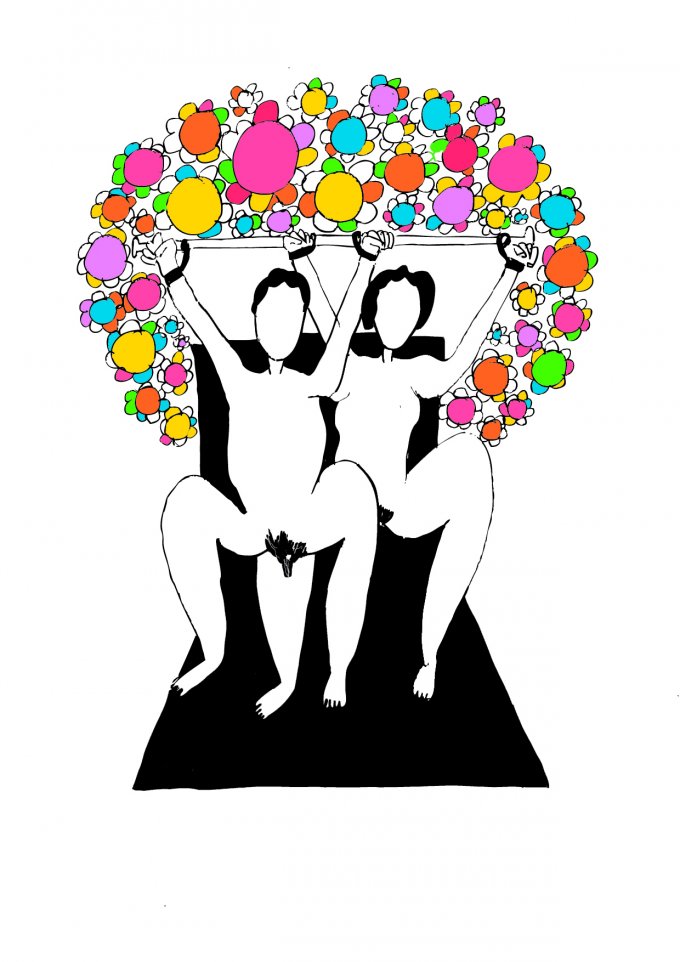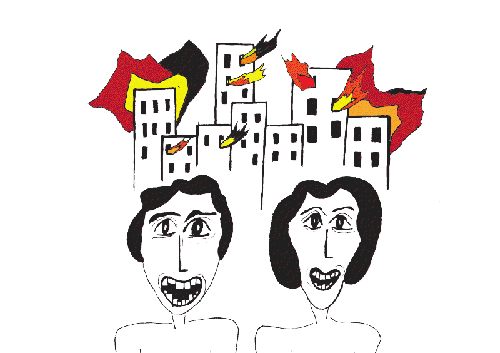jeudi 27 octobre 2011
Textes et traductions
posté à 10h25, par
22 commentaires
À Article11, on est des grands pudibonds. On ne parle jamais de sexe ni d’amour. En grande partie parce qu’on ne pense pas avoir grand chose de constructif à dire sur la question. Alors, quand l’ami Mathieu K. nous a envoyé ce texte très personnel et illustré des dessins de Cécile Kiefer, fruit d’une longue réflexion sur la notion de couple et de vie commune, on a sauté sur l’occasion. Welcome Cupidon.
Un après midi à la terrasse d’un troquet rock’n’roll. Un soleil pousse-au-crime qui donnerait presque à mon café allongé un goût de pression bien fraîche. Le trafic incessant et son bordel grossier, les trottoirs de la ville arpentés par la foule comme les escalators en panne d’un supermarché à ciel ouvert, et, à la table voisine, un couple qui attire mon attention.
Cela fait déjà quelques bières qu’ils sont attablés. Lui, la soixantaine un peu abîmée, une barbe de trois jours plus sel que poivre répandue anarchiquement sur un épiderme qui accuse le coup. L’état piteux de son T-shirt du festival Jazz de Montreux donne à penser qu’il y était déjà, accoudé au bar, lors de la première édition. Une sympathique bedaine fait valser les pictogrammes ornant le T-shirt, qui glissent gaiement sur des toboggans de tissus adipeux. Des yeux malicieux planqués derrière des binocles, et un air bienveillant d’oncle pince-sans-rire.
Elle est assise face à lui. La cinquantaine bien tassée et, elle aussi, quelques kilomètres au compteur. Une frange noire précise, des petites lunettes et un air de secrétaire médicale qui aurait le punk-rock comme pêché mignon. Un ventre bien rond, de ceux qu’on associe à un heureux événement. Dans son cas, l’éventuelle tournée du patron. Elle est discrète, presque effacée, mais semble dissimuler un parcours et un caractère autrement plus tempétueux. Toute de noir vêtue, elle écoute son compagnon animer seul leur conversation :
« Tu mets le réveil trop loin, et après t’entends rien quand il sonne et tu te réveilles pas ! Combien de fois je te l’ai dit ? Vraiment… »
Elle acquiesce mollement tout en se jetant un gros gorgeon, réponse simple qui semble convenir à son interlocuteur. Je l’observe depuis plus d’une heure, ce couple à l’allure de vieux rafiot abîmé par un trop long périple sur le fleuve routine. Pas grand chose à se dire, si ce n’est quelques reproches et autant de banalités sans affect. Et pourtant…
Leur complicité me touche. Sans doute née d’une longue collaboration. Et quand bien même elle connaîtrait quelques ratés, je fantasme à propos de la longévité de leur union. Depuis combien de temps met-elle le réveil trop loin ? Qu’ont-ils construit ensemble ? Comment ont-ils décoré leur tragi-comédie existentielle ? Ils me surprennent en train de les épier, je me détourne et en reviens à ma table, me demandant ce qui peut pousser deux être humains à pousser aussi loin cette aventure qu’on dit perdue d’avance. Être en couple.
Café terminé. Une bière s’il vous plaît. Et des images en tête. Celles de ces couples estampillés Ikea couchées sur papier glaçant pour les besoins du catalogue et du standard de vie. Celles encore de ces unions rebelles mais parfois lointaines, risquées et déroutantes. Cet amour réciproque qui devrait, à en croire certains, sauver le monde et que l’on célèbre finalement par un compte en banque partagé. Cette vie à deux dont l’art s’empare à l’excès et dont l’économie profite à loisir. Avec la morale qui compte les points. Un sujet qui, hormis dans sa dimension sexuée et sexuelle, est le grand absent de nos « apéros-conscients » et autres discussions interminables à se demander « où qu’elle est la lutte des classes ? ». Malgré quelques jalons théoriques communément admis, le sujet du couple peine à quitter l’intimité pour venir habiter la question politique et son bordel fertile. Sans doute pour s’en protéger.
Je repense à mes amours volées, à cette sensation, ce moment où la quiétude d’un coucher de soleil romantique sur une plage déserte est déchirée par le rire pervers d’un clown triste qui n’amuse plus personne. Comment croire encore à la possibilité de cette vie à deux et à quoi cela pourrait-il bien me servir ?
Économie domestique et grève reconductible
À rien. Ce qui en fait toute la beauté. Dans une société toute entière tournée vers la finalité et l’utilité, le couple incarne l’un des champs où s’exprime encore la possibilité d’un « inutile ». Partager sa vie n’a pas ou ne devrait pas avoir de finalité productive.
Et c’est justement là que le bât blesse. Passées les quelques années d’errance insouciante octroyées par le calendrier salarié, le corps social attend du couple qu’il fonde progressivement une unité économique. Quel que soit son statut (contractualisé ou pas). Un organe stable. Soyons cléments avec l’Insee : comment pourrait-elle considérer le moral des ménages sans ménages ? Un ménage où la passion n’est qu’un « plus produit ». Le couple n’est ainsi pour elle, bon gré mal gré, qu’une interface avec l’économie, lui permettant de s’organiser vis-à-vis de la propriété, du travail et de la marchandise. Et la solidité d’une relation se mesure aussi à l’existence d’un compte en banque commun. Est-ce compréhensible ? Aisément, dans la mesure où cela répond aux impératifs financiers rationnels qui s’« imposent » au couple ainsi qu’à différents désirs d’inscrire la vie à deux dans la durée. Est-ce « naturel » pour autant ?
Qu’est-ce donc que ce couple que scrutent et définissent banques, États et marchands ? Au-delà de l’opposition simpliste entre union libre et mariage traditionnel, c’est de l’impact de la définition économique du couple sur son assise amoureuse dont il est ici question. L’économie domestique, définie comme l’ensemble des biens et services produits au sein du couple, est considérée par les économistes et sociologues comme créatrice de valeur. Et a toujours été observée avec attention par nos monarques et leurs intendants, tantôt pour pallier les défaillances et reculs de l’État-providence (à la manière de l’économie sociale ou informelle), tantôt comme source de profits et d’emplois qui s’ignorent - ainsi qu’en témoigne la tentative de créer de nouveaux débouchés pour le tertiaire au sein même du foyer avec les services à la personne. Selon l’Insee, la part de richesses produite au sein du couple ou de la famille, considérée au prix du marché, représente une somme égale aux deux-tiers du PIB. Se préparer une salade à midi est donc assimilé à une création de valeur. Faire l’amour sera-t-il un jour considéré comme un « protocole d’accès à un plaisir récréatif dans une perspective éventuelle de reproduction de l’espèce » ? Est-ce que faire l’amour crée de la valeur ? Plutôt que de se poser de telles questions, il vaudrait mieux cesser de souiller le quotidien avec un vocabulaire et des systèmes de pensée sortis tout droit de l’attaché-case d’un expert comptable.
Des incitations bancaires, commerciales ou fiscales sont là pour pousser à l’officialisation d’une union sur l’autel de l’économie ou de la loi. Deux sas avant sa reconnaissance culturelle. Ce couple « légal », qu’il soit famille en devenir ou famille devenue, est d’abord envisagé comme ciment de l’ordre social. Rien de problématique s’il s’agissait simplement de « faire société ». Mais le fait qu’États et Banques souhaitent tant assister à la consécration de nos idylles soulève bien des interrogations sur le modèle de vie à deux ainsi promu. Soit une trajectoire « normale », le rythme de vie qui va avec et au final une insertion « réussie ». Par exemple, quelle est donc la logique associant l’accession à la propriété immobilière à une étape de la vie à deux ? Rien d’autre que l’articulation entre ordre matrimonial et ordre tout court. Investir. Prévoir. Consommer. Financer hôpitaux et écoles avec l’impôt. Gérer sa relation. Y reproduire paisiblement sa force de travail. Des fonctions du couple comme inscrites dans « l’ordre des choses ». Alors qu’elles sont en réalité autant d’éléments d’une fable à incarner à deux qui traduit en mode de vie l’idéologie économique qui lui préexiste. Le couple « normal » ne serait-il pas l’une des composantes de la « superstructure » si chère à Karl ? Une superstructure conçue comme l’émanation idéologique des rapports de production en vigueur et qui permet dans le même temps leur maintien en l’état. À teneur garantie en conformisme amoureux.
Prendre acte de cette contagion économique revient à mettre à jour ses pendants offensifs. Si le couple est une unité de production, le débrayage pourra venir d’un soulèvement en son sein. L’étymologie du mot « économie », du grec ancien oikonomía qui désigne l’« administration d’un foyer », souligne cette évidence : l’enjeu touche aux fondements même de notre civilisation, au-delà de toute problématique religieuse ou morale. Économie domestique ? Non. Autogestion, sabotage, grève sauvage. Plutôt que de concevoir le couple comme un îlot de pureté apaisant affleurant à la surface d’un monde crasseux, l’envisager comme le premier endroit à partir duquel s’organiser face à cette crasse. Un peu à la manière du groupe affinitaire si cher à celles et ceux qui n’ont remisé toutes leurs envies d’action directe. À deux, ne forme-t-on pas déjà un premier groupe affinitaire ?
Les choix qui se présentent au couple sont nombreux et recèlent une infinité de configurations et de combinaisons. Loin de tout modèle hégémonique. Il s’agit de s’organiser face à la propriété. À l’argent. D’inventer des nids d’amour pour habiter le monde. Aidé en cela par les multiples possibilités en matière de fraude et autres réappropriations. Un illégalisme concerté et dont on pondère les risques à deux. Un qui remplit sa besace, l’autre qui fait le guet. Ou qui fait diversion. Un qui feint l’insertion et assure la subsistance pendant que l’autre mène un projet qui n’est pas économiquement viable. Puis inverser les positions. Et même sans transgression de la loi, réinjecter de l’ « irrationnel » et de l’ « irresponsable » en opposition aux trajectoires normatives censées aller de pair avec une relation pérenne. Ne pas prévoir, ou si peu. Mettre à jour l’existence d’un « commun » dont les modalités de partage et d’exercice sont autant de tentatives d’émancipation sociale créatrice. Aux bréviaires implicites qui définissent la bonne gestion du quotidien partagé, opposer ses propres règles et expérimentations, forcément fragiles et paradoxales. Loin de tout conformisme social castrateur et de toute aliénation à l’accumulation aveugle de biens et de services. Fonder la « conscience collective » de cette unité économique qu’est le couple et dont les faits et gestes, s’ils sont scrutés avec attention par le marché, peuvent donc aussi lui nuire. Un éventail de jeux ouverts par la vie à deux, avec lesquels il convient donc de s’amuser. Et même si les tentatives sont gauches ou entravées, toujours essayer de défaire cette vie à deux de ces oripeaux économique qui semblent pourtant l’habiller sur mesure.
Le pouvoir des fleurs
Les années 1960 furent le théâtre de luttes diverses ayant pour enjeu la « libération de l’amour ». Face à une société traditionnelle aux carcans amoureux obsolètes, certaines de ces luttes apparaissent aujourd’hui encore pertinentes et salvatrices, de par les acquis sociaux qui en témoignent. Reste que la liberté amoureuse et le couple libre, en tant qu’idéaux, réclamés à l’époque à grand renfort de slogans émancipateurs et autres folk songs contestataires, ont aujourd’hui comme un goût d’échec emballé sous atmosphère protectrice et bradé en période de soldes.
La morale a toujours été l’ennemie jurée des amours « libres ». Aujourd’hui encore, chaque offensive gouvernementale sur le terrain des mœurs est scrutée avec méfiance, à juste titre. Le background judéo-chrétien est prégnant, relayé au sommet de l’État par ceux qui l’instrumentalisent à loisir face à une prétendue déliquescence culturelle qui mettrait en péril notre « identité nationale ». Soit. En réaction, les « garde-fous militants » s’insurgent et défendent nos libertés individuelles, notamment amoureuses. Offensives rétrogrades et lever de bouclier militant. Si ce conflit entre progrès et morale est historiquement une tension sociale motrice, il faut quand même s’attarder sur la nature de cette prétendue liberté amoureuse à défendre.
Années 1980. L’assise intellectuelle et idéologique qui accompagne et permet l’avènement du néolibéralisme promeut le développement de soi et de la réussite individuelle aux rangs de conditions sine qua none de l’accession au bonheur. Le règne du storytelling participe d’une exaltation permanente du « je » articulée avec le culte de la jouissance perpétuelle. Trajectoire professionnelle et affective réunies dans un même mouvement narratif. En cadeau : égoïsme fondamental, calculs utilitaristes et oppression des affects qui ne vont pas dans le sens de l’effort de guerre. Avec en toile de fond la croissance économique et l’expansion comme objectifs moraux, voire comme mythes collectifs. Une terminologie qui sent le mauvais vin de messe : culte, objectifs moraux et mythes. Si la religion est un système de croyances contraignant, construit autour d’un conte qui narre les aventures d’une entité supérieure, le capitalisme néolibéral en remplit désormais certaines des fonctions. La dichotomie bien/mal complétée par celle séparant ce qui est profitable et ce qui ne l’est pas. Contaminant par là même les choix affectifs et la nature même des relations amoureuses.
Des couples libres et non faussés dont on juge la qualité en fonction de ce qu’ils nous (r)apportent. Qu’on met dans la balance au même niveau que des choix professionnels. Que l’on consomme avec frénésie, tant le port d’un projet amoureux sans cesse renouvelé est obligatoire. Que l’on gère et que l’on juge à l’aune de leur assise matérielle. Un véritable paradigme amoureux avec ses créations de débouchés – le marché de la solitude par exemple, qui fait de l’isolement affectif une tare individuelle déconnectée de toute explication collective. Aucun passéisme nostalgique, ici, mais plutôt la nécessaire autopsie d’une certaine idée de la liberté amoureuse. De certaines aspirations libertaires à une pollution néolibérale certaine, d’autant plus coercitive qu’elle investit les subjectivités et naturalise un certain régime de gouvernance des affects. Tendons-nous à valider le modèle de « l’homo-oeconomicus » via nos périples partagés ? « Difficile les caresses les mains attachées », chante le groupe toulousain Expérience.
N’en déplaise aux mots d’ordres progressistes scandés aujourd’hui à son sujet, il semblerait que l’enjeu amoureux soit amené à faire face à d’autres périls que le conservatisme moral et religieux. Autrement plus pernicieux. Des enjeux sous-jacents qui regardent avec un sourire en coin la place publique s’agiter autour de la taille de la jupe ou de l’influence d’une couple gay sur le « devenir homosexuel » de leur progéniture.
Ils vécurent heureux…
Entre deux bilans comptables de sa petite PME affective, il n’est pas exclu de continuer à rêver à des amours autrement plus lyriques. Pour ce faire, l’industrie du divertissement propose un éventail large de services culturels à destination des cœurs apathiques. « Trouver l’âme sœur » agite tout un chacun ; il est logique que cette obsession se retrouve dans nos diverses représentations artistiques de l’existence. Il serait présomptueux d’ébaucher une analyse complète du rapport entre la définition du couple et l’histoire de celles-ci. Néanmoins, des prémices de la narration orale à l’avènement de l’industrie du divertissement, les conditions de production et de diffusion de nos représentations artistiques peuvent nous renseigner sur leurs biais mêmes. Notamment concernant la vie à deux.
En digressant vers le rapport entre cinéma et violence politique, il est aisé d’observer que la plupart des films biographiques qui s’attachent à décrire les trajectoires de bandits et/ou opposants politiques célèbres le font dans un évident sens de réprobation de la violence. Souvent en la décrivant comme fondamentalement irrationnelle, et en menant la plupart du temps les personnages concernés à leur perte. Comme si de l’issue du scénario découlait un jugement moral en adéquation avec les valeurs (ainsi définies) de notre société. Condition pour qu’un diffuseur ou producteur potentiel injecte les millions nécessaires au tournage et à l’exploitation du film.
Il y avait peu de chance pour que cette articulation complexe entre expiation collective - orientée idéologiquement - et affaire de gros sous ait épargné les « films d’amour ». En témoignent ces comédies romantiques niaises, qui prennent place dans des univers de nantis, où l’hypertrophie de la problématique amoureuse s’accompagne en réalité de questionnements aussi profonds qu’une minable flaque de larmes sur commande. Ou à l’inverse, ces drames « sociaux », cette fois-ci chez les pauvres, dont on attend qu’ils prouvent par le menu détail que l’amour triomphe de tout, même des huissiers.
Mais quels sont les mécanismes scénaristiques qui permettent l’illusion d’universalité alors même qu’il est question de sentiments par essence individuels ? Et surtout, quelle peut être leur influence sur nos imaginaires et nos façons d’aimer ? Si l’existence et la nécessité de mythes collectifs constituent une réalité indéniable, que penser de l’influence des diktats financiers préalables à toute diffusion de masse sur la définition de ces mythes ? Du cinéma à la musique populaire, l’analogie s’appuie sur les mêmes mécanismes ; trop vastes pour être tranchées, ces questions restent néanmoins entières et pertinentes.
« Fais-moi revenir au monde »
« L’amour est mort ». La tentation est grande de se réfugier derrière ce constat lapidaire, en réponse (amère) aux époques où d’aucuns prétendaient qu’il sauverait le monde. Se lover dans la chaleur des conformismes et naviguer sur la routine partagée en évitant de sonder la profondeur de l’eau. Ou pour certains, ne jamais se remettre d’une trop douloureuse chute à deux. Le corps endolori par des regrets, et qui amènent à briser les cœurs tout en ne laissant plus battre le sien. Travailler à dégoûter les candides et les rêveurs de tenter l’aventure. On achève bien les amoureux. Façon d’entériner le désenchantement du quotidien dans un élan de célébration mortuaire d’amours désormais trop souillés pour être honnêtes. En coulisse, continuer à mythifier d’éternelles passions, fantasmées et donc inaccessibles.
Ou alors on peut être réaliste, tout en continuant à rêver un peu.
« Je t’aime » : la concision de la formule n’a d’égal que sa propension à écorcher la bouche. Parfois on lui préfère le silence, souvent on la répète sans trop y penser. Car en y réfléchissant, ce « je t’aime » engage. Pas l’engagement que l’on signe, non sans l’avoir répété comme un écolier après l’énoncé d’un ventripotent dépositaire de l’ordre. L’engagement que l’on ressent. Celui qui dans le jargon militaire désigne un combat. Qui évoque une promesse dans la vie de tous les jours. Qui dans ses définitions même s’inscrit en faux contre l’air du temps et ses « ce n’est pas de mon ressort ». Un « je t’aime » qui se fait cri de colère face à l’ineptie quotidienne. Tentative vaine et magnifique de donner sens et corps à nos faits et gestes. Aidé dans cette tâche par une complicité forte allégée des délires fusionnels. Un « je t’aime » coup de folie qui attaque de front notre propension à pondérer les risques et qui marque le point de départ d’une entreprise qu’on sait vouée à la faillite. Fondamentalement irrationnelle et donc profondément grisante : je mise tout et ne retiens rien. Un engagement dont les modalités sont en perpétuelle (re)définition. Les sentiments partagés et le quotidien comme assise théorique et comme boussole morale. Pas la morale qui sent la naphtaline, version dominante et codifiée de règles qu’il est pourtant bon de fixer ensemble, dans la pratique et sans un curé au dessus de l’épaule. Le plus loin possible des dogmes creux de la consommation frénétique de l’autre, travestis en libertés conquises, et de leur inverse contractualisé et contraint.
Abnégation. Partage. Écoute. Altruisme. Quelques-uns des aspects de nos comportements d’humains, comme autant de gisements de vie désaffectés. Qualités dont nos quotidiens de salariés/citoyens n’ont que faire. Ici, même si l’amour ne suffit pas à faire de nous des « gens biens », il peut se targuer de ne pas entériner les pires de nos possibilités, en convoquant les meilleures. Rare et précieux comme une occasion de se tirer le haut, quand le quotidien tire « vers nulle part ». Le cocon, creuset de la jouissance, devient une jouissance en lui même. Marqué d’un impératif d’honnêteté et par la recherche d’un équilibre, dans une lutte quotidienne pour faire mentir fatalité et réalité. Là où le quotidien exempt de religion ou de religiosité ferait parfois l’effet d’un morne lendemain de cuite perpétuel, il ne s’agit pas de réenchanter la vie avec une illusion d’éternelle passion. Ce ne serait que substituer un système de croyance à un autre. Lui préférer la collision complice de deux individualités, initialement mues par leurs intérêts personnels, et réunies dans un conflit fertile où les antagonismes jouent le rôle de carburant. Assise amicale pour mouvement amoureux. Des « aventures » dont on découvre la portée chaque jour, quand bien même elles sont terminées.
Comme un écho étrange à ce que l’on ressent en temps de mouvement social. L’envie que les événements qui secouent la rue ou le couple les portent au-delà même de ce qu’ils peuvent imaginer ou gérer. Être amoureux et se saisir de tout ce qui passe par la main ou par la tête pour faire voler en éclats les parois de sa propre vie. Des parois aux vitrines, le plaisir dans le fracas.