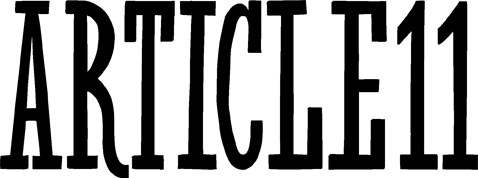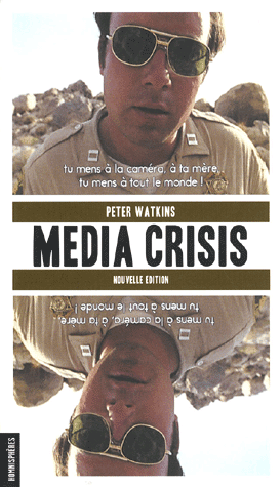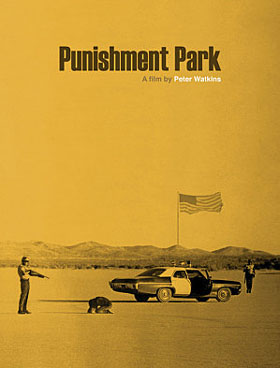lundi 21 décembre 2009
Médias
posté à 23h58, par
18 commentaires
Dans son livre « Media Crisis », Peter Watkins analyse le lavage de cerveau médiatique, la pauvreté de la forme et l’inanité du fond de la plupart des productions contemporaines. Portant aussi la casquette de réalisateur, il applique dans ses films des principes inverses à ceux qui président à l’abrutissement des masses. Une efficacité cinématographique démente et un impact politique non négligeable.
« Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais dans une perspective « business », soyons réaliste : à la base, le métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. […] Or pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible. »
Patrick Le Lay, PDG de TF1, in Les Dirigeants français et le Changement (2004).
Cette phrase du PDG de TF1 est désormais mythique. Ce qui ne l’empêche pas - bien au contraire - de fournir une parfaite illustration à l’analyse et à l’œuvre de Peter Watkins. C’est que l’auteur de Media Crisis n’a eu de cesse, depuis son premier film, de prouver par A + B, d’une manière parfaitement logique et lumineuse, ce qu’avoue sans fard Patrick Le Lay. Et qu’il s’est acharné sur les ressorts, tenants et aboutissants du grand cirque médiatique.
Mais Peter Watkins ne s’est pas contenté d’une posture de critique des médias : il a aussi mis les mains dans le cambouis, produisant une œuvre audiovisuelle majeure. Belle façon de mettre en pratique ses principes et de montrer qu’un autre type d’audiovisuel est possible.
Un incontournable de l’histoire du documentaire et de la critique des médias, donc. Un Anglais déjanté - surtout - qui a, tout au long d’une carrière loin d’être terminée, réalisé des docu-fictions plus étonnants les uns que les autres. C’est ainsi : chacune de ses productions a une histoire très particulière en même temps qu’une grande portée politique. De quoi bousculer les cadres et normes cinématographiques et télévisuels habituels.
Comme toute œuvre réellement subversive, dans le fond aussi bien que dans la forme, le travail de Peter Watkins s’est retrouvé marginalisé. Ses films ont régulièrement été censurés, empêchés de sortir en salle ou interdits de diffusion quand ils n’ont pas fait l’objet de tentatives de normalisation car jugés « inmontrables ».
Media Crisis : le Spectacle au microscope
Au fur et à mesure de ses réalisations – et des rejets qu’il a essuyés – Peter Watkins a affiné sa vision du monde médiatique. Puis il l’a livrée dans Media crisis, publié en 2004 aux éditions Homnisphères. La substantifique moelle de sa réflexion, donc.
Un bouquin passionnant. Et pas vraiment simple, aussi. Pour être franc, j’ai même eu un peu de mal à le finir, un souci apparemment récurrent chez ceux qui s’y sont attelés… Mais cette complexité n’enlève rien à la validité et à la force des « théories » de Watkins - si tant est qu’on puisse encore les qualifier ainsi, au vu d’une réalité les validant à chaque instant.
Dans ce bouquin - entièrement disponible en ligne sur son site, ICI - Peter Watkins livre une critique constructive et sanglante de ce qu’il appelle les « MMAV », Medias de Masse Audiovisuels et du rôle de ceux-ci dans la société de consommation.
Les MMAV ? Dans l’ensemble, nous avons tous forcément une idée - au moins floue - de ce que c’est. La forme des productions de la télévision, de la radio et du cinéma n’ont plus rien de neutre, si elles l’ont jamais été. Ça saute aux yeux. Autant que cette évidence : on ne peut dissocier le média du message transmis, non plus que le fond de la forme.
Pourtant :
Dans sa très grande majorité, remarque Peter Watkins, la société refuse toujours de reconnaître le rôle de la forme et des processus de diffusion et de réception des productions des MMAV. Ce qui signifie que les formes de langage qui structurent les messages des films ou des programmes télévisés, ainsi que les processus tout entiers (hiérarchiques ou autres) de diffusion à l’attention du public sont complètement négligés et ne font pas l’objet de débat. Consécutivement à ce manque de débat critique public, plus de 95% des messages diffusés par les MMAV sont structurés selon le principe de la Monoforme.
Ce « manque de débat critique public » est l’un des chevaux de bataille de l’auteur de Media Crisis. Non que les téléspectateurs souhaitent des émissions de mauvaise qualité : ce sont les professionnels des médias qui le leur imposent. Et ce bien que personne n’a jamais demandé aux spectateurs leur avis. C’est même un véritable tabou, provoquant les ricanements du monde audiovisuel. Faire participer les téléspectateurs aux grilles de programme ? Et puis, quoi encore ? Pourquoi pas leur proposer de se mêler du processus de création du film tant qu’on y est ?
Dans ce manque de débat public, le formatage induit par les MMAV joue aussi un rôle essentiel. Comment le spectateur pourrait opter pour autre chose, lorsqu’aucun choix ne lui est laissé et qu’il est gavé de saloperie depuis sa naissance ? Quand un véritable lavage de cerveau s’ingénie à réduire tout sens critique, à donner constamment le goût des mauvaises choses et de la facilité intellectuelle, sans jamais - ou presque - proposer la moindre alternative valable ou crédible ?
Ce formatage, c’est celui de la monoforme. Une part immense de ce qui est produit (films cinématographiques, émissions de télévision, journaux télévisés, feuilletons, soap-opéras,comédies, reality-show et documentaires), y est soumise. « Il en résulte une forme de langage caractérisée par : un espace fragmenté, des rythmes répétitifs, une caméra en mouvement perpétuel, un montage rapide et saccadé, un bombardement de sons denses et agressifs, et un manque de silence ou d’espaces de réflexion. »1
Chacun voit parfaitement le genre de films dont il est ici question. Sans forcément se rendre compte que la diffusion des techniques auxquelles Peter Watkins fait référence s’étend à quasiment toute la production audiovisuelle contemporaine, dans quelque pays que ce soit. En soi, cela pourrait ne pas être un grand mal, mis à part l’uniformisation qui en résulte. Ce serait oublier que ces processus ne sont pas neutres, mais qu’ils se placent au service d’une idéologie politique libérale et d’une véritable entreprise d’abrutissement.
Plus fondamentalement, ce que les professionnels des MMAV ont accompli durant les 20 ou 30 dernières années, c’est la diffusion et l’implantation efficace d’un « climat » psychologique qui a servi de levier à l’idéologie consumériste, écrit Watkins. […] En d’autres termes, l’objet même du consumérisme, qui sature le rendement des MMAV, est renforcé à de nombreux niveaux inconscients, par un processus caché et hiérarchique - avec son propre discours sociétal souterrain, où il apparaitrait que nous sommes incapables (ou non désireux) de vouloir l’identifier ou de le reconnaître.
Ce climat, soigneusement inculqué, injecté au plus profond de notre psyché par les formes saccadées et fragmentées du langage des MMAV et par l’industrie du cinéma commercial à l’échelle globale a entraîné chez nous une sérieuse diminution de notre capacité de concentration, un manque de tolérance pour des processus soutenus ou pour n’importe quelle forme de communication qui exigerait d’y consacrer plus de dix secondes, une amnésie de plus en plus généralisée face à notre histoire (surtout chez les jeunes générations), un besoin perpétuel et accru de changements. Tout cela a permis de façonner une société manifestement plus privatisée, où règnent l’insécurité et une agitation constante. Une société où la pensée compétitive, l’égotisme, le gain personnel, et l’indifférence envers la violence et la souffrance deviennent de plus en plus « la norme » et où disparaissent la pluralité authentique et l’interaction communautaire.
Un point aussi développé dans un article publié dans Le Monde Diplomatique à l’occasion de la sortie du film La Commune en 2000. Un papier reprenant notamment cette citation du réalisateur : « La télévision a imposé des structures narratives totalitaires à la société sans que nul ait eu le temps de réagir, à cause de sa rapidité, de son arrogance et de son côté mystérieux. C’est ça, la « monoforme » : un torrent d’images et de sons, assemblés et montés de façon rapide et dense, une structure fragmentée mais qui donne l’impression d’être lisse. (…) En dépit des apparences, la « monoforme » est rigide et contrôlée, elle ignore les possibilités immenses et sans limites du public que les médias estiment immature. »
En fait, le livre mériterait un billet en soi. Mais ce n’est pas mon propos. Et puis, je ne vais quand même pas vous mâcher tout le boulot : on pourrait m’accuser de « monoformisme »…2
Mise en pratique : la réalisation selon Watkins
Pour la partie vraiment cinéphile et plus « technique » de l’affaire, je laisse la parole à ceux qui le feront bien mieux que moi3. En revanche, je vais revenir sur une critique politique qui s’exprime notamment dans la réalisation de « docufictions », en lesquels Peter Watkins met en application ce qu’il préconise. Des œuvres totalement hors formats, dans leur durée - qu’il s’agisse des 5 h 45 de la version originale de La Commune ou des 14 h 30 du Voyage, un film pacifiste tourné dans une douzaine de pays (nul besoin de préciser que peu de télévisions sont prêtes à montrer des films pareils…) - comme dans leur montage et leur réalisation : les plans longs, qui laissent toute sa place à la réflexion du spectateur, sont privilégiés.
Le concept de « docufiction » prête d’ailleurs lui-même à réfléchir. Chez Watkins, il s’agit d’entremêler réalité contemporaine, reconstitution historique et implication des « acteurs ». Le réalisateur filme aussi régulièrement avec des cameras à l’épaule, pour donner une plus grande impression de réalisme.
Les acteurs sont pour la plupart des amateurs, que Peter Watkins implique dans le processus créatif du film en les faisant réfléchir à leur propre histoire - c’est essentiel : le public se trouve « devant et derrière », partie prenante de la création du film et actif dans sa manière de le regarder. Ainsi de Culloden (1964), film qui recrée les conditions de cette bataille (un massacre, plutôt) au cours de laquelle un millier de highlanders écossais se sont fait écrabouiller par les régiments britanniques d’élite : le tournage s’est effectué sur le champ de bataille et les acteurs (pour une bonne part, des descendants des combattants loqueteux, opprimés, mal organisés et très inférieurs en nombre qui se sont fait étriper pendant cette boucherie) ont recréé leur propre histoire.
En faisant travailler ces acteurs non professionnels, il s’agit de jouer sur leur conscience politique. De déclencher leurs réactions à chaud. De les aider à oublier la camera. Et de se rapprocher ainsi au maximum de la réalité, de toucher à une authenticité que ne pourraient pas rendre des acteurs professionnels. Dans les films de Peter Watkins, chacun conserve souvent son propre rôle, à peine travesti par les besoins scénaristiques. Ce qui explique pourquoi les spectateurs peuvent se retrouver soufflés par l’impression de réalisme.
Dans La Commune, le réalisateur a été jusqu’à recruter des acteurs amateurs en fonction de leurs opinions conservatrices, avant de les habiller en soldats versaillais, de les réunir dans une pièce et de les inviter à discuter. En résultent des débats et des prises de position puant le naturel (du genre : « Il faut de l’ordre dans la société, c’est évident, sinon ça ne peut pas marcher… »). Dans le même temps, le spectateur est constamment renvoyé à sa propre condition, que ce soit par des adresses directes ou au travers de procédés ana-ou-u-chroniques (qui n’ont pas eu lieu). Dans La Commune, c’est notamment le rôle de deux journalistes-acteurs, qui interviewent les communards tout au long du film.
Un processus si efficace que les acteurs et certains passionnés du film se sont organisés en une association, Rebond pour la Commune, dont le but est de faire perdurer le processus réflexif du film. Une démonstration parfaite que, à l’inverse des productions prédigérées dont on ne se souvient pas cinq minutes après la fin, Watkins arrive à susciter un véritable processus de réflexion. Un réel boulot politique, quoi. Mais aussi un vrai danger pour les tenants de l’ordre établi.
Dans le même ordre d’idées, Peter Watkins a également eu recours à des acteurs amateurs authentiquement réactionnaires dans Punishment Park. Le réalisateur y imagine un tribunal américain, constitué de ces conservateurs membres de l’establishment WASP et chargé de juger de jeunes militants pour les droits civiques, gauchistes, objecteurs de conscience et féministes à la fin des années 60. Alors que l’état d’urgence a été décrété dans le pays, ces gens sont accusés de s’être rebellés ou d’avoir manifesté pour leurs idées. Et ? Ils ne se démontent pas et défendent leurs opinions jusqu’au bout. Ce qui donne lieu à des débats politiques passionnants. Résultat : oubliant que n’est « qu’un » film, le spectateur se retrouves vite debout, ses petits poings serrés de rage, haranguant la télévision pour répondre à ces immondes salopards4 .
Une fois jugés, les rebelles du film ont le choix entre une peine de plusieurs années de prison ou être relâchés dans « Punishment Park ». Cette dernière option donne lieu à une chasse à l’homme sauvage : les récalcitrants sont abandonnés en plein désert, sans eau, et doivent parvenir à un endroit donné, situé à environ trois jours de marche, alors que des flics barbares, armés jusqu’aux dents et tout émoustillés par l’odeur du sang de beatnik sont lancés à leur poursuite en jeep. Pas de « happy end » téléphoné dans ce film, mais de vrais accès de rage de la part de ceux qui jouent les flics, au cours de scènes si troublantes qu’il faut faire un effort pour se souvenir que ce n’est pas la réalité. Certains, d’ailleurs, prenant le film en cours de route ou pas assez renseignés sur les procédés bizarres de son réalisateur, ont cru jusqu’au bout que tout cela était vraiment arrivé.
Watkins - enfin - est un champion de la censure5. À tel point que les attaques contre ses films donnent la trame de ses déplacements géographiques : cet Anglais a l’habitude de prendre le chemin de l’exil après le mauvais accueil porté à ses opus. Chronologiquement, il a vécu en Suède, puis aux États-Unis au début des années 70 ; la critique déchainée contre Punishment Park l’a vu partir pour la Norvège, puis le Danemark ; après un passage en Lituanie, il est désormais installé en France.
Le film le plus emblématique des complications faites à la diffusion des œuvres de Watkins est probablement La Bombe (The war game)6. Un docufiction né un peu avant 1965, quand la BBC a demandé à Watkins de réaliser un film sur ce qui se passerait au lendemain d’une attaque nucléaire en Grande-Bretagne. Le réalisateur a tellement bien fait son boulot que la BBC a refusé de diffuser le résultat… Plus de 40 ans après, on comprend encore pourquoi, tant le film fait froid dans le dos. Très documenté, il mêle si bien images fictionnelles et véritables informations qu’il laisse planer l’étrange sensation qu’on pourrait (encore aujourd’hui) parfaitement se prendre un bout de ciel bleu sur le rable sans le moindre coup de semonce.
La Bombe n’a jamais été montré à la télévision anglaise - soi-disant pour des raisons de qualité, mais Watkins a découvert par la suite qu’il avait en fait été abandonné à la suite de pressions du gouvernement. Mais la BBC a aussi fait tout ce qu’elle pouvait pour empêcher la diffusion de ce film pourtant récompensé par le prix spécial du Festival de Venise en 66 et par l’Oscar du meilleur documentaire en 67 (fait très rare pour une fiction).
Mais… ce billet s’étire tel une limace en chaleur, et je n’ai même pas développé le quart de ce qu’il y aurait à dire sur Peter Watkins. Le mieux est sans doute de voir ses films7, de jeter un coup d’œil à son site et d’y trouver l’un ou l’autre de ses auto-entretiens (il ne donne désormais plus jamais d’interviews, histoire d’être certain que ce qu’il a à dire ne sera pas dévoyé), ou de regarder cet entretien réalisé en 2001 par l’association Rebond pour la Commune.
Qu’il dénonce la course aux armements, la guerre du Vietnam ou l’uniformisation des médias de masse, Watkins reste irréprochable, dans le fond comme dans la forme. Surtout, il donne envie de fusiller, en un même mouvement, ces salopards de conservateurs ricains et les versaillais, de danser la farandole au milieu des communards et de prendre les armes avec les Écossais. Bref, ça réveille salement.
1 Pour ceux qui veulent une définition un peu plus exhaustive de la chose, toujours par Peter Watkins : « La monoforme est le dispositif narratif interne montage, structure narrative, etc.) employé par la télévision et le cinema commercial pour véhiculer leurs messages. C’est le mitraillage dense et rapide de sons et d’images, la structure, apparemment fluide mais structurellement fragmentée, qui nous est devenue si familière. … De nos jours, la monoforme se caractérise également par d’intenses plages de musique, de voix et d’effets sonores, des coupes brusques destinées à créer un effet de choc, une mélodie mélodramatique saturant les scènes, des dialogues rythmés et une camera en mouvement perpétuel. Il existe plusieurs variantes de la monoforme : la structure narrative mono-linéaire classique, utilisée dans les films de cinéma, les sitcoms et les feuilletons policiers ; le mélange fluide de thèmes et d’images apparemment décousues, propre aux chaines de télévision musicales telles que MTV ; la structure saccadée et fragmentaire des informations télévisées du monde entier ainsi que de nombreux documentaires …. Ces variantes de la monoforme ont des caractéristiques communes : elles sont répétitives, prévisibles, et fermées à toute participation des spectateurs. Contrairement aux apparences, elles s’appuient toutes sur une utilisation très rigide et contrôlée du temps et de l’espace. Ces normes sont développées par et pour les médias et non pour servir l’énorme potentialité de désirs existant chez les spectateurs. Il est fondamental de comprendre que ces variantes de la monoforme sont toutes fondées sur l’hypothèse convenue que les spectateurs sont immatures, et qu’ils ont donc besoin de dispositifs de présentation familiers pour être « accrochés » (i.e. Manipulés). C’est pourquoi tant de professionnels des médias s’appuient sur la monoforme : les ingrédients tels que la rapidité, le montage-choc, le manque de temps et d’espace, garantissent que les spectateurs n’auront pas le loisir de réfléchir à ce qui leur arrive. »
2 Même si c’est quand même à signaler : Watkins critique également l’ensemble du système éducatif et l’enseignement aux (et des) professionnels des médias, qui n’apprennent plus que la manipulation de masse et la constante reproduction d’un ordre débilitant. Le médium est le message, le fond et la forme sont liés, la structure a clairement un impact sur la réception. Il revient également sur l’idée que nous « exprimons une réticence inconsciente à critiquer une source de plaisir et de relaxation ». Et enfin, le plus important, « le « changement » réellement prôné par les MMAV est le changement permanent et fragmenté véhiculé par la Monoforme qui garantit que nous n’aurons jamais le temps nécessaire pour réfléchir, ou penser de manière critique – seulement le temps d’avaler le message destiné à flatter nos désirs artificiels et notre soif de consommation. »
4 Je ne résiste pas au plaisir de livrer ici l’analyse parfaite, par l’immense Hunter S. Thompson, du comportement de ce type d’enfoirés. L’auteur de Las Vegas Parano les surnomme les « requins marteaux », espèce dont John Wayne serait un parfait représentant :
« Ce pays est si fondamentalement pourri qu’un sale bigot comme John Wayne y est un grand héros national. Thomas Jefferson aurait été horrifié par un monstre tel que Wayne, et Wayne (eût-il pu effectuer le saut dans le temps) aurait été fier de pouvoir frapper à coups de crosse un « sale radical » comme Jefferson.
John Wayne est le dernier symbole avarié de tout ce qui a foiré dans le rêve américain il est notre monstre de Frankenstein, un héros pour des millions d’individus. Wayne est l’ultime « Américain », voire l’Américain final. Il bousille tout ce qu’il ne pige pas. Les ondes cérébrales du « Duke » sont les mêmes que celles qui parcourent le cerveau du requin-marteau, une bestiole si stupide et si vicieuse que les scientifiques ont abandonné tout espoir d’y comprendre quelque chose, et le décrivent comme un « archaïsme » inexplicable. Le requin-marteau, disent-ils, n’a pas évolué depuis un million d’années. C’est une bête impitoyable, stupide, qui ne sait faire qu’une seule chose : attaquer, blesser, mutiler et tuer.
La science moderne ne dispose d’aucune preuve comme quoi le requin-marteau aurait eu des ancêtres, apparemment il n’a pas non plus de descendants. Sauf que, sur cette question, la science se trompe, du moins en partie. Comme bon nombre d’espèces, le requin-marteau a évolué en changeant d’habitat. Les plus évolués d’entre eux ont quitté leur habitat marin pour apprendre à marcher sur terre. Ils ont appris à parler américain malgré leur cervelle de moineau et certains d’entre eux ont migré à Hollywood où ils ont été fort prisés en tant que figurants (voire héros) et utilisés dans des centaines de films dits de « cowboys ».
Le nouveau requin-marteau faisait un cowboy parfait. Il était vicieux, stupide et ignorant de tout hormis de ses propres frousses et de ses propres appétits. Il tabassait à mort quiconque le mettait mal à l’aise, quelle qu’en soit la raison. Le requin-marteau faisait un guerrier parfait. Il défendait le drapeau. N’importe quel drapeau. Il a appris à comprendre des mots tels que « ordres » et « patriotisme », mais le secret de sa réussite était son goût immémorial pour le sang. C’est dans l’action qu’il se révéla. Mais il n’avait pas un sou de jugeote ; aussi fallait-il le guider.
Le requin-marteau était le type que vous engagiez lorsque vous vouliez buter des Indiens. Il était également disponible pour casser du nègre. Puis, plus tard, pendre haut et court les Wobblies. On lui a fourni un badge et une matraque et, aux alentours de 1960 ou peut-être même 1860 , l’Éthique du requin-marteau a été le Rêve Américain. (…) »
5 Ou du moins : de la critique assassine. Il aurait d’ailleurs pu faire sienne la citation de Jonathan Swift, en exergue notamment de La Conjuration des imbéciles : « Quand un vrai génie apparaît en ce bas monde, on le peut reconnaître à ce signe que les imbéciles sont tous ligués contre lui. »
6 Film qu’il est possible de visionner sur Youtube, ici.
7 Disponibles en DVDs, ainsi que sur DailyMotion ou Youtube pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de les acheter