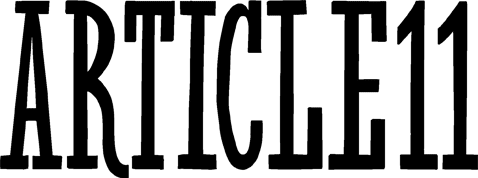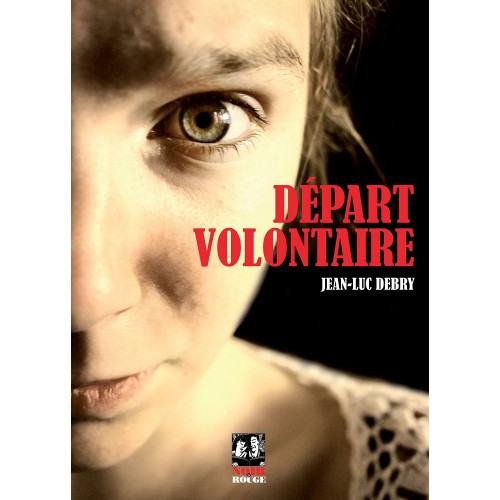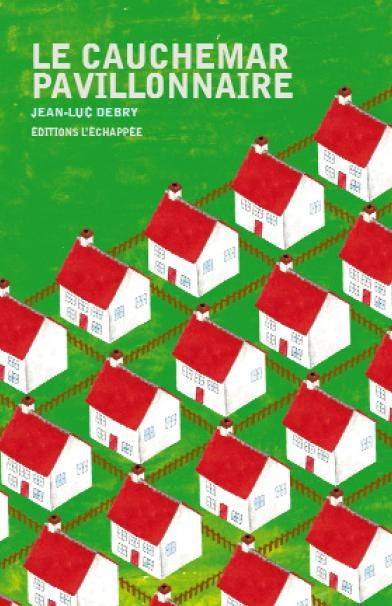Pas de quartiers ! En s’appuyant sur l’exemple emblématique des lotissements, habitat parfaitement cloisonné et auto-centré, Jean-Luc Debry, auteur (entre autres) du Cauchemar pavillonnaire, aligne les classes moyennes pour le compte. En fustigeant leurs étroits horizons et leurs médiocres ambitions, c’est finalement le règne sans partage de la consommation qu’il met à nu.
Cet entretien a été publié dans le numéro 17 de la version papier d’Article11
*
C’est une charge à l’arme lourde. Violente et résolue. Au fil des pages du Cauchemar pavillonnaire1, Jean-Luc Debry dégomme tous azimuts. Ses cibles ? L’idéologie des classes moyennes et leur étroit horizon, réduit au conformisme de la seule consommation. L’inanité des zones pavillonnaires et l’enfermement de ceux qui les habitent dans le triste « huit-clos de l’ego ». L’obsession de la sécurité, le culte de la marchandise. Et la duplication des non-lieux (autoroutes, chaînes hôtelières, centres commerciaux, rues piétonnes, etc.), espaces fonctionnels « sans mémoire, sans passé et sans doute sans futur ».
Mais si Le Cauchemar pavillonnaire a tout du jeu de massacre, petites espérances et grandes médiocrités des classes moyennes en ligne de mire, il ne faut surtout pas le résumer à sa seule brutalité pamphlétaire. L’essai dessine surtout le détaillé et percutant portrait d’une société dans laquelle toute ambition individuelle se réduit à la jouissance du consommateur. Un monde étriqué et corseté, fait de repli sur soi et d’addiction marchande.
Ce constat, Jean-Luc Debry le poursuit avec Départ volontaire2. Un roman (noir) qui prend l’entreprise et ses logiques sacrificielles pour décor, campant de veules employés et de détestables chefs de bureau. Des personnages de fiction qui semblent taillés pour habiter le tableau brossé dans Le Cauchemar pavillonnaire. L’essai et le roman se complètent, comme pour mieux souligner la cohérence d’un univers mesquin aux mécanismes affûtés.
*
« C’est vrai : Départ volontaire n’est pas le plus riant des livres. Odile, la figure centrale du roman, est tellement écrasée par le déploiement de l’idéologie managériale qu’elle se retire du monde, s’efface, disparaît. Un jour, elle décide de ne plus jouer le jeu, social et professionnel. Fini, terminé.
C’est quelque chose que j’évoque aussi dans Le Cauchemar pavillonnaire, au long du chapitre ’’La dépression comme subversion’’. J’y avance notamment l’idée que la dépression serait la dernière aventure humaine possible dans notre univers administré, saturé de normes, de procédures, de bureaucratie informatisée et de hiérarchies insidieuses.
C’est en fait l’un des seuls moments où il est encore possible de s’appartenir vraiment. Dans la douleur, la souffrance, l’abandon – mais de s’appartenir quand même. La personne atteinte de dépression ne marche plus dans le cinéma qui lui est proposé. Elle ne croit plus dans l’idéologie en tant que telle, ni dans ses mises en scène de pacotille. Et elle refuse la performance, la réussite – ces valeurs cardinales du monde de l’entreprise.
Je travaille comme cadre moyen et je suis très souvent sur la route pour des raisons professionnelles. Il y a quatre ans, je me trouvais dans un bled improbable – l’une de ces agglomérations qui ont eu leur heure de gloire il y a six siècles, qui ont arrêté de vivre depuis et qui somnolent, cernées par de mornes zones pavillonnaires et une ou deux petites zones d’activités. Le soir, je me suis rendu, en observateur, dans un café qui retransmettait un match de la Coupe du monde de football de 2010. À l’intérieur, tout le monde était très excité. Sauf une jeune fille de 17-18 ans, qui tirait la tronche. Elle regardait la salle avec dégoût. Et j’ai pensé : super, elle refuse de jouer la comédie du bonheur ! Mais cette ambiance survoltée, le sentiment de jouir ensemble et de partager cette jouissance, l’a finalement emportée. À un moment, elle s’est dressée, suivant le mouvement général en criant : « Qui n’est pas français ne se lève pas ! » Elle a fini par se faire avoir. Triste.
Reste que ce décalage m’intéresse. Celui des gens qui ne jouent pas le jeu. Ou plutôt : qui ne peuvent plus le jouer. Ils se placent en recul, et se trouvent donc en capacité de porter un discours critique. Ce n’est qu’une première étape, bien sûr, celle du regard : tu mets une distance entre le monde et toi. Tu te places hors-scène. C’est un préalable à la prise de conscience. »
*
« Cela recoupe ma position personnelle, mon rapport au monde de l’entreprise. Je suis à la fois dedans et dehors. J’essaie de survivre à l’intérieur en jouant avec les codes, rites et usages, toutes choses que je maîtrise parfaitement. Et dans le même temps, je m’efforce de les considérer de l’extérieur. Ce n’est pas évident. Mais j’y parviens parce que j’ai adopté un parti-pris d’observateur : je regarde le monde du travail dans lequel j’évolue en anthropologue, avec curiosité mais sans sympathie. Ce qui me fait tenir ? L’écriture, tout simplement.
Je me fais l’effet d’être un athée au milieu de croyants plus ou moins fanatiques et subtils. Tu dois connaître ce sentiment. Disons que tu rencontres quelqu’un de profondément religieux – socialement, politiquement et idéologiquement. Tu te rendra vite compte que tu ne peux rien faire d’autre que lui demander comment le monde existe à travers ses yeux. Tu pourras l’écouter, parfois comprendre sa mentalité, mais tu ne réussira pas réellement à discuter avec lui. Il y a là une espèce de barrière infranchissable. Parce que tôt ou tard, il te demandera de donner des gages à ’’sa vérité’’. »
*
« Ce qui est fascinant dans le monde de l’entreprise, c’est que quasiment tout le monde y croit. Cette profonde adhésion à la fiction professionnelle va de pair avec ce mal contemporain qu’est la disparition de l’esprit critique. Un lent délitement collectif de la capacité à construire un discours critique qui est vraiment le propre de nos sociétés post-modernes. Je le constate quotidiennement : personne ne prend de distance, ni ne remet en cause ce qui est vu comme un état de nature indépassable.
Comme si c’était évident. Évident qu’il faille être performant, efficient. Que la fin justifie les moyens. Que l’intérêt de la direction et des actionnaires est plus important que celui des salariés. J’y vois une forme d’injonction paradoxale. Parce que par ailleurs, et de mille manières, dans le spectacle permanent du narcissisme et de l’égotisme, tout concourt à la conviction que mon intérêt individuel doit l’emporter, quoi qu’il en coûte ’’aux autres’’. »
*
« Après la parution du Cauchemar pavillonnaire, certains m’ont reproché ce qu’ils voyaient comme du mépris. Sur le mode : si les gens sont heureux ainsi, tu n’as pas le droit de gâcher leur bonheur. Comme si le bonheur était une catégorie intouchable, et qu’il était interdit d’y porter atteinte.
C’est quelque chose qui ne signifie rien pour moi – il y a des tortionnaires très heureux, et des tueurs en série qui s’éclatent. Ça ne veut rien dire. Je ne vois qu’une chose : nous sommes englués dans une idéologie, et la justification de cette idéologie est portée par l’image du bonheur. Il s’agit simplement d’un artefact. Je comprends que ceux qui le vivent se persuadent qu’il s’agit du bonheur. Mais qu’on ne me demande pas de croire que le fait de devenir propriétaire d’un pavillon, d’une voiture de marque et d’enfants promis à un avenir d’ingénieurs soit la marque d’une vie réussie. »
*
« Au fur et à mesure de mes déplacements professionnels, j’ai vu les zones pavillonnaires et commerciales s’étendre. En moins de dix ans, elles se sont très nettement développées. Et on en arrive aujourd’hui à de pitoyables extrémités, à l’image de ce que j’appelle le ’’pavillon sauvage’’. Il s’agit de maisons qui ont toutes les caractéristiques du pavillon, sinon qu’elles se situent à la sortie d’un village et non dans un lotissement. Comme si le fait d’habiter dans une telle boîte à chaussures n’était plus le résultat d’une nécessité mais d’un choix.

- Photographie de Jürgen Nefzger, Marne-La-Vallée, 2000
Attention : je suis tout à fait conscient que, pour des familles à petits revenus, un habitat de ce type – disons une maison à 130 000 € – offre un certain confort. Mais c’est un marché de dupes : pour paraphraser Coluche, une fois que tu l’as payée, la ruine est à toi... Parce qu’il s’agit d’un bâtiment de mauvaise facture, conçu de manière industrielle, avec des matériaux peu nobles, des intervenants et sous-traitants mal payés et qui, vu leurs conditions de travail et la pression subie, travaillent mal. Souvent, la maison aura besoin d’importants travaux de rénovation au bout de dix à quinze ans.
Dans la culture petite-bourgeoise la plus classique, tu acquières un bien immobilier, tu capitalises et tu le transmets à tes descendants. Mais ça ne fonctionne plus avec un pavillon, puisque sa valeur se délite lentement. Ne reste que l’illusion d’être chez soi, propriétaire, et de se sentir valorisé socialement. Je crois que ce besoin affiché d’un pré carré renvoie à l’état actuel de la société. Ne rien partager, ne rien mettre en commun, se protéger de tout - l’ego dans son enclos. L’habitat est le symptôme d’une époque, c’est un fait social.
Devenir propriétaire d’un pavillon en lotissement revient en réalité à payer un loyer à une banque. La maison n’appartient pas à ceux qui l’occupent, au moins tant que le prêt l’ayant financée n’est pas arrivé à terme. Au moindre pépin (chômage, divorce, etc.), les banques l’hypothèquent. Et dans tous les cas, le pavillon perd tellement de valeur au fil du temps que le vendre n’a vite plus d’intérêt. Une triste arnaque. Sauf qu’au lieu de retourner leur agressivité contre les responsables, les victimes de cette duperie la retournent contre eux-mêmes. C’est l’essence même de la servitude volontaire. »
*
« Pour revenir sur les fondements historiques de cette fiction propriétaire, il faut remonter à la Commune. Et notamment à la grande peur qu’elle a inspirée à la bourgeoisie. Cette dernière a d’abord réagi sur un mode ultra-répressif. Mais un pan de la bourgeoisie, inspiré par le catholicisme dit social, a également pris conscience de la nécessité de faire émerger une classe intermédiaire, entre un prolétariat de masse qui ne se laisse pas domestiquer et les possédants.
La constitution de cette classe intermédiaire s’est fondée sur deux axes. D’’un côté, l’accès à l’habitat individuel, selon une logique assez évidente : qui achète un bien immobilier s’identifiera aux autres propriétaires. Peu importe qu’il s’agisse d’un château à Neuilly-sur-Seine ou d’une masure à Choisy-le-Roi : l’acquéreur a des traites à payer, il est tenu et va peu à peu se replier sur ce que j’appelle ’’le huis-clos de l’ego’’.
Mais la fabrique de cette classe intermédiaire est aussi passée par l’instauration d’un minimum de justice salariale. La bourgeoisie a dû consentir quelques concessions pour que naisse une ’’aristocratie ouvrière’’, mieux payée et dont les intérêts sont fantasmés, c’est-à-dire qu’ils sont perçus et vécus comme identiques à ceux de la classe possédante. Voilà comment on obtient la paix sociale, en intéressant le prolétariat aux développements du capitalisme.
Ce processus s’est également construit via le discours hygiéniste. À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la question de l’hygiène a en effet pris une place centrale : il s’agissait de combattre les maladies qui pullulaient, de pallier l’absence d’eau courante, de trouver des solutions pour évacuer les eaux usées, etc... Ce discours prétendant que le capitalisme améliore les conditions de vie en prenant en charge une dimension sociale est toujours d’actualité – les Trente glorieuses en constituent une parfaite illustration. »
*
« Aujourd’hui, parler de logement revient à parler d’économie, de porte-monnaie, de subventions, d’impôts. Mais on ne se demande jamais quel type de relations on veut, ni quel modèle de société on choisit. Il est devenu évident que le crédit réalise ’’le bonheur’’ de l’humanité. Le prix à payer est évacué, alors qu’il est faramineux : prêts sur trente ans, boulots qu’il faut accepter et qu’on déteste, licenciements, départs volontaires, compressions de personnel, etc. Nous sommes passés d’une société de la domination à une société de l’aliénation. Il n’est plus besoin de dominer la population, puisqu’elle s’aliène d’elle-même.
L’économie a envahi tous les champs de la société et de l’intime. Chacun se résume à un bilan d’entreprise, se souciant d’abord d’équilibrer ses dépenses et recettes. Et pour cela, il faut faire le dos rond. Par exemple, se taire si un responsable hiérarchique se comporte comme un salaud. »
*
« Ce n’est pas de haine dont il est question. Mais de désespoir. J’enrage de voir combien cette aliénation est désirée. Et combien il n’existe plus de contre-poids, de contre-pouvoir. Ou si peu, marginaux, inaudibles. C’est une victoire totale de la Valeur comme forme abstraite de domination. Son emprise s’impose dans tous les champs - le symbolique, l’imaginaire et le social.
À ses débuts, le capitalisme aurait pourtant pu être renversé. Ça ne s’est pas joué à grand-chose au XIXe siècle, notamment en 1848 et 1870. Mais l’ambition marxiste, cette vision du prolétariat comme porteur de la transformation sociale, a finalement échoué. Cet échec est désormais consommé et le capitalisme peut savourer son triomphe – plus rien ne s’oppose à la marchandisation du monde.
Ce système a détruit l’homme. Et si révolution il y a un jour, elle sera anthropologique. Il faudra se défaire de la mainmise totale de l’économie dans la relation à soi et aux autres. Mettre à bas de cette domination abstraite et désirée. Cela demandera du temps. »
*
« Jusqu’à présent, j’avais signé des ouvrages historiques qui ne dérangeaient pas grand-monde – quand tu es à gauche et que tu parles de la Commune, tu ratisses large... Il en va différemment avec Le Cauchemar pavillonnaire. Et je pense que si certaines personnes de mon entourage ont été heurtées par sa lecture, c’est parce que ce livre touche à l’intime, à quelque chose d’inscrit dans la moelle. Dans notre moelle : nous sommes très nombreux à partager un mode de vie petit-bourgeois. Mes amis. Moi. Toi. Etc. Je crois que ces gens choqués me voient comme un traître ou comme un accusateur qui met le doigt là où ils n’ont pas envie qu’on gratte.
Les classes moyennes relèvent avant tout d’un fait idéologique. Dit autrement : à partir du moment où quelqu’un se rêve membre des classes moyennes, il y appartient. Cela fonctionne aussi bien avec un ouvrier payé 1 500 € par mois qu’avec un cadre moyen gagnant bien sa vie. Parce que tous deux partagent les mêmes valeurs et croyances. Cette idéologie, celle du spectacle, du jeunisme, de la consommation, de la performance dans tous les champs, du sexuel au professionnel, a contaminé toute la société.
L’idéologie petite-bourgeoise vise ainsi à diluer toute conscience de classe dans l’illusion qu’il n’y aurait plus qu’une classe unique, partagée en catégories sociales. Cette croyance s’est très largement imposée. Il ne sert donc plus à rien, aujourd’hui, de plaquer sur notre réalité un discours de lutte des classes à la mode XIXe siècle. »
*
« Je disais que ce n’est pas de haine dont il est question. Mais j’éprouve en vérité un profond mépris pour cette classe moyenne à laquelle j’appartiens. Davantage qu’envers la grande bourgeoisie, finalement cohérente avec elle-même – je pense à cette célèbre phrase du milliardaire Warren Buffet : ’’Il y a une lutte des classes aux États-Unis, et c’est ma classe, la classe des riches, qui [est] en train de la gagner.’’ Face à un tel discours, on sait à quoi s’en tenir. Il suffit juste de choisir son camp. C’est beaucoup plus difficile avec les classes moyennes, qui mobilisent quelque chose de plus vague, poisseux et hypocrite. Leur médiocrité n’a d’ailleurs cessé d’inspirer une nausée salutaire aux écrivains, de Maupassant à Meckert, en passant par Brecht, Flaubert et Aymé. Elles se gargarisent de leur rôle, de leur position, et elles constituent le ciment de l’ordre en place, de la prison sociale.
Si je peux me permettre d’être si rude, c’est que je vis avec ces codes. Ils sont aussi miens. En fait, je suis comme ces paroissiens qui, du temps de la domination de l’Église sur le social, se sentaient athées au plus profond d’eux-mêmes, mais n’avaient d’autre choix que d’aller à la messe ou de se confesser. Je pense notamment au curé Meslier, ce prêtre qui, au début du XVIIIe siècle, a rédigé en secret un virulent traité d’athéisme3. De nuit, il prônait un communisme agraire radical et fustigeait l’Église et la religion. De jour, il jouait le rôle qu’on attendait de lui. Aujourd’hui, combien sommes-nous de curé Meslier ? »
1 Éditions L’échappée, 2012.
2 Éditions Noir et Rouge, 2014. Jean-Luc Debry a publié plusieurs autres ouvrages, dont Pierre Pirotte ou le destin d’un communard (éditions CNT-RP, 2005), Le Soldat françaoui, de Sotteville à Sétif (L’Insomniaque, 2007) et Tous propriétaires ! Du triomphe des classes moyennes (Homnisphères, 2008).
3 Il s’agit de Mémoires des pensées et sentiments de Jean Meslier.