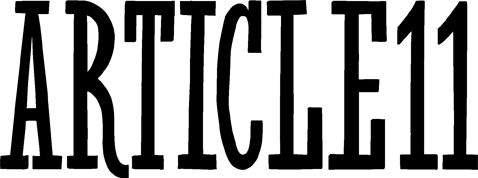lundi 16 mars 2015
Chroniques portuaires
posté à 16h58, par
12 commentaires
Le long des quais de la Seine, deux cent dix-sept bouquinistes partagent environ neuf cents boîtes, allouées par la mairie de Paris. Dans ces malles aux trésors, livres et gravures d’occasion côtoient tours Eiffel en plastique et dés à l’effigie du Kamasutra. Sur les pavés, le quai.
Cette chronique portuaire a été publiée dans le numéro 17 de la version papier d’Article11
Il se dit qu’en été, le quai cuit.
Le bitume fond.
Et puisqu’il cuit, personne n’y passe plus.
C’est la dèche.
Qui flânerait sur du bitume brûlant ?
En mai, il cuisait déjà, le quai.
La lumière était toute crue et le béton suintait.
Mon voisin n’en avait cure. Et riait de mon étonnement : si ça, c’est cuire, tu imagines un peu l’été ?
Lui, il dit qu’il n’a jamais besoin de porter un chapeau. Depuis toutes ces années, le soleil ne lui fait plus rien.
Il n’empêche, avec ou sans casquette, quand le quai cuit, les bouquinistes abandonnent leurs boîtes. Ils prennent place sur le trottoir d’en face, sous les stores des boutiques de souvenirs invariablement tenues par des hommes d’une autre origine.
À quelques exceptions près, ils ont appris à marcher sur les quais. Ils les ont ensuite ardemment détestés, repoussés, vomis. Pour mieux les retrouver. Ma voisine dit qu’elle est accro. Elle passe des entretiens d’embauche en croisant les doigts pour être refusée. Trente ans de quais. Avant elle, sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère.
La doyenne des quais, 96 ans, est décédée la semaine dernière. Ça leur a fait quelque chose, à tous.
En tête de peloton des vraiment très vieux, il y a aussi la mère de mon voisin, et Raymond, celui qui n’a plus toute sa tête depuis l’année dernière. Lui, il ne se souvient plus dans quel ordre il faut ouvrir les boîtes. Et puis il a une obsession. Il enlève l’écorce du platane qui pousse à côté de ses boîtes, tout ce qu’il est en mesure d’éplucher. Aussi, sa femme veille à l’ouverture. Elle déteste le quai, elle ne touche pas aux boîtes, mais elle ne peut pas l’interdire de venir, Raymond.
Le plus souvent, un bouquiniste possède trois à quatre boîtes d’affilée, fixées sur des coffres le long du parapet. Pour les ouvrir, il faut ôter les cadenas, soulever et fixer les couvercles en trois temps, puis sortir les tables, les présentoirs à affiches, à cartes postales, à sets de table, déplier la chaise, accrocher les bâches en plastique en cas de pluie, en toile pour le soleil. Ça paraît simple, mais le jour où tu perds l’ordre, t’es foutu – c’est ce qu’en pense ma patronne.
Ma patronne, quand la chaise se déplie mal, elle la traite de salope. Éventuellement de pute. Elle lui donne des coups de pied. Puis elle s’excuse, elle dit que les quais, ça use. Que depuis le temps les touristes, et le bruit, surtout, jouent sur ses nerfs.
Une fois, elle a imité, très fort, la déflagration d’une moto pétaradante qui passait par là. Après ce long cri de bête, elle a paru soulagée. Ce fut surprenant. Mais étrangement, à l’inverse de l’odeur de pisse refroidie, on finit par se faire à la douce violence des quais.
Sur mon quai, aucun bouquiniste ne vend de bouquins. Ou alors à la marge. Des vrais bouquinistes, des passionnés, des irréductibles, il en existe toujours, mais ailleurs, sur d’autres rives de la Seine. Des misérables ou des héritiers, tranchent les miens. Ceux-là, ils ne gagnent rien, disent-ils. Nous, on prend ça au sérieux. On doit vivre des boîtes comme on trairait une vache.
Pour traire leurs boîtes, certains les ornent de quelques Agatha Christie – les jaunes, aux éditions du Masque – et d’autres battent le pavé affublés de marinières et de bérets. Le déguisement, il paraît que ça aide. Malgré cet argument, la plupart des bouquinistes pensent comme mon voisin : tu scrutes le ciel, tu t’habilles en fonction et tu t’en fous d’être moche. L’hiver, quand il fait zéro, tu nous verrais avec une baguette de pain sous le bras ?
Dans la catégorie « aimants pour le frigo », les petites baguettes rencontrent un franc succès. Comme dirait ma patronne, c’est une merde qui marche, mais tout de même moins que les cadres miniatures, copies conformes – et en relief – des tableaux de maîtres en 2 x 2 (cm).
Sur mon quai, dire merde pour désigner une marchandise, c’est affectueux. Par merde, il faut comprendre : petit, facile à ranger, pas très cher à l’achat, rapide à écouler. Sur les quais, on vit principalement grâce aux merdes que l’on achète chez les grossistes d’Aubervilliers.
Ma patronne et ma voisine ne s’apprécient pas beaucoup. Leurs merdes se font concurrence. À vrai dire, sur mon quai, personne ne s’entend vraiment bien.
Tout se sait. Tout circule. Le quai est petit.
Néanmoins, il y a des règles à respecter.
La politesse, la bienséance.
Faire la bise en arrivant et en partant.
C’est la condition pour pouvoir faire pipi tranquillement, pour délaisser ses boîtes le temps d’un aller-retour au café d’en face.
Les voisins se doivent de surveiller, réciproquement, la vache de leurs voisins.
C’est la trêve du pipi.
Il y a d’autres moments d’entraide.
Cette union qui se forme, plus forte que l’animosité, quand l’événement survient, quand des mendiants débarquent, quand des touristes intempestifs se hasardent à prendre une photo, quand un portant s’affaisse et que la marchandise dégringole.
Alors ils crient Vermine ! Rentre dans ton pays !
Ils s’épaulent, en parlent des heures.
Avant de retrouver leurs merdes.
Sous la pluie, un passant hagard raconte qu’il part rendre visite à ses belles-filles. Il parle des cloches de la cathédrale Notre-Dame.
Des adolescents par centaines cherchent le pont aux cadenas pour y sceller leur amour. Ils s’inquiètent de savoir si la municipalité les décrochera un jour.
Des couples en vacances se disputent dans toutes les langues.
Les touristes achètent des merdes par milliers. Des tours Eiffel entre cinquante centimes et soixante-quinze euros, démontables pour la valise. Ils ne veulent pas tous de sacs en plastique.
Les gravures se conservent mieux roulées que planes.
Pulsions, transpiration.
Il se dit qu’en été, le quai cuit.
Cette photo, ainsi que la vignette de l’article, prises à Sotchi (Russie) en 1964, proviennent du fonds photographique du démographe Jacques Dupâquier, que l’on peut contempler sur le site de l’iconothèque du Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre européen.