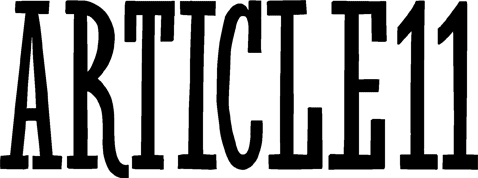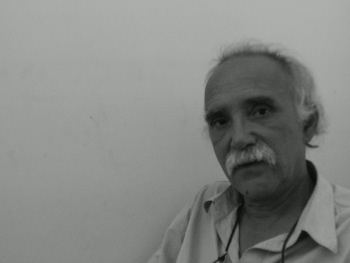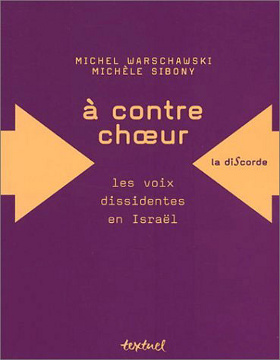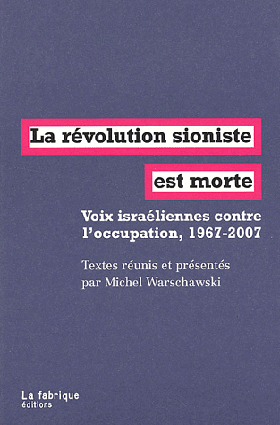mercredi 10 février 2010
Entretiens
posté à 23h56, par
14 commentaires
Figure de la gauche israélienne et inlassable pourfendeur de l’occupation, Michel Warschawski a accordé un entretien à notre envoyé spécial à Jérusalem, Grogain. Le fondateur du Centre d’Information Alternatif y critique à mots très durs la politique israélienne, tout en revenant longuement sur son propre parcours. Ou quand l’histoire d’une vie recoupe celle d’un engagement.
Tout visiteur en Israël devrait impérativement se rendre au Centre d’Information Alternatif (AIC). Pour comprendre ce que signifie réellement la « propagande d’État » et ce que les médias israéliens occultent. Et, surtout, pour discuter avec son créateur, Michel Warschawski1.
Juif né en France, Michel Warschawski est venu s’installer à Jérusalem à l’âge de 15 ans. Très vite, il s’est lui-même défini comme un militant anti-colonialiste, un engagement qui fait tâche dans la société israélienne : « Nous, on aime bien ce qui est ou blanc ou noir. Ce qui nous dérange chez vous, c’est que vous n’êtes ni l’un ni l’autre », lui a un jour déclaré un policier. Ainsi : rencontre avec un homme gris.
Quels souvenirs gardez-vous de votre enfance ?
Je suis né à Strasbourg, sur la frontière franco-allemande. Mon père était le grand rabbin de la ville. À cette époque, l’Alsace était un lieu particulier : en raison du Concordat, les institutions religieuses appartenaient à l’espace public ; mon père était donc fonctionnaire.
Pendant les quinze premières années de ma vie, je n’ai fréquenté que des Juifs. Toute ma vie se tenait dans le cadre de la communauté, entre la maison, l’école juive, le centre communautaire juif, la synagogue et mes copains juifs. La première personne non-juive que j’ai rencontré était un Arabe israélien qui avait une chambre dans la même cité U que moi, à Jérusalem. Il a fallu que je vienne en Israël pour rencontrer un non-juif pour la première fois !
J’ai donc grandi dans un milieu extrêmement fermé ; mais pas intellectuellement ni culturellement. Nous étions même très attachés aux valeurs de la République et à l’histoire française ; à la laïcité aussi, tout en étant très pratiquants. Le domaine de la foi devait rester dans l’espace privé – ce qui est un comble pour Strasbourg – et n’avait rien à voir avec les valeurs philosophiques et politiques qui nous ont marqué mes frères, mes sœurs et moi. Mes parents étaient très progressiste et l’anticolonialisme, l’antifascisme, l’antiracisme étaient des évidences pour nous. Mon père a même eu un blâme de l’État pour être sorti de son devoir de réserve le jour où il a publiquement soutenu l’indépendance de l’Algérie dans un sermon à la synagogue.
Mes parents ont vécu l’occupation. Mon père était résistant dans un maquis du Sud-Ouest. Ma mère, qui était juive, portait l’étoile pendant la guerre mais elle a pu étudier à Paris parce que son père était un ancien combattant. Elle a bénéficié d’un numerus clausus, droit accordé aux Juifs jusqu’en 44.
Les souvenirs de l’occupation étaient ainsi omniprésents dans notre enfance : on en parlait tout le temps. Ça a eu une grande influence sur mes choix, lorsque j’ai été confronté à l’occupation en 67. J’étais venu dans la « ville sainte » pour étudier le Talmud et je n’avais aucune conscience politique. J’ignorais l’histoire récente d’Israël, qui ne m’intéressait pas. Je savais qu’il y avait un conflit avec les Arabes, sans plus. Et voila que je me trouvais confronté à une occupation… Ce mot, « occupation », a tout de suite résonné en moi, même si, à cette époque, je pensais qu’Israël était la victime.
Pourquoi étiez-vous venu en Israël ?
J’étais un élève indiscipliné et je n’aimais pas le milieu bourgeois de Strasbourg. J’étais sous le regard permanent de la communauté, car j’étais le fils du rabbin. Et puis Jérusalem comptait les meilleures écoles talmudiques…
Surtout, ma famille et moi étions déjà venus - trois ans plus tôt - pour une année sabbatique. Nous étions tous tombés amoureux fous de Jérusalem. Une véritable épidémie ! Dès ce moment, j’ai su que je partirais un jour pour Jérusalem. Pas en Israël, à Jérusalem ! Là, il y avait toute une histoire, toute une spiritualité. Avant 1967, c’était une ville très différente d’aujourd’hui : très isolée, entourée d’ennemis, peu israélienne finalement. Elle ressemblait davantage à un agglomérat de bourgades juives d’Europe de l’Est et du Maghreb qu’à une ville moderne comme Tel Aviv. Aujourd’hui encore, Jérusalem est une ville qui se projette dans le passé et dans l’avenir mais pas dans le présent.
Aviez-vous l’intention de rester longtemps à Jérusalem ?
Pas du tout : je pensais rester quelques années pour étudier le Talmud puis rentrer en France. Mais l’amour de cette ville m’a retenu, et l’année 1967 m’a « naturalisé » israélien. Je me sentais partie prenante de la peur qui avait précédé la guerre, de l’émotion qui a suivi la victoire « miraculeuse » – j’y croyais à l’époque.
Quelle impression vous a fait la société israélienne à votre arrivée ?
J’ai véritablement rencontré la société israélienne à Tel Aviv. Je m’y promenais en 1965-66 avec mon cousin, un Israélien typique né dans cette ville. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup d’activités culturelles : le grand sport consistait à faire des allers-retours sur l’allée principale et, à la rigueur, à s’acheter une glace. On appelait ça « se dizengoffer » – du nom de la rue Dizengoff. Il y avait beaucoup de monde, les gens se cognaient et je m’excusais à chaque fois. Tout d’un coup, mon cousin m’a dit : « Arrête de te conduire comme un youpin ». C’est-à-dire : comme un Juif de la diaspora, pas macho, trop poli. Ça a été très net pour moi : il m’a montré ce que je ne devais pas être, soit le « nouvel Israélien », l’antithèse du Juif de la diaspora.
Quels sont les évènements qui vous ont marqué ?
Juin 1967, d’abord, plus précisément une quinzaine de jours après la fin de la guerre. Mon père était venu avec une délégation de sa communauté pour se recueillir sur les lieux saints. Un jour, il m’a demandé de le remplacer et j’ai emmené son groupe à Hébron, en Cisjordanie. Je négociais une camelote quelconque avec un commerçant âgé qui me parlait comme un occupé parle à un occupant, alors que j’agissais comme le propriétaire des lieux… Je me suis regardé faire, et ça a été un véritable coup de poing dans le ventre.
Le même soir, je suis allé voir mon père. Et je lui ai dit qu’il y avait une occupation, et que c’était nous les occupants, alors que toute notre histoire avait été celle des occupés, des exclus, des réprimés, des victimes du racisme. Tout d’un coup, j’étais de l’autre côté… Et ce n’était pas une place que je pouvais assumer : être le pouvoir, le dominant était quelque chose que je n’arrivais pas à digérer.
Les premiers jours de la guerre du Liban, en 1982, m’ont également profondément marqué. Jusqu’alors, notre militantisme se situait à la marge : sur la question palestinienne, il y avait dans la société israélienne un large consensus, sans opposition ni mouvement de la paix. Jusqu’à ce qu’émerge - à ce moment - un mouvement plus ample, que nous sortions de la marginalité.
En 1982, j’ai refusé de rejoindre mon unité et j’ai fait de la prison militaire - comme beaucoup d’autres. Ça a été ma nouvelle naturalisation israélienne. Je me suis senti enfin capable d’être membre de cette société comme opposant, et non pas comme exclu ou marginal. Parce qu’il y avait un mouvement de masse en développement, qui rentrait dans une dynamique. Parce que je pouvais m’exprimer en tant que soldat, en tant que citoyen, et pas seulement en tant que gauchiste marginal.
Mais le moment que je considère comme sans doute le plus émouvant de ma vie s’est déroulé quand j’étais inculpé pour soutien à une organisation illégale. Mon procès durait depuis un certain temps. Un jour, un de ces militants palestiniens dont j’ai parlé auparavant, celui pour qui j’avais le plus d’amitié, qui avait une grande rigueur morale – il avait refusé deux fois d’être libéré car, selon lui, d’autres le méritaient plus que lui – est décédé, peu après après avoir été libéré en raison d’une grave maladie. Il était très aimé et respecté à Jérusalem. A l’enterrement, il y a eu une manif monstre et tous mes copains ont déserté le procès pour la rejoindre. Je suis resté avec les juges, mon père et ma femme (qui était aussi mon avocat) et on a demandé une interruption d’audience. C’est ainsi qu’on a pu participer à la manifestation qui passait sous les fenêtres du tribunal.
Quels souvenirs gardez-vous de votre expérience dans l’armée ?
En 1968, mon unité a été envoyée à côté de Bethléem, dans les Territoires occupés. Il y avait un couvre-feu qui durait depuis des semaines, mais des missiles avaient été envoyés sur Jérusalem depuis le côté palestinien. Le colonel nous a alors dit : « On est là pour faire craquer la ville, pour obtenir des informations sur ceux qui ont lancé ces missiles. ». Et ce jour-là, pour la première fois, j’ai refusé. Je suis allé voir mon colonel et je lui ai dit que je n’étais pas fait pour ça. Il m’a mis en détention pour deux heures, avant de me charger de la cuisine… J’ai finalement été réformé, ça m’a pris deux ans.
Comment avez-vous vécu le fait de vivre en marge ?
La meilleure manière de répondre à cette question est de parler de mes enfants. Mon fils est né en 1972, il a grandi dans l’ostracisme et l’isolement. Il était même honteux de nous avoir comme parents à cause de la pression sociale : dans la rue, dans les journaux, on était traité de fous dans le meilleur des cas, de traîtres dans le pire. D’autant que ma femme était très médiatisée parce qu’elle était une avocate défendant les Palestiniens. Elle était surnommée « la pute des Palestiniens » ou « la pute des terroristes ». Quand il avait sept-huit ans, mon fils ne marchait jamais sur le même trottoir que sa mère… Depuis, il est devenu très bagarreur, il a appris à se défendre.
Ma fille est née en 1982, elle a grandi avec le sentiment que tout le monde était à gauche. 1982 a été une renaissance pour nous tous : nos manifestations drainaient du monde, on avait l’impression d’être devenus normaux.
La période d’isolement qui a précédé n’était pas problématique pour moi, mais elle l’était pour mon environnement. Même à Strasbourg, on disait à mon père : « Votre fils est un terroriste ! » Ce à quoi il répondait : « Je respecte toutes les valeurs de mon fils. Je ne regrette qu’une chose : c’est qu’il ne le fasse pas en tant que Juif pratiquant », parce que je n’étais plus religieux. Mon père a émigré en Israël à sa retraite, car ses enfants étaient ici. Il n’a pas loupé une session de mon procès. Interviewé par un journaliste sur ma supposé traîtrise, il a répondu : « Et nous, dans la résistance, on n’était pas des traitres ? »
Comment êtes-vous entré en relation avec la société palestinienne ?
Au sein du petit groupe que j’ai intégré en 1968, la première chose qu’on a faite après le début de l’occupation a été d’y chercher des partenaires qui pensaient comme nous. On les a vite trouvés et, avec le temps, des liens se sont tissés. On avait des contacts réguliers, on menait des actions communes pour protester contre la répression, pour manifester notre solidarité avec les prisonniers politiques. Il y avait aussi l’échange. Nous voulions comprendre. Et eux aussi voulaient savoir comment fonctionnait notre société. Dès le début de mon militantisme, ça a donc été la chose la plus naturelle.
Pendant mon procès, très médiatisé, les gens se sont étonné : « Qui sont ces gens ? Ils ne sont pas des terroristes, c’est bizarre. » À l’époque, une association israélo-palestinienne semblait invraisemblable… Lors d’une interview, alors qu’on venait de rencontrer l’OLP, le journaliste nous même a présentés comme les précurseurs du dialogue israélo-palestinien…
Mais ce n’était pas un évènement pour nous, c’était la normalité. On rencontrait les Palestiniens comme on le faisait avec les militants de mai 68 en France ou avec les révolutionnaires du Guatemala. On était des camarades, pas des Juifs conduisant une rencontre officielle. Nous n’avions pas de sentiment historique. Le seul moment particulier a été ma rencontre avec Arafat. Paradoxalement, je suis un des derniers militants israéliens à l’avoir rencontré. Non pas parce que j’avais quelque chose contre lui, mais parce que je n’ai jamais été très « rencontre formelle, poignée de mains et photo ». Je trouvais que c’était une perte de temps… Mais quand il a été enfermé à la Muqata, j’y suis allé pour la première et dernière fois. Parce qu’il ne s’agissait plus de rencontrer un président mais un prisonnier. C’était un acte de solidarité. C’était triste. Très triste.
Quel regard portez-vous sur la société palestinienne ?
Depuis quarante ans, je pense être un des Israéliens qui la connaisse le mieux. À une époque, je dormais davantage en Cisjordanie que chez moi…
Pendant les réunions, les Palestiniens me disaient : « Reste avec nous, tu es l’un des nôtres. ». Mais j’ai toujours voulu montrer que j’étais un invité, et pas l’un d’eux. Mon choix était de militer en tant qu’Israélien, c’est là que je me sentais le plus utile. Et je n’aime pas faire semblant d’être Palestinien. C’est peut-être – avec la fainéantise – l’une des raisons pour lesquelles je ne parle pas arabe, même si je l’ai étudié pendant longtemps.
J’ai aussi été toujours conscient du regard colonial condescendant de celui qui a le pouvoir sur celui qui n’en a pas, même chez les gens de gauche. On peut facilement tomber dans le paternalisme ou - au contraire - dans le suivisme. J’essaie donc de rester modeste : je ne suis pas le mieux placé pour juger et apprécier. Je suis trop conscient de la mentalité coloniale qui nous touche tous, y compris les plus « pro-palestiniens ».
Mais je ne vais pas éluder la question. J’ai évidemment un certain regard sur la société palestinienne : celle-ci est en mauvais état. À mon avis, on a sous-estimé l’impact néfaste de l’opération « Rempart » de Sharon dans les Territoires. On a vu le sang, les morts, les maisons détruites, mais il y avait beaucoup plus « grave » que ça : l’effet « Knock-Out ». Les morts sont morts : c’est triste, mais c’est comme ça. Par contre, ceux qui restent sur pieds sont plus atteints que les morts. C’est une société cognée, groggy.
On sent quand même que cette société se reprend en main aujourd’hui, même si la reconstruction du mouvement national va prendre du temps. Nos camarades de la gauche palestinienne sont au début d’une réflexion sur la nouvelle donne, notamment par rapport à Obama. Et ils sont pour l’instant davantage réactifs - aux initiatives internationales et arabes - qu’actifs.
Mais si je devais faire un ultime bilan, je mettrais en avant la capacité de résilience. La société palestinienne n’est pas à genoux, elle fait le dos rond. Même les plus réalistes des cadres politiques, qui réalisent que l’avenir proche ne sera pas radieux, ne sont pas abattus.
Qu’est-ce qui n’a pas marché, au départ ?
Le sionisme se définit comme un mouvement de colonisation. Ce sont les mots qu’il utilise lui-même : « Yichouv », utilisé aujourd’hui pour « localité », se traduit littéralement par « colonie ». Le sionisme s’est donné pour objectif d’établir un projet colonial de peuplement. Comme ce fut le cas en Australie ou en Amérique, là où on estimait qu’il s’agissait de terres sans peuple. Au 19e siècle, l’Europe voyait le tiers-monde comme une grande jungle, avec des indigènes certes, mais aussi des autruches, des chameaux et des palmiers. Cela faisait partie de l’environnement… En cela, le sionisme n’est pas différent des autres mouvements coloniaux.
Mais comme cette terre n’était pas sans peuple, il y a eu conflit. Au début, l’immigration ne gênait pas les Arabes sauf qu’ils ne comprenaient pas qui étaient ces Juifs avec une culotte courte, un chapeau idiot et parlant yiddish, si différents de ceux qu’ils connaissaient. C’est pour cela qu’ils dissociaient Juifs et sionistes. Les Juifs étaient ceux de Palestine. Il n’y avait donc pas de regard négatif au départ comme souvent au départ dans le monde colonial. Il y avait de la place pour tout le monde. Et puis, d’un coup, il y a eu ce projet agressif : « Pousse-toi que je m’y mette. » Le cœur du conflit, c’est la colonisation.
Vous avez dit qu’en arrivant en Israël, vous étiez « sûr de votre bon droit ». Pouvez-vous détailler ?
A l’époque, je ne savais pas qu’il y avait des Arabes. Enfin, je le savais vaguement. Pour moi, il y avait l’État d’Israël comme il y avait la France, l’Espagne… Je ne voyais pas le problème. À l’époque, on ne connaissait pas la dimension coloniale de ce conflit.
En 1967, est sorti un numéro spécial de la revue Les Temps modernes animé par Sartre lui-même. J’étais allé à l’une de ses conférences, comme un groupie fanatique. Dans ce numéro, il donnait la parole à des Juifs et des Arabes – à l’époque, le mot « Palestinien » ne s’était pas encore imposé. Il y avait, je crois, un article sur les tous premiers feddayins. Et surtout une introduction de Maxime Rodinson sur Israël et le fait colonial. Ce qu’il disait il y a 40 ans est encore pertinent aujourd’hui ; il n’y a pas à changer une ligne, c’est une excellente grille de lecture.
Quel est votre avis sur la question des réfugiés ?
C’est une question fondamentale, les réfugiés sont au cœur de ce conflit. Il n’y aura pas de solution tant que ce ne sera pas réglé, juste des trêves ou des cessez-le-feu.
Sur cette question, je reste très marginal, y compris dans le mouvement de la paix. Pour moi, il ne s’agit pas de reconnaître formellement le droit au retour, ni de seulement reconnaître nos torts pour qu’en échange ils ne reviennent pas. Tant qu’on n’aura pas réouvert nos portes aux Palestiniens, nous ne serons pas une société normale. Nous ne serons pas débarrassés des démons de la naqba3.
Il y a cette peur dans l’inconscient collectif qui, fondamentalement, n’est pas tournée vers le nucléaire iranien ou les armées arabes. Nous existons par la négation de l’autre. Et l’autre est vivant. Ce n’est pas l’Indien d’Amérique. On ne peut pas supprimer les cauchemars qui hantent nos nuits avec des accords politiques. Cette angoisse existentielle sera présente tant que les Palestiniens ne pourront pas revenir. Il faut une véritable possibilité du retour et pas seulement la reconnaissance d’un droit. Évidemment, ça remet en cause la notion d’État juif…
Un an après la guerre à Gaza, l’objectif de cette intervention reste obscur. Qu’en pensez-vous ?
Honnêtement, je ne comprends pas le fossé gigantesque entre la brutalité des moyens mis en œuvre et la réalité de la menace. Personne ne pourra me convaincre que les quelques « pétards » envoyés depuis Gaza expliquent quoi que ce soit. Les dirigeants politiques et militaires israéliens n’ont jamais pris ça au sérieux et se foutent de Sderot : ils n’ont jamais vu une quelconque menace existentielle là-dedans.
Au fond, il peut y avoir plein de raisons… Nous nous étions cassés les dents au Liban et, comme à chaque fois, nous avons voulu faire croire qu’il s’agissait d’une erreur de parcours, que nous gardions notre pouvoir de dissuasion. Mais en agissant contre des citoyens, on a simplement montré notre brutalité…
L’intervention se situe aussi dans le cadre de la stratégie israélienne – qui n’est plus la stratégie américaine – de guerre globale et permanente néoconservatrice. Nous avons élu le père penseur de cette stratégie, Netanyahu, et nous sommes comme sous l’ère Bush, à estimer qu’il faut imposer l’hégémonie israélo-américaine sur le Moyen-Orient sans passer par des négociations. Qu’importe si cela s’est soldé par des échecs au Liban ou à Gaza… C’est pour ça que le discours du Caire d’Obama a fait transpirer les dirigeants israéliens, en raison des paroles d’apaisement vers l’Islam et de la fin de cette vision centrée sur « l’axe du mal ». En Israël, c’est un avis largement partagé qu’Obama est une parenthèse. C’est un manque de respect envers le président d’un pays dont on est entièrement dépendant. Et c’est un mauvais calcul car même les Républicains n’aiment pas ça…
Quelles sont vos impressions quant à l’avenir du conflit israélo-palestinien ?
Gaza et les dernières élections sont un indicateur terrible d’un glissement vers l’extrême-droite. Israël est désormais une société néoconservatrice ayant subi un énorme recul par rapport à la période 1982-2000. Cette période correspondait à une phase d’ouverture, avec une société assez forte pour se décrisper. Il y avait une volonté de normalité, le processus d’Oslo était largement soutenu. Ce n’était pas seulement une ouverture politique, c’était aussi culturel : tout d’un coup, on parlait de 48, des réfugiés, de notre responsabilité. Ce n’était pas marginal, une grande partie de la société participait à ce débat. C’était un mouvement très majoritaire parmi les intellectuels, les médias, les universitaires. Et puis, en 2000, il y a eu une rupture historique.
Il ne faut pas sous-estimer le discours de Barak après Camp David stigmatisant la soit-disant ingratitude d’Arafat. Ce qui a été dévastateur, c’est la deuxième partie de ce qu’il a dit, lorsqu’il a « démasqué » les véritables intentions des Palestiniens et le plan diabolique d’Arafat derrière son prix Nobel, la modération de ses propos et le processus de paix. Dire qu’Oslo était l’antichambre d’Auschwitz était la manœuvre non-militaire la plus intelligente du point de vue de Barak. Il se posait en Zorro arrivant au bon moment pour nous sauver ! La reconquête ! En faisant ça, il a détruit ce que les Palestiniens avaient acquis en souveraineté et légitimité. Son discours a aussi mis à bas ce qui faisait la substance du mouvement de la paix qui cherchait le dialogue. On est revenu à la menace. Dans ces conditions, il fallait faire une guerre préventive, construire un mur, se protéger contre les barbares. Il y a eu un glissement du terrorisme qui est devenu terrorisme islamique. Le problème n’était plus Arafat mais les pays arabes, l’ensemble de la civilisation musulmane qui menaçait le monde libre. Voilà comment nous sommes revenus en plein choc des civilisations.
Tout le monde n’était pas d’accord avec cette vision des choses. Mais il y a eu le 11 septembre et tout le monde a dit : « Ils veulent nous massacrer ». Le retour à la normalité, vers la paix, s’est refermé. On est revenu à une société de droite.
Je partage malheureusement ce qu’a écrit le chroniqueur Gideon Levy dans Haaretz : la gauche est morte pour les vingt années à venir. J’espère qu’il se trompe et que ça ne durera que dix ans, mais j’ai peu d’espoir à court terme d’un retour à une période d’ouverture comme dans les années 1980. Maintenant, rien ne bouge. Il n’y a pas eu de mouvement pour la paix pendant Gaza. Ce n’est pas une surprise, mais une tristesse. A part un noyau dur, ce qui était un mouvement d’opinion pacifique modéré ne s’est pas exprimé. Le mouvement de la paix a cautionné la guerre, l’a justifiée.
Et quel est votre point de vue sur l’avenir de la société israélienne ?
L’ouverture de la politique va de pair avec l’ouverture de la société et vice-versa. Dans les années 1980, il y avait une réelle ouverture sociale. A l’époque, je commençais le journal par les pages culturelles. Il y avait une volonté de modernité. A cette époque, la cour suprême a entrepris un processus de rééquilibrage entre démocratie et sécurité, entre un peu moins de juif et un peu plus de démocratie, en terme de droits maritaux, d’homosexualité...
Depuis 2000, la société est devenue beaucoup plus raciste. Dans les années 1980, les jurisprudences de la cour étaient courageuses. Par exemple, la torture avait été interdite et les consignes étaient respectées. Depuis 2000, on ferme les yeux. On est en guerre et la cour suprême a changé ses jurisprudences. Maintenant, certaines formes de pression physique et modérée (!) sont tolérées.