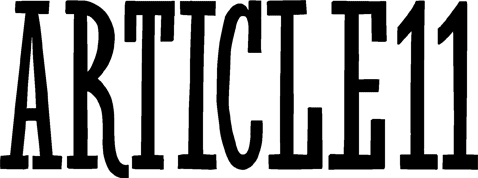jeudi 22 décembre 2011
Entretiens
posté à 16h33, par
54 commentaires
Timing parfait : publier un entretien avec Serge Latouche deux jours avant Noël, c’est taper sur le crapaud au moment même où il est gonflé à bloc. Alors que le délire consommateur est à son apogée, il nous semblait précieux de donner la parole à un des théoriciens majeurs de la décroissance et de l’après-développement. Loin de l’imposture verte, du développement durable et du green-washing.
Contrairement aux attentes de Karl Marx, la société de consommation n’a pas encore produit son antidote. Les crises économiques, écologiques, sociales et culturelles s’empilent et s’entretiennent, librement et sans entrave. Dirigeant le système vers l’auto-destruction. Ce qui aura peut-être l’avantage de laisser une petite chance à l’alternative d’une société de prospérité sans croissance. Rencontre avec Serge Latouche, théoricien de l’après-développement.
Généalogie et filiation intellectuelle
« La décroissance est le fruit de la rencontre d’un mot et de mouvements d’idées plus anciens. La revue Silence, l’une des rares revues écologistes en France, souhaitait faire un numéro sur ce thème au début de l’année 2002. Le mot faisait encore uniquement référence au titre en français de l’œuvre de Nicholas Georgescu-Roegen1.
Comme j’étais engagé depuis longtemps dans une critique du développement, et encore plus dans une dénonciation de l’imposture du développement durable, j’ai écrit pour ce numéro un article intitulé À bas le développement durable, vive la décroissance conviviale. Au même moment, une petite association qui regroupait les amis de François Partant et dont j’étais le président à l’époque, La ligne d’horizon, organisait un colloque. Nous étions une petite organisation mais nous voulions faire un grand débat, qui a finalement eu lieu en mars 2002, et qui s’appelait Défaire le développement, refaire le monde. Il y a eu un télescopage entre ces deux évènements, et le colloque est devenu l’acte fondateur du mouvement de la décroissance. À la fois comme mouvement de réflexion spécifique et comme mouvement social et politique.
Évidemment, il y avait en amont un long parcours de critique du développement avec cette association. Cette critique du développement concernait alors surtout le Sud. Nous étions tous des gens du Sud ou ayant travaillé dans le Sud. Nous constituions une petite internationale anti-développementiste, ou post-développementiste, comme le suggérait le titre de la publication : After development, What ? What concepts ? What symbols ? What images ? Bien sûr, en faisant la critique du développement, nous étions amenés à faire la critique de la croissance. Mais notre clientèle, c’était le Sud. Au Nord, il y avait déjà une critique de la société de consommation. Avec Baudrillard, notamment...
La sortie de ce numéro de Silence et la préparation du colloque ont marqué un tournant. Un déplacement, d’une pensée orientée vers le Sud à une réflexion globale. François Partant avait écrit La fin du développement, j’avais écrit de mon côté Faut-il refuser le développement ?. Enfin, Wolfgang Sachs, qui coordonnait cette internationale de disciples d’Ivan Illich, avait publié un ouvrage collectif intitulé Le Dictionnaire du développement.
Notre critique du développement n’était pas fondamentalement écologique. L’écologie était même totalement absente de ma réflexion personnelle. C’est venu beaucoup plus tard. On ne peut pas en dire autant pour tout le monde, pour Illich notamment, mais c’était secondaire. Nous n’avions pas en tête la catastrophe écologique. Le développement nous semblait avant tout profondément insatisfaisant. Contradictoire, même. C’était une critique culturelle. Nous analysions le développement comme processus d’occidentalisation du monde. Nous nous attaquions au paradigme occidental parce qu’il était uniformisateur, déculturant, ethnocidaire.
Ce qui a été caractéristique, à mes yeux, quand j’ai été amené à écrire des articles sur la décroissance pour plusieurs dictionnaires, c’est la spécificité provoquée par l’adjonction, à un moment donné, d’un mot à un courant. Un peu comme s’il s’agissait d’une mayonnaise. Il y avait l’huile, le jaune d’œuf, mais ça ne s’était pas vraiment mélangé... Le mélange s’est réellement produit quand on est passé à une réflexion plus globale en s’adressant aussi à des gens du Nord qui cherchaient une alternative à un système en crise : la société de consommation, de croissance. Nous avons dû réaliser la synthèse du courant dont nous étions issu - la critique culturaliste du développement, et plus largement la critique culturaliste de l’Occident - et de la critique écologique, celle de Nicolas Giorgescu-Roegen, ou encore le point de vue des écologistes du Club de Rome2. Cela a permis d’élargir le message, avec l’idée que nous vivons dans une société dominée par une économie de croissance, aussi bien au Nord qu’au Sud, et que nous devons en sortir. Parce que cette société de croissance n’est pas souhaitable, et parce qu’elle n’est pas soutenable. On peut partir indifféremment de l’un des deux points de départ de la réflexion. Ils sont finalement profondément liés.
La réflexion d’Ivan Illich a été très importante - mais il faut aussi mentionner ce qui peut la compléter ou la précéder. Je pense notamment à Jacques Ellul avec sa critique de la technique. À Bernard Charbonneau, ce personnage un peu insituable, lié à Ellul, dont il a fait la critique, et qui est à l’origine de l’écologie politique : la critique du développement et la critique écologique étaient déjà liées chez lui. André Gorz avait, lui aussi, fait cette synthèse bien avant nous en utilisant le mot écosocialisme ; j’étais en relation avec lui, mais je ne connaissais qu’une partie de son œuvre, principalement sa critique du travail. En creusant un peu, je me suis rendu compte qu’il avait déjà tout dit. Il utilise même parfois le mot décroissance. Avant de mourir, il a participé à l’un de nos numéros de la revue Entropia, et il a écrit plusieurs articles dans lesquels il manifeste clairement son adhésion à la décroissance.
L’autre source très importante pour moi, au niveau de la réflexion sous-jacente, de l’analyse de la dynamique de la société et de la philosophie sociale qui l’accompagne, c’est Cornélius Castoriadis. Bien qu’il ait peu écrit sur le sujet, il y a quelques textes dans lesquels il se montre radicalement critique face au développement. Avec sa conception de la société comme institution imaginaire, la croissance et le progrès deviennent des significations imaginaires sociales. C’est un point très important dans la construction de ma démarche critique. »
Renforcement des théories de l’après-développement face aux crises actuelles
« Elles ne se renforcent pas. Nous disions que l’on allait droit dans le mur. Eh bien, on y est. Nous ne sommes bien entendu pas les seuls à l’avoir annoncé... mais nous pensons par contre que notre projet est la seule alternative possible, comme l’ont écrit un certain nombre d’auteurs liés à la décroissance, sans se connaître d’ailleurs (il s’agit de Paul Aries et de Paolo Cacciari) : décroissance ou barbarie. En référence à ce mouvement, Socialisme ou barbarie3. Si la décroissance est un écosocialisme, alors nous nous plaçons dans le droit fil. Écosocialisme ou barbarie, je crois que c’est plus vrai que jamais...
Nous sommes coincés par la crise qui nous impose une austérité forcée, une croissance négative - ce n’est pas du tout la même chose que la décroissance choisie, ou société d’abondance frugale. Pour reprendre les termes utilisés par Tim Jackson, mon équivalent anglais qui défend une société de prospérité sans croissance, nous devons désormais faire face à une société de non prospérité avec une croissance négative. C’est ce qu’il y a de pire. J’entendais tout à l’heure l’un des candidats à la présidentielle clamer que la croissance est notre salut. Je pense pour ma part qu’elle n’est plus possible ni souhaitable, tout simplement parce qu’elle nous amène vraiment, très rapidement, à détruire notre système écologique.
Au début de mes conférences, je pars souvent d’une réflexion de Woody Allen : « Nous sommes à la croisée de deux chemins. L’un mène à la disparition de l’espèce, l’autre au désespoir absolu. » Et il ajoute : « J’espère que l’on va faire le bon choix ».
Le chemin qui mène à la disparition de l’espèce, c’est celui de la croissance. On le voit maintenant, avec le dérèglement climatique, la disparition de la biodiversité... c’est évident pour tout le monde, sauf pour ceux qui ne veulent pas le voir, à commencer par nos responsables politiques et économiques. Et l’autre chemin, qui mène au désespoir, est celui que nous connaissons depuis septembre 2008 et la faillite de Lehman Brothers. C’est la société de croissance, sans croissance. Et il n’y a rien de pire. Au moins, quand la société de croissance tourne comme sous les Trente glorieuses, il y a de l’emploi, des ressources budgétaires, pour financer la santé, la culture, l’éducation, et même prendre un peu soin de l’environnement. Là, on voit bien qu’il n’y a plus d’argent pour rien, qu’il faut tailler dans tous les budgets.
Pour revenir à la citation de Woody Allen : aucun de ces deux chemins n’est le bon. Nous devons donc trouver une troisième voie. Une société qui sort du logiciel de la société de croissance qui n’est autre que le logiciel du capitalisme. L’accumulation illimitée du capital n’est qu’un autre nom pour désigner la croissance. Nous devons créer une certaine philosophie des limites, comme toutes les sociétés humaines (sauf la nôtre) en ont connue. Toutes, ou presque, ont su mettre des barrières, des limites à la démesure humaine, à ce que les Grecs appelaient l’hubris. On a vraiment donné corps à cette démesure à partir du XVIIe siècle, quand on a décrété : « Greed is good ». Soit : L’avidité est une bonne chose. Ce message est encore enseigné dans les écoles de commerce aujourd’hui. Alors que c’est justement ce qui nous pousse à détruire le plus vite possible notre environnement ! »
Modèles alternatifs
« Toutes les sociétés humaines avaient domestiqué ou s’efforçaient de domestiquer la démesure, les passions tristes, la soif du pouvoir, la soif de richesses... et y réussissaient plus ou moins bien. Ce n’était pas toujours fameux : certaines d’entre elles se seraient effondrées pour avoir abusé de l’utilisation de leur écosystème, mais elles ne s’en tiraient pas si mal en général. On ne peut plus en dire autant pour nous. Une fois les bornes franchies, il n’y a plus de limite. Quelle était cette limite ? La saturation des besoins. À partir du moment où l’on est dans une société qui repose sur la création continuelle de nouveaux besoins, on voit bien qu’il n’y a plus de limite... S’il n’y a pas de limite à la création des besoins, alors il n’y en a pas à la production et à la consommation, ni à la destruction et à la pollution.
Certains États ont heureusement désormais décidé, en s’inspirant d’une philosophie ancestrale, de répudier cet objectif de croissance illimitée et de retrouver le bien-vivre, tout simplement. On le voit notamment dans ces pays qui ont conservé une importante population amérindienne, en Équateur et en Bolivie. Ces peuples nous disent : « Traditionnellement, l’objectif de nos sociétés, qui ne connaissaient pas le concept occidental de développement, était le Súmac Káusai, le buen vivir ». »
Un espoir au Nord ?
« Il y a toujours des raisons d’espérer, comme de désespérer... Notre histoire est extrêmement riche. Nous avons fait l’expérience d’une erreur, mais nous pouvons la corriger. D’ailleurs, nous n’avons pas toujours été une société de prédateurs ; nous ne sommes pas que cela.
Toutes les philosophies, que ce soit l’épicurisme, le stoïcisme et même, dans une certaine mesure, le christianisme, ont des choses à nous apprendre. Tout n’est pas à garder, évidemment. Le christianisme, en particulier, n’est pas toujours exemplaire dans son rapport à la nature, en dehors de Saint François d’Assise. Par contre, la philosophie antique était basée sur la discipline personnelle, c’est-à-dire la limitation de ce que Spinoza appelle les passions tristes, et sur un système d’éducation et une conception de la Cité mettant au centre la justice. Une idée très forte de la justice, qui fixait des limites. Les gens ne les respectaient pas forcément, puisque les limites sont toujours faites pour être transgressées, mais au moins cette idée existait. Sans limite, il n’y a même plus de transgression possible.
Il faudrait aussi citer nombre de micro-expériences - avec différentes strates et des prises de conscience populaires parfois fortes. En Italie par exemple, avec deux ou trois référendum successifs contre la privatisation de l’eau, contre le nucléaire : une majorité de la population a suivi. À un niveau plus limité, certaines villes ou régions ont fait le choix de s’engager dans des expériences alternatives. Je pense au mouvement des villes en transition, des villes vertueuses, des villes lentes... Et à quantité d’initiatives à la base, comme les AMAP4, les SEL5, etc. Nombreux ceux qui ont pris conscience des enjeux, agissent dans ce sens, modifient leur façon de vivre. Avec l’espoir que cela fasse tâche d’huile, que cela devienne suffisamment fort dans le mouvement de crise profonde que nous connaissons.
Le titre de l’un des livres de François Partant était Que la crise s’aggrave6. Non qu’il souhaitait que cela aille plus mal. Mais la dynamique des contradictions de la société n’a pas obéi à ce que pensait Marx. Elle n’a pas permis de renforcer une classe porteuse d’un avenir universel. On voit bien que la manipulation, le lavage du cerveau et la colonisation de l’imaginaire sont tels que la société n’engendre pas spontanément son antidote. Elle engendre en revanche un poison dont elle crève. Mais si ce système, comme j’en suis convaincu, s’autodétruit, c’est un champ immense de possibilités qui s’ouvre pour une alternative. C’est ce sur quoi nous travaillons. Nous œuvrons à construire l’alternative à un système qui est en train de se casser la figure. On se heurtera quand même à des tentatives désespérées de défense du système, de défense de certaines formes du système. Cela ne prendra sûrement pas la forme d’une pseudo-démocratie pluraliste, mais plutôt celle d’un pouvoir ultra-violent et totalitaire, dont certains livres de science-fiction ont pu donner quelques illustrations. Je pense à Soleil Vert, par exemple. »
Convergences
« Les menaces se rapprochent. Je crois, tout comme François Partant, à la pédagogie des catastrophes. C’est malheureux, mais dans l’histoire de l’humanité, il est très rare que les bons choix aient été guidés seulement par une aspiration au mieux, par un idéal ou par de bons sentiments. C’est nécessaire, mais ce n’est pas suffisant. Il faut un coup de pied au cul : la menace de la catastrophe.
On voit ainsi très bien comment évolue en France l’opinion publique face au nucléaire. Il y a eu Tchernobyl, mais ça n’a pas suffi. Il y a maintenant Fukushima, mais il semblerait que cet avertissement, pourtant très sérieux, ne suffise pas encore. La prochaine catastrophe sera donc - malheureusement - la bonne. C’est ainsi que les choses évoluent. Il faut juste espérer un changement d’attitude avant qu’il ne soit trop tard. C’est d’ailleurs une expression que l’on retrouve dans le titre de nombreux livres sortis ces dernières années, dont celui de Dominique Belpomme, Avant qu’il ne soit trop tard7.
Je dois être un indécrottable optimiste : bien que je sache qu’il y a des mécanismes d’emballement - en particulier sur le climat - et qu’au delà d’un certain seuil on ne contrôle plus rien, je reste persuadé que l’on arrivera à s’en sortir. On ne s’en sortira peut-être pas tous, par contre. La vraie question est de savoir si, de catastrophe en catastrophe, seules quelques zones de la planète seront vivables pour quelques millions ou quelques centaines de millions d’individus qui auront alors vraiment compris la leçon et sauront bricoler une nouvelle société, ou si l’immense majorité de l’espèce humaine pourra se lancer dans une nouvelle aventure... je dois dire que je n’en sais rien, il faudrait être un prophète. Mais il faut s’y préparer. Plus tôt on s’attaque au problème et mieux c’est. Nous avons déjà perdu beaucoup trop de temps. »
Face aux sceptiques
« Groucho Marx disait : « Un enfant de cinq ans comprendrait ça ! Allez me chercher un enfant de cinq ans ! » Il faudrait amener, dans les grandes assemblées, à Durban notamment, des enfants de cinq ans qui comprennent déjà qu’une croissance exponentielle, infinie, est incompatible avec une planète finie. Nous dépassons déjà de 50% la capacité de régénération de la biosphère. Pour nous, les Français, c’est 300 ou 400%. Il faudrait trois ou quatre planètes pour supporter un tel modèle. Même un enfant de cinq ans comprend que cela ne peut pas durer. Nos chefs d’État et nos responsables économiques ne veulent pas le comprendre, prétendent qu’il y en a encore pour longtemps, que la science va trouver des solutions. La science ne peut pas créer à partir de rien, il n’y a que Dieu qui fasse ça. Ce ne sont pas les nanotechnologies qui vont nous sauver, elles risquent plutôt d’accélérer la destruction.
L’autre interrogation fondamentale est celle-ci : « vous vous sentez heureux à consommer toutes ces conneries ? ». Il faudrait la poser à tous ces gens qui sont stressés, vivent comme des cons, foutent tout à la poubelle... Si nous n’étions pas intoxiqués par la pub, nous pourrions vivre autrement, sans retourner à l’âge des cavernes. On n’a pas besoin de postes de télévision. Il y a encore vingt ans, on n’avait pas besoin de téléphones portables. Ça n’existait pas. Nous sommes devenus toxico-dépendants. Il suffirait de faire un petit retour en arrière pour voir que l’on peut être parfaitement heureux avec beaucoup moins. La vraie richesse, c’est d’avoir du temps libre, de bons rapports avec ses voisins, sa famille, son épouse... C’est un message de bon sens que n’importe qui peut comprendre... »
Pistes
Pour un bon argumentaire en faveur de la décroissance, vous pouvez lire Vers une société d’abondance frugale8, pensé à cet effet...
On trouvera également quelques pistes dans Décoloniser l’imaginaire9, avec notamment ce petit programme issu de propositions formulées en 1992 par l’INCAD (International Network for Cultural Alternatives to Development) :
- Effacer progressivement (à raison de 20% par an) toutes les dettes des pays du Sud souscrites en raison de projets de développement.
- Réduire le revenu par tête dans les pays du Nord pour le ramener à son niveau de 1960.
- Stopper par des moyens adéquats l’utilisation illimitée du pétrole.
- Réduire la quantité d’électricité utilisée de manière à annuler tous les projets de centrales nucléaires en une dizaine d’années.
- Déconstruire le modèle global d’éducation qui encourage et soutient les États-Nations et leur développement.
- Réhabiliter les systèmes d’éducation pratiqués par des communautés locales en harmonie avec leur environnement culturel et naturel.
- Engager une campagne massive d’information dans le Nord comme dans le Sud sur les méfaits du développement, et en particulier dénoncer le développement comme facteur de paupérisation de la majeure partie du monde.
- Transformer toutes les aides des agences de développement en coopératives décentralisées vouées aux acquisitions et à la régénération de la connaissance, à la prise en compte des modes de vie et des savoir-faire des diverses cultures du monde, pour la poursuite du dialogue interculturel...
1 Demain la décroissance. Entropie, écologie, économie, Lausanne, Pierre-Marcel Favre, 1979, renommé La décroissance. Entropie, écologie, économie dans une seconde édition revue et augmentée, Paris, Sang de la Terre, 1995 . Texte disponible en ligne ici.
2 Groupe de réflexion mondialement connu pour son premier rapport The limit to growth, traduit en français par Halte à la croissance ?.
3 Organisation révolutionnaire créée sous l’impulsion de Cornélius Castoriadis et de Claude Lefort, d’orientation marxiste anti-stalinienne, active de 1949 à 1967.
4 Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne.
5 Systèmes d’échange locaux.
6 Parangon, 2002.
7 Fayard, 2007.
8 Vers une société d’abondance frugale : Contresens et controverses sur la décroissance, Fayard / Mille et une nuits, 2011.
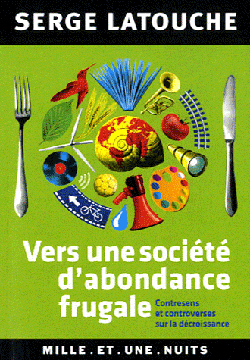
9 Décoloniser l’imaginaire, Parangon/Vs, l’Après-développement, 2002.