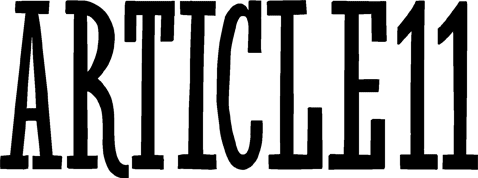lundi 14 novembre 2011
Entretiens
posté à 19h26, par ,
7 commentaires
Dans le milieu du street-art, il fait office de père fondateur : Ernest Pignon-Ernest serait le premier à avoir transféré l’art de l’atelier à la rue. Mais il n’en a cure, laisse à d’autres le soin de discuter les prémices du genre. Loin des chapelles, loin d’un art contemporain vide et stérile, il multiplie les projets enthousiasmants, au cœur des villes, de Naples à Soweto, de Paris à Ramallah. Entretien.
« Le moment que j’adore, c’est celui où je pose mes images : la relation avec les lieux, l’atmosphère urbaine nocturne... Par exemple, coller dans les rues de Naples la nuit est une expérience fantastique. » Il y a plus de cinquante ans qu’Ernest Pignon-Ernest a délaissé la toile au profit des murs, mais il conserve l’enthousiasme des premières fois. Aucune lassitude à l’horizon. En entretien, il ne tient pas en place, saute de sa chaise pour aller chercher un livre illustrant ses propos, s’embarque dans un aparté sur le street-art ponctué d’un grand éclat de rire, oblique vers la poésie de son ami Mahmoud Darwich, rebondit sur ses projets en Palestine, évoque ses démêlées avec les flics algériens… Confus ? Non : vivant. Comme son art.
Ses premiers collages datent de 1966. Il s’agissait alors de dénoncer l’attirail nucléaire enfoui sous les champs de Provence – via la reproduction des silhouettes soufflées par l’explosion d’Hiroshima. Ensuite ? Ernest Pignon Ernest a continué, affûtant sa démarche au fil des interventions graphiques, de Soweto à Naplouse, de Paris à Charleville-Mézières. La ville n’est pas morte, il faut juste la faire (re)vivre en lui offrant des images entrechoquant passé et présent, art et politique, vie et mort : Pasolini et Le Caravage à Naples, les communards massacrés sur les marches du Sacré-Coeur à Paris, les malades du Sida en Afrique du Sud, Rimbaud dans les Ardennes... Retour sur une œuvre qui a pris la clé des villes1.
Les images que vous représentez sont situées, chargées des lieux qui les accueillent...
Ce qui importe dans mon travail, c’est avant tout l’incorporation d’une image dans un lieu, dans une situation. Je cherche à activer les lieux, à exacerber leur potentiel symbolique, historique ou mémoriel. Deux tentatives ont déterminé cette approche. En 1965, j’avais un peu d’argent de côté et je me suis isolé dans le Vaucluse pour peindre sur toile. Je souhaitais réaliser un travail avec une forte résonance politique, et j’ai appris qu’à trente kilomètres, sur le plateau d’Albion, était positionnée la force de frappe atomique : sous le sol de Provence, il y avait mille fois Hiroshima. J’ai tenté de peindre cette puissance de mort, sans parvenir à une transcription picturale. Figer cela dans un tableau me semblait dérisoire, et la perspective de l’exposer dans une galerie à Nice ou Avignon un peu ridicule. En me documentant, j’ai fini par découvrir cette célèbre photo d’Hiroshima qui représente l’ombre d’une personne brûlée par l’explosion, sa trace. L’annihilation de l’homme par l’homme, une vision terrifiante. J’ai donc réalisé des pochoirs reproduisant cette image et l’ai disposée sur les routes, le sol, les rochers, les maisons menant au plateau, à la manière d’une alerte, d’un présage de mort nucléaire. Un signe d’Hiroshima venait donner une autre signification à cette implantation d’armes. Et un tableau n’aurait pu évoquer aussi bien cette confrontation entre puissance de mort et beauté du paysage.
La seconde étape est venue avec mon projet sur la Commune, à l’occasion du centième anniversaire de la Semaine sanglante, en 1971. J’avais énormément potassé le sujet – que je connaissais mal, ayant quitté l’école à 15 ans – et je me suis trouvé face au même type de problème : comment inscrire dans un tableau le potentiel de vie, d’invention de ce que je tenais pour une référence politique absolue ? Je me disais : « Ça va faire un truc de merde, style réalisme soviétique, avec le drapeau rouge... » J’ai alors décidé d’interroger les résonances de ce massacre, les autres tueries qu’il augurait.
« Comment inscrire dans un tableau le potentiel de vie, d’invention de ce que je tenais pour une référence politique absolue ? »
Comme je trouvais le pochoir trop limité techniquement, avec un côté binaire qui ne me convenait pas, j’ai opté pour la sérigraphie, en tirant les images grandeur nature. Au départ, l’approche relevait plus du théâtre que de l’art plastique : une sorte d’intervention ; apparaître puis disparaître. J’ai collé l’image de victimes de la Commune – des gisants – au Père Lachaise, au Sacré-Cœur, au métro Charonne ou sur les Quais de Seine, liant ainsi les morts de la Commune au drame de la guerre d’Algérie, ainsi qu’à la libération de Paris en 1944. L’anachronisme me plaît beaucoup, il peut être très signifiant. Et permet d’entrechoquer les événements de l’histoire contemporaine en utilisant les lieux, l’espace et le temps. C’est l’essence de mon travail.
Le classicisme de vos dessins tranche avec ce que l’on observe habituellement dans la rue...
Le dessin revient aux origines. Je pourrais faire des personnages qui auraient l’air plus modernes en laissant couler de la peinture, ou en ajoutant des effets, mais je n’en vois pas l’intérêt. Je m’en fiche. Je n’essaye pas d’affirmer un style, mais de représenter des signes. Implicitement, je voudrais que mes images soient perçues comme des empreintes de corps ; qu’elles induisent l’absence comme la présence. C’est pour ça que je cite souvent en exemple l’empreinte du corps provoqué par l’éclair d’Hiroshima ou – pour les Catholiques – le Saint Suaire et l’empreinte du Christ, à savoir des images censées ne pas avoir été fabriquées par la main de l’homme. D’ailleurs, je continue à travailler en noir et blanc, grandeur nature, avec du papier et du fusain : des éléments simples, proches des origines. Il n’y a pas d’intermédiaire entre la pensée et la main qui dessine.
Je ne veux pas inscrire mes images dans la hiérarchie de l’art, dans les querelles de modernité. On a dépassé ça. Après Picasso, après l’abstraction – Mondrian, Kandinsky – la catégorisation de l’art est devenue obsolète, dérisoire. Est-ce que Di Rosa est plus moderne que Mondrian ? On s’en fout. On a parfois dit de mon dessin qu’il était académique, on me critiquait pour ça. C’est stupide. D’autant que l’espace que je construis pour mes images n’a rien à voir avec celui de la peinture académique. Inscrire un dessin dans la rue change énormément de choses : je sais qu’il va choper le regard par le côté, et je dois tenir compte de tous les éléments environnants, de la largeur de la rue au mobilier urbain. Si je ne faisais pas ce travail, par exemple, les bras auraient l’air de moignons lorsqu’on les regarde en biais. Il y a un espace très spécifique au dessin collé dans la rue que les gens du milieu de l’art ne savent pas voir, parce qu’ils sont un peu incultes...
« Je ne veux pas inscrire mes images dans la hiérarchie de l’art, dans les querelles de modernité »
Je ne condamne pas la peinture définitivement – je reste obsédé par Guernica et Picasso, par exemple –, mais je ne vois pas dans l’histoire picturale contemporaine d’exemple de peintres ayant réalisé des œuvres témoignant d’événements de l’importance du massacre du métro Charonne en 1962 ou des guerres coloniales. Transposés sur un tableau, ces sujets deviennent anecdotiques.
La poésie et la littérature occupent une place importante dans votre travail...
Les questions qui se posent dans le milieu de la peinture ne m’intéressent pas. Actuellement, l’art contemporain ne fait qu’interroger l’art contemporain. Les transgressions ne sont que des transgressions de rien du tout, ne rencontrent aucune résonance en dehors d’un milieu clos. Je suis d’ailleurs plutôt en froid avec les institutions, les musées du type Beaubourg, que je trouve quasiment corrompus ou, en tout cas, alignés sur le marché international. Dans ma vie de tous les jours et dans mon imaginaire, j’ai donc plus de relations avec les poètes et les écrivains qu’avec les peintres.
Artaud, Desnos, Neruda, Pasolini, Rimbaud, sur lesquels j’ai travaillé et que j’ai représentés, incarnent et portent les stigmates de leur pays, de leur histoire, de leur époque. Jusque dans leurs gueules. Genet par exemple, la tension qui l’anime – entre ce coté voyou-voleur, sa quête de temps, de rituel, et le classicisme de son écriture – porte les contradictions de notre société, notamment autour des guerres coloniales. Pour l’instant, j’ai posé une première image à Brest, qui fait référence à son livre Querelle de Brest. On y voit trois mecs, la lecture est ambiguë : c’est une rixe qui ressemble à une descente de croix. Pour Rimbaud, j’ai peint une première image en 1977, tirée en sérigraphie, et je l’ai collée sur des routes menant à Charleville. Chaque portrait était différent par son environnement, ce qui empêchait de le figer. Une approche mille fois plus rimbaldienne que le grand marbre de Rimbaud qui trône à Charleville – une contradiction absolue avec ce que représente le poète.
Pour une telle démarche, Naples semble être la ville idéale...
Naples est un des seuls endroits où je suis retourné plusieurs fois pour coller des œuvres. Cette ville me fascine. Au début, je n’arrivais pas à la comprendre. Le premier jour, j’ai appelé ma compagne pour lui dire : « Écoute, je vais rester quelque temps ici, parce qu’il doit y avoir une grève générale ou un événement particulier : c’est un tel bordel, c’est inouï... » J’ai ensuite compris que c’était toujours comme ça. C’est un bordel que j’adore.
Naples est l’unique ville de ce type en Europe. J’y ai collé plusieurs centaines d’images – je me refuse à tenir le compte exact, ça ne m’intéresse pas – sans jamais rencontrer le moindre problème avec la police. Une nuit où je collais posté sur une échelle, quatre ou cinq flics ont débarqué l’arme au poing, un peu cow-boys, sans doute alertés par des voisins me prenant pour un voleur. Je descends fissa, et le chef me dit : « C’est une image de Caravage que tu colles ? Continue... » Jamais un flic parisien n’aurait reconnu un tableau datant de plusieurs siècles... Je finis de coller, me retourne sur l’échelle, fais une petite révérence, et eux m’applaudissent. Comme au théâtre. Il était trois heures du matin et c’était vraiment une belle scène, typique de Naples : chaleureuse, ironique, vivante...
« Jamais un flic parisien n’aurait reconnu un tableau datant de plusieurs siècles »
J’ai entendu dire que les Napolitains auraient fait en sorte que vos dessins ne disparaissent pas ?
Oui, il y a des dessins qui sont restés plus de dix ans. C’est d’autant plus improbable que je colle du papier journal, le truc le plus modeste qui puisse exister. Mais les gens ont compris le rapport de mes images avec le lieu et les ont adoptées. Quand une « sainte Agathe » reste 12 ou 13 ans, cela implique que les gens sont venus la recoller, ont veillé sur elle. Il y a une séquence que j’aime bien, dans un documentaire tiré de mon travail sur la ville : on voit un jeune garçon commencer à décoller une de mes affiches, avant qu’un de ses petits camarades ne vienne lui glisser quelque chose à l’oreille et qu’il remette l’affiche en place.
Une autre fois, j’avais collé un dessin original – pas une sérigraphie – sur l’église Gesù Nuovo, et je suis revenu plus tard pour la photographier. Quand je suis arrivé, il y avait une affiche de la CGIL (l’équivalent italien de la CGT) qui la recouvrait. Ce sont des choses qui arrivent... Au moment où je fais (quand même) la photo, un type arrive avec un seau d’eau. Il se met à mouiller l’affiche et à l’enlever peu à peu pour faire apparaître mon dessin en-dessous. Quand je suis allé lui parler, il m’a dit : « Mes copains sont des vrais cons. Regardez ce qu’ils ont fait ! Coller là-dessus, faut être stupide ! » C’était un type de la CGIL qui venait de s’engueuler avec ses amis parce qu’ils avaient fait ça.
Récemment, j’ai aussi pris beaucoup de plaisir à travailler en Palestine, de jour cette fois. Je collais des portraits de Mahmoud Darwich, ainsi que des extraits de ses poésies, et les gens étaient parfaits – chaleureux, doux, tous connaissaient et aimaient Darwich. Ils m’offraient des pâtisseries, me parlaient... Il y a une vidéo où on me voit dérouler un grand portrait de Darwich ; une fois l’image apposée, les gens qui m’entourent, très nombreux, lancent des acclamations en scandant son nom. Merveilleux ! Mais cela implique de connaître le cadre, de savoir se faire accepter.
« On me voit dérouler un grand portrait de Darwich ; une fois l’image apposée, les gens qui m’entourent, très nombreux, lancent des acclamations en scandant son nom. Merveilleux ! »
À Soweto, dans la banlieue de Johannesburg, j’ai aussi vécu ce genre de moments. On m’avait dit : « Tu ne peux pas y aller, c’est trop violent. » Finalement, j’ai réussi à me faire accepter. Après que j’aie joué au foot avec l’équipe du quartier, de grands Blacks qui me dépassaient de 30 centimètres, tout le monde me connaissait, m’apostrophait dans la rue.
Lorsque vous travaillez sur un sujet aussi « lourd » que le sida à Soweto, comment procédez-vous pour choisir l’image ?
Le dessin que je collais à Soweto, une femme portant un homme malade du sida, est né de discussions avec les habitants des quartiers. Des gens impliqués dans la lutte contre le sida m’accompagnaient dans les collages, expliquaient ma démarche aux passants, etc. Là, je me suis inséré dans un cadre dépassant mon travail personnel.
Cela s’inscrivait également dans un engagement personnel. J’ai fait partie dès 1980 d’un collectif qui s’appelait « Artistes du monde contre l’apartheid », à la suite de mon travail contre le jumelage Nice/Le Cap2. C’est dans ce cadre que j’ai rencontré Mandela peu après sa victoire. Et j’ai voulu prolonger ça par un travail sur le côté multiculturel de l’Afrique du Sud, un pays qui compte 11 langues officielles, avec toutes les cultures et ethnies du monde... En cherchant mon angle d’approche, j’ai rencontré des gens qui me tenaient tous le même discours : « Il faut travailler avec nous sur le sida. » Et c’est à Soweto que la pandémie est la plus terrible. L’image que j’ai choisie de peindre est née de conversations sur le rôle de la femme, sur l’abandon des malades... Avec cette idée – aussi – de faire un parallèle entre les deux luttes : « On a vaincu l’apartheid, on peut vaincre le sida. » C’est pour ça que mon dessin faisait référence à une photo où l’on voit un homme porter le corps d’un jeune enfant – Hector Pieterson – qui vient d’être tué par la police. C’est une approche subliminale. L’image ne se crée pas comme ça, d’un claquement de doigt, elle se charge de tout un processus de fabrication, de réflexion.
« L’image ne se crée pas [...] d’un claquement de doigt, elle se charge de tout un processus de fabrication, de réflexion »
Vous menez toujours ce travail préparatoire ?
Il y a souvent un gros travail de documentation ; pour Naples, par exemple, j’ai lu une quantité astronomique d’ouvrages afin de maîtriser le sujet. Mais cela peut varier. Pour Mahmoud Darwich, c’est lui qui a voulu me rencontrer après une lecture à Paris, alors que j’étais déjà fasciné par son œuvre. Nous avons discuté et décidé de mener ensemble un projet à Ramallah. Lui avait beaucoup aimé mon projet rimbaldien, mais il est mort un mois avant que je n’arrive en Palestine. Du coup, j’ai décidé d’axer autour de lui mon travail à Ramallah : j’ai fait calligraphier ses textes, j’ai peint son portrait, et je les ai collés dans les maisons détruites, des lieux symbolique de l’horreur du conflit.
Pour Maurice Audin, à Alger, c’était une initiative personnelle, lancée sans rien demander à personne. Je souhaitais depuis longtemps parler de l’Algérie. Et pourtant, je ne me voyais pas parler frontalement de l’Algérie contemporaine et de ses problèmes. J’aime beaucoup ce pays, il me fascine, et je pense qu’on a besoin de pacifier nos relations, de les éclairer. On ne pourra pas le faire tant qu’il restera une chape de silence sur tout ce qu’il s’est passé – sur la torture, sur l’horreur de la guerre coloniale. J’y réfléchissais, et une nuit ça a fait tilt : Maurice Audin ! Ce professeur d’université français est mort sous la torture parce qu’engagé dans la lutte pour l’indépendance. On ne sait pas ce qu’il est devenu. Ce corps disparu, je l’ai vu comme une métaphore du non-dit, incarnation de notre relation problématique à l’Algérie. J’ai appelé Henry Alleg, qui a écrit La Question et a alors médiatisé la question de la torture3, j’ai discuté avec lui, puis avec la veuve de Maurice Audin, et ça m’a conforté dans ma démarche. J’ai donc fait son image, et je suis allé la coller dans Alger. J’ai été arrêté deux fois, mais il y a eu des moments extraordinaires, notamment un jour où des policiers voulaient me prendre mon appareil photo et mes affiches ; un gradé est arrivé, et m’a dit : « Je vous remercie de saluer ce martyr de notre révolution, je vais expliquer à mes hommes qui il était. Continuez. » Je jubilais.
Avec les images, il est toujours possible de parler à l’humanité des gens. Mon ami le peintre Hugh Weiss m’a un jour raconté une histoire magnifique : il servait dans l’armée américaine au Japon et dessinait tout le temps. Lors d’une mission sur une île, il avait posé son arme pour dessiner, lorsqu’il entend un bruit de fusil qu’on arme. Il se retourne et voit un Japonais qui le dévisage, fusil à la main. Après quelques secondes, le Japonais s’en va. Hugh concluait : « Tu comprends, on ne tue pas un mec en train de dessiner. »
1 Pour en savoir et en voir plus, le site de l’Artiste, ici, est un bon début.
2 Pour dénoncer le choix de sa ville natale, Nice, de se jumeler avec le Cap, il colla en 1974 des oeuvres dénonçant l’apartheid sur les murs de la ville.
3 Journaliste franco-Algérien et militant du PCF, Henry Alleg publia en 1958 un récit de son internement par les forces françaises et des tortures subies, La Question. Son ouvrage fit sensation et contribua grandement à relancer le débat sur le comportement de l’armée française en Algérie.