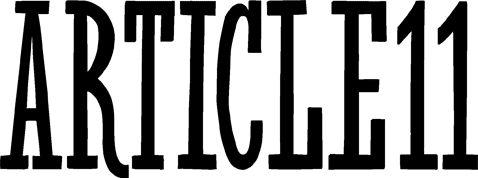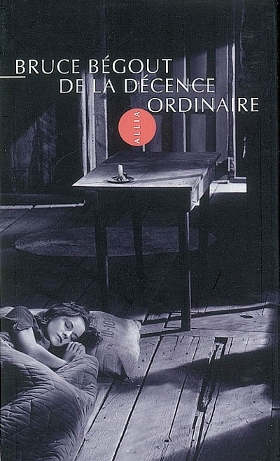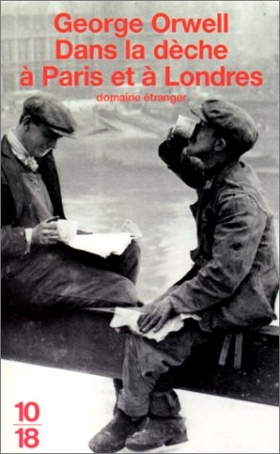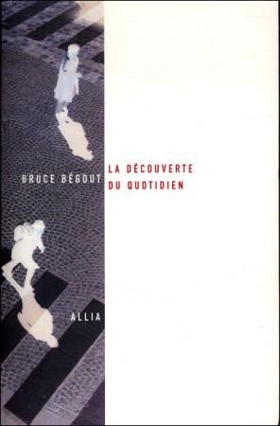mardi 22 décembre 2009
Entretiens
posté à 23h58, par
41 commentaires
Toujours, revenir à Orwell. L’écrivain anglais n’a pas seulement livré une œuvre romanesque passionnante. Mais a aussi analysé avec une rare clairvoyance les problèmes politiques de son temps - et du nôtre. Dans De La Décence ordinaire (2008), Bruce Bégout revenait sur la pensée d’Orwell, analysant une part méconnue et très contemporaine de son œuvre. On a voulu en savoir plus.
Il y a un Orwell que l’on connaît peu, qui est resté dans l’ombre de la figure presque écrasante de 1984. Il est moins facile d’accès, c’est certain. Moins charismatique, aussi : il n’a pas l’attrait prophétique de celui qui - à travers 1984 ou La Ferme des animaux - met à nu les ressorts d’une société totalitaire. Il n’a pas non plus la charge presque mythique de ce combattant de la liberté, volontaire pour rejoindre les Brigades Internationales pendant la Guerre d’Espagne avant d’en livrer un récit magnifique, auréolé de désillusion, Hommage à la Catalogne. Il est plus discret, en quelque sorte.
Il y a deux Orwell, donc. Le premier passé à la postérité historique, le second un brin méconnu. Les deux sont naturellement indissociables : comment comprendre l’Orwell extraordinaire sans connaître son double, homme aux deux pieds solidement planté dans son époque, être assoiffé de simplicité et d’ordinaire ? Tout simplement impossible.
C’est que la majeure partie de l’œuvre de l’écrivain anglais est habitée par une quête de simplicité, de frugalité. Parmi les humbles et les sans-grades, Eric Blair (son nom de naissance) a échafaudé ses réflexions politiques et construit son univers théorique. Question d’affinité - écrivant à Henry Miller, Georges Orwell disait sa préférence pour « une sorte d’attitude terre à terre, solidement ancrée » et expliquait se sentir « mal à l’aise » dès qu’il quittait « ce monde ordinaire où l’herbe est verte et la pierre dure » - mais aussi de conviction : une pensée politique se détachant du quotidien du plus grand nombre se fourvoierait forcément, élitiste et hors-sujet.
Cette part méconnue de Georges Orwell a retenu l’attention de Bruce Bégout. L’auteur de La Découverte du quotidien, de Zéropolis (Allia) et (entre autre) de L’Éblouissement des bords de route (Verticales), en a tiré une étude passionnante. Publié en 2008 aux éditions Allia, De La Décence ordinaire s’articule autour de l’idée de « Common decency » (décence ordinaire, principe théorisé par Orwell) et interroge l’approche politique de l’écrivain anglais, ainsi que ses troublantes résonances contemporaines. Une démonstration limpide sur laquelle il a gentiment et longuement accepté de revenir pour Article111.
Il y a quelque chose de fascinant dans la démarche d’Orwell, ce que vous désignez comme une forme de « démarche auto-punitive ». Issu d’un milieu très aisé, destiné à fréquenter l’élite, il choisit d’aller vivre parmi les déclassés et les miséreux pour dénoncer leurs conditions de (sur)vie. Qu’est ce qui l’a poussé dans cette voie ?
Il est difficile de cerner les divers motifs psychologiques, sociaux et politiques qui ont conduit Orwell à devenir socialiste en 1936. Ce qui est sûr, c’est que lorsqu’il décide d’entrer dans la police impériale britannique juste après sa sortie d’Eton il est sans doute mu par le respect d’une certaine tradition nationale ainsi que par le respect de la volonté parentale. Il ne faut pas oublier qu’Orwell (Eric Arthur Blair) est issu de la moyenne bourgeoisie anglaise, qui est très attachée à l’Empire. Lui-même fait montre d’un goût pour les armes et la discipline militaire, d’un certaine fascination du combat et pour Kipling. Il a su peu à peu transcender ces conditions sociales et ces influences familiales.
Au départ, la critique de ce conditionnement prend la forme brute d’un rejet aveugle et peu réfléchi. Orwell quitte la police impériale et, par une sorte de volonté de mortification, d’auto-châtiment, il s’en va vivre l’existence des gens de peu, des trimards et des vagabonds, ce qui donnera lieu à sa première grande œuvre Down and Out in Paris and London2.
Cette démarche est loin d’être calculée, de s’inscrire dans une vision du monde articulée. Elle repose sur une aversion affective pour les signes les plus visibles de l’autorité. C’est tout. Déjà à Eton, Orwell avait manifesté un mauvais esprit critique sans objet ni méthode. Il était contre, sans trop savoir quoi ni pourquoi. A la fin des années vingt, il ne savait pas encore donner un objet à son aversion existentielle. Il a donc choisi de vivre en marge de la société, comme s’il savait ce qu’il rejetait mais non encore ce qu’il voulait. Il lui faudra presque huit ans pour franchir le pas du socialisme, pour donner à sa critique affective et littéraire de la société anglaise un certain contenu politique. Jusque-là, Orwell tente de partager la vie des déclassés sans pouvoir totalement la comprendre ni se déprendre, comme il l’a avoué à plusieurs reprises de manière sincère, d’un certain préjugé de classe à leur encontre. Avant 1936, il est contre la société, mais non pour le socialisme. Sa révolte demeure personnelle et littéraire, elle n’a pas encore pris un tour politique marqué.
« Il lui faudra presque huit ans pour franchir le pas du socialisme, pour donner à sa critique affective et littéraire de la société anglaise un certain contenu politique. »
Il semble que la Guerre d’Espagne et ses désillusions aient joué un grand rôle dans l’évolution politique de l’écrivain anglais. Est-ce de ce moment qu’il abandonne définitivement le socialisme classique pour forger sa propre approche ?
Je ne pense pas qu’Orwell ait tout d’abord adhéré au socialisme classique. Il a certainement lu Marx, mais sans l’étudier à fond : la doctrine socialiste lui importe peu. Il n’en retient que les grandes lignes, sans suivre l’orthodoxie en la matière. Je dirais que, dès le début, certains sentiments moraux et sociaux ont prévalu chez lui ; et il a su donner à ces sentiments une certaine orientation pratique et politique. Son socialisme est toujours resté en un sens sentimental (mais pas sentimentaliste), fondé sur un sentiment d’injustice, sur le goût de la décence commune et ordinaire, sur cette manière de prendre soin des autres sans vouloir les exploiter ou les dominer qui - selon moi - constitue une sorte d’éthique minimale de la vie quotidienne. Un peu comme pour William Morris, avec lequel il partage de nombreux points communs, notamment le rejet de la société industrielle.
Le socialisme d’Orwell est ainsi fait d’intuitions plus que d’idées. Pour lui, il signifie l’égalité entre les individus, et le respect de leur liberté. Pour ce faire, il faut nécessairement modifier les institutions sociales et économiques qui créent et accentuent ces inégalités, et entreprendre une réforme profonde de l’état social.
La guerre d’Espagne et les événements de Barcelone en 1937 ont été décisifs à cet égard. Orwell y a fait à la fois l’expérience de la solidarité quasi instinctive entre des combattants venant d’horizons divers - et ce sans grand débat politique entre eux sur l’orientation de l’action révolutionnaire (même si Orwell a débattu au sein du POUM de ces thèmes) - et de la trahison des communistes qui, voulant se débarrasser des vrais révolutionnaires, les ont pourchassés, enfermés, tués et ont sali leur mémoire.
Si ce moment est important, ce n’est pas tant pour la formation de son socialisme. Mais plutôt pour la révélation soudaine et violente de la mentalité totalitaire et de ses ravages sur des intellectuels bolchéviques toujours prompts à dissimuler le mensonge et le crime pour le simple profit du parti. Orwell a connu le mécanisme du totalitarisme dans sa chair : rappelons qu’il a échappé par miracle à une exécution à Barcelone. Il a tout de suite perçu les ravages de la propagande et du langage dévoyé. Cela ne l’a pas détourné du socialisme, mais renforcé dans l’idée que le vrai socialisme a plus à voir avec le souci ordinaire des vies simples et humiliées qu’avec la construction idéologique toujours complice d’une violence faite au réel, aux hommes réels.
À une époque où il était de bon ton de céder au messianisme et aux sirènes de l’utopie, Orwell conservait une lucidité étonnante. Vous écrivez : « Le socialisme, tel que le conçoit Orwell, ne vise pas à établir une société parfaite, mais une société meilleure. » Est-ce cette humilité politique qui donne tant de prix à sa pensée ?
Orwell ne partage pas la vision d’une révolution sociale fondée uniquement sur l’appropriation des moyens de production de la société industrielle ; en ce sens, il est précieux pour notre époque. S’il voit dans le capitalisme une forme perverse de domination de l’homme par l’homme, il la dénonce encore davantage dans la société industrielle. Il ne peut donc partager le machinisme et le productivisme béats de certains socialistes des années trente, qui ne jurent que par la croissance et la production pourvu qu’elles soient au main des prolétaires.
Bref, Orwell a beaucoup de mal à admettre la mythologie du progrès que le socialisme relaie et renforce. Son socialisme est la synthèse entre la conservation de certaines traditions populaires non inégalitaires (le pub, la fête, le goût simple de la nature, la solidarité des corps de métier, etc.) et une réforme sociale profonde et totale. Son socialisme est - en un mot - pré-marxiste, il trouve ses racines dans les mouvements communistes non marxistes anglais et français du début du XIXe siècle, d’un âge presque pré-industriel. Son conservatisme, si conservatisme il y a, n’est pas politique (sur ce plan, c’est un authentique révolutionnaire), mais porte sur certains aspects sociaux. Il s’agit de conserver des pratiques authentiques de justice et d’entraide. Et de priser la vie quotidienne et ses plaisirs ordinaires.
Orwell pense donc qu’il faut préserver certaines pratiques sociales et populaires et ne pas transformer l’homme ordinaire en un simple esclave de la machine. Pas pour rester telle quelle, dans une sanctification réactionnaire de la tradition. Non, « conserver, c’est développer », dit Orwell. La préservation de certains aspects doux et bons de la vie ordinaire doit servir de base pour une transformation sociale allant dans le sens de l’extension des valeurs telles que l’égalité, le respect, la décence, etc. L’amélioration est donc la recherche d’un équilibre toujours instable entre la préservation de ce qu’il y a de bon dans cette vie-là, même exploitée et humiliée, et la réforme des conditions les plus iniques de la vie sociale.
Dans ce programme, l’utopie n’a pas sa place, laquelle entend faire table rase de la vie donnée, et tout reconstruire sur une base purement idéelle et théorique. Orwell perçoit très souvent dans le révolutionnaire un homme uniquement gouverné par la haine de soi et par l’absence d’ancrage dans la vie quotidienne (dans ce qu’elle peut offrir de simple, de médiocre, mais de tellement humain). C’est pourquoi il se méfie des fanatiques de la perfection, même morale (les « saints », comme Tolstoï ou Gandhi par exemple). Il ne renonce pas pour autant à l’idée de révolution. Seulement, cette révolution n’aura pas pour but de tout chambouler afin d’introduire un ordre nouveau, un homme nouveau. Mais de briser l’ordre établi qui cantonne les pratiques non dominatrices de la vie ordinaire aux replis obscurs de la quotidienneté : ces pratiques doivent servir de matrice à toute action sociale.
« Orwell se méfie des fanatiques de la perfection, même morale [...]. Mais il ne renonce pas à l’idée de révolution. »
Vous avez beaucoup travaillé sur le thème du quotidien. En quoi le concept orwellien de « décence ordinaire » rejoint votre approche de la question, notamment formulée dans La Découverte du quotidien ?
Mon intérêt pour Orwell est antérieur à la rédaction de La Découverte du quotidien. Mais dans ce livre, je me suis posé certaines questions qui m’ont obligé à prendre en compte de manière plus sérieuse la thématique orwellienne de la « common decency ». En gros, dans La Découverte du quotidien, je m’interrogeais sur les transformations que la quotidianisation opère sur notre expérience du monde. Je remarquais que l’une de ses transformations majeures consistait dans la production d’une ambiance générale de confiance et de familiarité, qui permettait à son tour des activités sociales supérieures, comme une base solide en vue d’une exploration plus approfondie du monde.
J’étais ainsi à la recherche d’un processus interne à la vie quotidienne en effaçant tous les accidents, les gommant ou les intégrant dans une unité vivante rassurante. La décence ordinaire m’est alors apparue comme une qualité quasi éthique de la vie quotidienne, dans sa faculté de créer passivement des liens de confiance et de solidarité entre les hommes ordinaires. L’idée ? Ce que nous avons de plus commun entre nous réside dans les gestes les plus ordinaires. Le quotidien est donc porteur d’une certaine capacité d’attachement entre les hommes, attachement qui peut aller jusqu’à un respect prélogique et un sens quasi naturel de la mutualité. Si le mal est toujours vécu comme une violence faite à la quotidienneté, rupture soudaine et traumatisante, irruption déchirante, cela veut dire inversement que la continuité en apparence banale de la quotidienneté a le pouvoir d’engendrer une sorte de bien minimal, non le Bien au-delà de l’Être de Platon, le Bien comme valeur absolue, mais une forme pré-morale de bonté, de douceur, de respect.
C’est justement ce que j’ai reconnu dans la « common decency » d’Orwell. Non pas tant une moralité innée, naturelle, mais une pratique ordinaire de l’entraide, de la confiance mutuelle, des liens sociaux minimaux mais fondamentaux. Cela ne constitue pas une morale en bonne et due forme, mais assure un sens spontané de ce qui doit se faire ou ne doit pas se faire. C’est là, me semble-t-il, la clé de la décence ordinaire. C’est cette faculté même d’être attaché aux autres dans leur caractère ordinaire, qui est aussi le nôtre, qui nous prévient contre toute action violente contre eux, contre toute volonté de domination. Cela ne veut pas dire que les gens ordinaires ne peuvent pas être pervers, mais que cette perversion nécessité la rupture totale avec leur monde de la vie, avec cette assise naturelle de l’existence. C’est d’ailleurs ce que montre l’historien C. Browning dans Des Hommes ordinaires, qui raconte comment des policiers de réserve de Hambourg sont engagés sur le front de l’est pendant la Seconde Guerre mondiale et vont pour la plupart se livrer à des crimes de guerre.
D’une certaine manière, donc, la vie ordinaire dans son déroulement journalier et familier constitue une sorte de tissu existentiel et moral qui fait obstacle à la barbarie. Pas toujours, mais le plus souvent. D’où le caractère totalement absurde et anormal de la vie quotidienne dans un contexte totalitaire, comme l’ont souvent signalé eux-mêmes les habitants concernés et les prisonniers des camps. Cela montre a fortiori que la normalité quotidienne s’oppose en partie, secrètement, à ce tohu-bohu du mal généralisé.
Je crois, de manière naïve peut-être, que le mal ne peut pas se quotidianiser, que s’il devient tout de même quotidien, et s’inscrit en lui durablement, le quotidien lui-même n’est plus alors totalement ordinaire et banal, mais prend un aspect étrange et absurde. Et si le mal ne peut devenir totalement quotidien, et donc banal (ce en quoi je m’oppose à la thèse d’Hannah Arendt, même si elle parle plus du mal infligé que du mal reçu), c’est que la vie ordinaire lui oppose sa bonté pré-réflexive, sa décence commune faite de paroles confiantes, de gestes inconscients d’accord et d’aide, de soins discrets mais essentiels.
Comment fut perçue à son époque l’idée de « décence ordinaire » ? Avec cette approche humaniste valorisant l’homme ordinaire et ses vertus, ne s’exposait-il pas à se voir taxer de populisme ?
Je ne sais pas si les contemporains d’Orwell avaient perçu dans son œuvre l’importance de cette idée de décence ordinaire. D’un autre côté, Orwell indique que le sens de la décence ordinaire, bien qu’en déclin, constitue l’une des bases de la vie anglaise, que l’on retrouve chez des écrivains comme Dickens, Morris, Butler.
La décence n’est pas la dignité. La dignité renvoie à un rang, et donc nécessite la comparaison avilissante. Pour que je sois digne, il faut que d’autres ne le soient pas. La dignité de la personne humaine implique eo ipso l’indignité d’autres créatures vivantes. La décence n’est pas fondée sur une telle valeur glorieuse de discrimination hiérarchique : elle est en soi égalitaire et commune à tous, à tous ceux qui en font preuve. L’humanisme d’Orwell est un humanisme de l’homme ordinaire, qui ne se gargarise pas de grandes valeurs agitées comme des oriflammes.
Enfin, la question du populisme est complexe et souvent biaisée. Le populisme est devenu une sorte d’injure faite à un certain type de revendication politique où le supposé peuple n’est que ressentiment, impossibilité tragique d’agir en son nom propre. On taxe de populiste ce qui apparaît comme l’expression brute d’une populace, pas encore éduquée et dirigée par l’expert éclairé. Ce terme est donc très fréquent chez les experts pour dénoncer la pseudo-valeur de leur propre critique. C’est un argument stratégique qui vise à inculper la parole populaire, à la caricaturer et la manipuler dans des techniques de détournement de pensée que l’on nomme sondages, au profit de son maintien dans l’inaudibilité. Bref, le populisme tel qu’on l’entend de nos jours est le bâillon symbolique des dominants pour faire taire l’expression des dominés.
« L’humanisme d’Orwell est un humanisme de l’homme ordinaire qui ne se gargarise pas de grandes valeurs agitées comme des oriflammes. »
J’ai toujours considéré que l’essence même de la démocratie c’est le pouvoir des sans-voix, des hommes ordinaires, des n’importe qui comme le dit Rancière. L’expert qui vilipende le populisme pense que le « n’importe qui » équivaut à « n’importe quoi ». La société technocratique et idéocratique des deux siècles passés n’a pourtant pas prouvé sa haute valeur humaine et sociale, sa capacité autocritique à s’amender et se réformer… Le populisme ne me fait donc pas peur, il n’est que l’épouvantail de ceux qui veulent maintenir leur rang au sein du pouvoir en disqualifiant préalablement comme honteuses les fausses opinions qu’ils se font des dominés, quand ils ne les forgent pas eux-mêmes par les organes de presse qu’ils dirigent.
Orwell déplorait l’ « apathie » des hommes ordinaires, tout en plaçant son espoir en eux pour briser les injustices sociales. N’est-ce-pas contradictoire ?
Orwell n’a jamais dépeint l’homme ordinaire comme un homme idéal, porteur d’une vertu morale sans faille. Il s’en prend même à l’idée de la supériorité morale des pauvres, fausse victoire dans un monde où leur défaite sociale est jour après jour confirmée.
Le problème est que la décence commune est davantage un sentiment de ce qui ne se fait pas - même si elle a elle-même une certaine positivité dans la vie quotidienne - que de ce qui doit être fait ; elle n’apparaît donc au niveau politique que comme un simple frein à la domination absolue. La question essentielle est de savoir comment la décence ordinaire, qui est une sorte d’attitude spontanément critique vis-à-vis de la domination et du pouvoir, peut elle-même devenir un élément politique de transformation du pouvoir. Il faut donc imaginer des dispositifs socio-politiques permettant d’exercer le pouvoir, d’organiser la cité, sans sacrifier la décence ordinaire.
Orwell n’a pas vraiment eu le temps, pris par l’urgence de l’histoire, de réfléchir à des dispositifs préservant à la fois cette décence et rendant possible une action politique d’envergure qui ne sacrifierait pas la voix de chacun au profit de l’organisation du tout (ce qui apparaît même dans les organisations démocratiques qui, par des dérives internes de bureaucratisation, confisquent le pouvoir de leurs membres au profit exclusif des représentants). Mais je crois que l’apathie des hommes ordinaires disparaîtra si la décence ordinaire peut s’exprimer en toute franchise dans la vie publique et ne plus être cantonnée à la seule vie quotidienne pré-institutionnelle. A mon avis, cette décence est nécessaire, mais non suffisante. Elle est une base indispensable de l’action sociale, en aucun cas une finalité.
« La question essentielle est de savoir comment la décence ordinaire, qui est une sorte d’attitude spontanément critique vis-à-vis de la domination et du pouvoir, peut elle-même devenir un élément politique de transformation du pouvoir. »
Son propos n’est-il pas discrédité par une forme de naïveté ? Difficile de ne pas réagir lorsqu’on lit sous sa plume : « Les petites gens ont eu à subir depuis si longtemps les injustices qu’elles éprouvent une aversion quasi instinctive pour toute domination de l’homme sur l’homme »…
Il n’a pas été si naïf envers les régimes totalitaires puisqu’il a perçu, bien avant d’autres, leur nature profonde, leurs ressorts masqués et leur inversion pathologique de la réalité. Est-il naïf envers la capacité des hommes ordinaires à résister au mal et à ne pas céder à la politique de la domination ? Il s’agit là d’une prise de position qui engage une vision de l’existence. Orwell ne croit pas à la vertu salvatrice des héros ; l’espoir réside non dans la clairvoyance de quelques-uns, mais dans la décence spontanée des hommes ordinaires.
Celle-ci semble - il est vrai - faire défaut aux Russes en 1919-20 et aux Allemands en 1933. Mais on peut toujours considérer que la base d’une politique vraiment démocratique et non dominatrice réside - et résidera toujours - dans la prise en considération directe et sans médiation de la voix de tout un chacun, des voix ordinaires, quand bien même celles-ci ne semblent pas apporter un message clair. C’est à la vie politique de trouver des dispositifs d’expression de ces voix réellement efficaces, et qui ne se satisfassent pas simplement de l’apparence chatoyante de la démocratie participative.
Pour ma part, je suis plus pessimiste qu’Orwell sur ce plan, même si je partage avec lui l’idée que le seul espoir politique viendra de l’expression ordinaire des sans-voix et du boycott ferme des faiseurs d’opinion publique. Je ne crois pas à la vertu salvatrice d’une nouvelle doctrine qui nous expliquerait l’aliénation actuelle et la manière d’en sortir. Nous croulons déjà sous les théories de l’émancipation.
Il semble plus facile à l’écrivain anglais de dénoncer l’indécence que de matérialiser la décence, de la faire entrer dans une sphère politique. Selon vous, « la décence ordinaire est, en tant qu’expression affective et immédiate d’un certain dégoût social, plutôt réactive qu’active, négative que positive. » Pourquoi n’a-t-il pas réussi à « positiver » son approche politique ?
Disons que le temps lui a manqué. L’urgence de l’époque résidait d’abord dans la guerre contre le nazisme, puis contre la pensée totalitaire. Il s’agissait de combats âpres et violents, qui nécessitaient de démonter et démontrer le caractère monstrueux de ces systèmes de pensée et de gouvernement. Orwell n’a pas vraiment eu l’occasion d’exposer en long et en large ses idées socialistes, même s’il l’a fait à l’occasion dans quelques textes clairs et inspirés, comme Le Lion et la licorne (1940), ou à travers ses chroniques dans Partisan Review ou Tribune. Il était davantage guidé par la défense des hommes ordinaires, de leur liberté élémentaire, de leur mode de vie simple et relativement égalitaire, de leur capacité à diriger leur propre vie sans être tout le temps sous la tutelle du marché ou de la machine, que par le travail positif d’une élaboration intellectuelle du socialisme. Et je pense aussi que l’essentiel pour lui n’était pas là. Il ne s’agissait pas de trouver la théorie la plus à même de nous conduire au grand soir, mais d’éveiller le désir de justice et les inclinations ordinaires à l’égalité.
Enfin, il faut souligner que, tout au long de sa vie (et surtout à partir de 1936), l’activité politique d’Orwell ne s’est jamais arrêtée. On peut considérer que tout est politique dans son œuvre, que toute son expression littéraire - assez diverse entre romans, essais, chroniques et billets - a un sens politique.
Lorsqu’Orwell parle des intellectuels, « cette catégorie de personnes qui aurait dû, plus que toute autre, faire preuve d’un peu plus de décence dans ses prises de position publiques », il semble d’une actualité brûlante. Pensez-vous que ses analyses sur le sujet soit transposables aux intellectuels médiatiques contemporains ?
Bien sûr. Mais nos intellectuels médiatiques ont depuis longtemps dépassé les bornes de l’indécence. Ils voguent haut dans l’éther du mensonge, de l’hypocrisie totale, de la bassesse la plus crasse. On ne compte plus leurs prises de position tonitruantes qui se sont avérées au mieux fausses, au pire criminelles. Si on passait au crible leurs multiples interventions médiatiques sur tel ou tel sujet de la politique mondiale, on serait effaré par le taux élevé d’inepties qu’ils profèrent jour après jour, dans l’impunité totale.
Ce sont pourtant les mêmes qui chantent aux universitaires, dans les pages de ces grands quotidiens devenus leur tribune matinale, la nécessité de l’évaluation, les bienfaits de l’excellence… Qu’ils commencent par examiner leurs propres dires approximatifs et superficiels, avant de donner des leçons. Le comble est qu’ils pensent, ce faisant, s’opposer au pouvoir, aux puissants, alors qu’ils leur servent quotidiennement la soupe…
« Nos intellectuels médiatiques ont depuis longtemps dépassé les bornes de l’indécence. »
Ces intellectuels ne sont plus les voix serviles du totalitarisme, comme dans les années 1930, mais celles du marché et du spectacle, du grand barnum des ombres, des fantômes, des zombies. Reste que leur aplomb dans la diffusion de contre-vérités demeure total. Ils ne défendent plus un parti au prix des pires bassesses, mais leur train de vie ou leur cote de popularité. Ils ne s’allient plus avec le Talon de fer de London, mais avec le village global dont ils exploitent la crédulité planétaire et le flux tendu d’informations sans fondement. Pour un énième passage à la télévision, ils seraient prêts à tordre les faits, à trahir une amitié, à écraser ceux qu’ils nomment les médiocres, à savoir ceux qui n’estiment pas la vie bonne aux seuls critères quantitatifs de la réussite sociale.
Mais le fond du problème reste le même : le goût du pouvoir, de la renommée, de la carrière se substitue à la quête de la vérité, à l’éthique de la vocation-profession pour parler comme Weber. Ces intellectuels dévoyés ne sont plus complices de régimes criminels, mais d’un système d’exploitation de l’opinion, d’une marchandisation de la culture, d’une dégradation objective du goût et de l’originalité. Ils sont les produits standardisés de la Kulturindustrie des Idées, des théories, des thèses, le recyclage commercial de vieilles lunes, l’un avec le matérialisme antique à la sauce nietzschéenne, l’autre avec le kantisme juridique, le troisième avec l’antitotalitarisme tendance Eden Rock. Ce ne sont ni plus ni moins que des marques commerciales, avec leur logo simpliste, leur pseudo-valeur ajoutée. Chacun occupe tranquillement un secteur du marché de la pensée, sans se faire concurrence. À toi la défense des droits de l’homme, à toi l’exaltation de la passion, à moi la critique de la technique ; et tous sont unis dans les renvois d’ascenseur, les critiques dithyrambiques, les coups de fils complices.
« Tous unis dans les renvois d’ascenseur, les critiques dithyrambiques, les coups de fils complices. »
En parcourant votre livre, on ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec notre époque. L’indécence du pouvoir et de ses représentants semble n’avoir jamais été si forte : c’est ce qui vous a poussé à rédiger cet essai ?
Inconsciemment, sans doute. Le livre est né de la réflexion sur l’éthique ordinaire, et non d’une volonté critique vis-à-vis de l’époque. Mais j’avais écrit une longue préface à l’été 2008 sur la droite décomplexée, et ce avant même la crise financière. Mon éditeur, qui approuvait ce texte, m’a cependant convaincu de le supprimer, chacun comprenant au fond pourquoi un tel livre devait être publié à notre époque : il n’était nul besoin d’en rajouter.
Bien sûr, notre époque est indécente. Et surtout dans la façon qu’elle a de croire qu’elle est au-delà même de l’indécence. C’est cela qui la caractérise : le comble de l’indécence dans la croyance en sa propre respectabilité. Auparavant, les dominants reconnaissaient au moins la domination inique qu’ils exerçaient et ne la drapaient pas dans de fausses vertus. Tandis que, de nos jours, on pratique les expulsions de réfugiés en arguant de sa bonne foi et en promettant à ces personnes désespérées un avenir radieux dans leur pays ravagé.
C’est cela qui est le plus révoltant, quand le pouvoir veut gagner sur les deux tableaux, celui du monopole de la violence légitime et celui de la vertu et de la bonne conscience. Il faut choisir. Certains ministres de l’ancien temps affichaient au moins sans vergogne leur air de tortionnaire et ne jouaient pas les Tartuffe…
« C’est cela qui caractérise notre époque : le comble de l’indécence dans la croyance en sa propre respectabilité. »
Les exemples de l’indécence sociale sont multiples, quotidiens, gigantesques. Mais il ne faut pas rester à la simple indignation morale, il faut exercer une pression forte, constante, sur les dominants. S’ils font preuve d’indécence, c’est que le rapport de force leur est devenu favorable à la fin des années soixante-dix. Lorsque des grèves générales, des actions terroristes, une hostilité et une tension sociale constantes prévalaient, les dominants, tout en continuant à faire fructifier leur capital et leur pouvoir, se faisaient relativement discrets, et n’exhibaient pas de manière obscène leur pouvoir afin d’humilier symboliquement ceux qu’ils exploitaient déjà quotidiennement.
C’est là, à mon avis, l’élément nouveau. L’indécence actuelle a investi le champ honorifique du symbole et de la justification idéologique. Elle s’affiche sans vergogne, et jouit même de la croyance nouvelle en sa propre vertu. Elle n’a plus peur de se montrer telle quelle comme indécence, elle veut elle-même gagner la respectabilité de la sphère publique en se faisant passer pour quelque chose de digne. D’où le réflexe assez incroyable de ces dirigeants de grandes entreprises qui, après avoir mis leur société dans le rouge, s’en vont avec un énorme magot de stock options et s’indignent que l’on trouve cela indigne. Et je crois qu’ils sont sincères au fond, ils ont tellement vécu dans cette décomplexion contemporaine qu’ils ne voient même plus où se situe l’indécence de leur comportement.
Les signes de cette nouvelle indécence sont multiples. Elle apparaît partout où la domination s’affiche en toute bonne foi, sans se dissimuler, afin de s’imposer, à la fois et de manière définitive, comme normale et nécessaire, et de se donner la justification symbolique du statu quo, de ce qui est établi pour toujours et ne changera jamais. Or le rôle de tout penseur critique est de s’en prendre continuellement à l’ordre établi, à ce qui se tient là comme norme absolue, Das Bestehende, comme le dit Adorno.
« L’indécence actuelle a investi le champ honorifique du symbole et de la justification idéologique. Elle s’affiche sans vergogne, et jouit même de la croyance nouvelle en sa propre vertu. »
Jusqu’à 1995 et la parution de Georges Orwell, Anarchist Tory de Jean Claude Michéa, on ne connaissait pas Orwell pour ses talents d’analyste politique pur. Ses théories sur la « décence ordinaire », par exemple, étaient totalement négligées. Pourquoi cette facette fondamentale d’Orwell a t-elle été négligée si longtemps ?
Il faudrait sans doute dresser l’histoire de la pensée critique depuis la Seconde Guerre mondiale, et voir la divergence entre diverses tendances souvent irréconciliables. Il y a sans doute chez Orwell un côté viril et sévère, une forme d’intransigeance dans le comportement et les idées. Celle-ci ne convient pas à notre époque postmoderne, fluide et liquide qui prétend avoir définitivement dépassé les oppositions traditionnelles du vrai et du faux, du bien et du mal, de l’authentique et de l’inauthentique, et qui ne se demande pas ce qu’il faudrait mettre à la place. Ce qui est, à mon sens, le critère distinctif même du nihilisme : est nihiliste, non pas tant la dévalorisation de toutes les valeurs (chaque penseur critique est nihiliste en ce sens), mais l’incapacité de créer de nouvelles valeurs.
Le post-modernisme est nihiliste dans la mesure où il se complait dans la déconstruction auto-satisfaite de systèmes de valeurs hérités du passé, se gardant de toute réflexion positive sur ce qu’il s’agit à présent d’inventer, d’instituer comme nouvelles formes ou normes de vie. D’où son ironie impuissante et immature dans le démontage des idées passées. Mais lorsqu’il aura tout démonté, tout déconstruit, tout décomposé, comme un enfant capricieux et sans imagination, le nihiliste ne saura plus quoi faire… Ce qui est un peu notre cas. On cherche uniquement à poursuivre le travail de déconstruction, en s’attaquant à de nouveaux domaines désormais très étroits où la domination des valeurs persisterait.
Dans ce contexte, le socialisme relativement austère d’Orwell, son attachement viscéral à des valeurs lui paraissant fondées - comme la décence, la franchise, le goût de la vérité - semble démodé. Il faudra bien pourtant un jour quitter notre confort déconstructionniste et tenter d’imaginer de nouvelles formes possibles de société, de vie commune, d’organisation sociale. Des auteurs comme Orwell, Kosik, Castoriadis, Patocka redeviendront alors indispensables.
Je crains que ce ne soit malheureusement pas encore le cas en France, pays qui n’a pas fait sa cure de désintoxication déconstructionniste et qui poursuit, avec l’allant digne d’un moribond mobilisant ses dernières forces, sa quête de nouvelles valeurs à démonter et de nouveaux symboles à bafouer. Et ce, in fine, afin de laisser libre champ à quoi ? Au flux perpétuel, au devenir liquide, au bombardement atomique de l’insignifiance.
Orwell reste donc indispensable ?
Je ne sais pas. Je n’ai pas la capacité de sonder le cœur des gens et de l’époque. Il est toujours difficile de jouer à ce jeu grisant, mais difficile, de l’anachronisme.
En tout cas, Orwell m’est indispensable. Lorsque j’ai découvert ses écrits, j’ai été ébloui par leur franchise, ce que les anciens nommaient la parrhésia et qui est le fondement interpersonnel de toute polis.
Je crois enfin que le plus important chez Orwell tient dans cette capacité à demeurer fidèle en toutes circonstances à quelques principes essentiels, et à cultiver un sens ordinaire du bonheur nous prévenant contre toute volonté de domination, politique ou académique. Bien sûr, c’est un idéal sévère, un peu romain, mais c’est un idéal qui - contrairement à beaucoup d’autres - a un enracinement dans le réel.
D’autres sont plus intelligents que lui, ou inventifs. Mais Orwell demeure sans égal pour ce qui est de la lucidité critique. Notre époque, du point de vue politique et des idées, est sans doute plus confuse que les années 1930, quand deux ou trois modèles socio-politiques s’affrontaient : nous nous n’en connaissons qu’un aujourd’hui, mais il repose sur des fondements multiples, fragiles et contradictoires. C’est pourquoi la capacité de voir clair dans le brouillard des idéologies doit être plus que jamais cultivée. Sur ce plan-là, Orwell est le meilleur des exemples à suivre.
Ps : Article11 ferme ses portes jusqu’au lundi 4 janvier, ami lecteur. D’ici là, rien de nouveau à attendre sur le site, sauf crise de manque improbable de JBB. Joyeuses vacances.