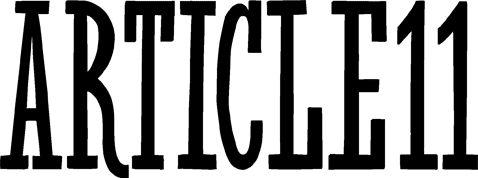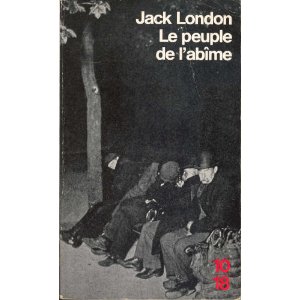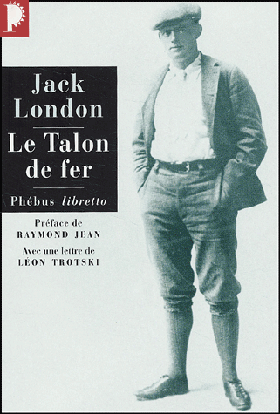mercredi 2 juin 2010
LittÃĐrature
postÃĐ Ã 15h39, par
14 commentaires
Un peu datÃĐ, George Orwell ? Un rien dÃĐpassÃĐ, Jack London ? Absolument pas. Il suffit de se replonger dans certains de leurs livres, ceux qui dÃĐcrivent la misÃĻre absolue du prolÃĐtariat anglais au dÃĐbut du 20ÃĻ siÃĻcle et qui mettent à nu les rouages de l’impitoyable exploitation capitaliste de l’ÃĐpoque, pour Être frappÃĐ par leurs accents contemporains. Des indispensables, à relire immÃĐdiatement.
Orwell, Dans la dÃĻche à Paris et à Londres
S’il y a un domaine dans lequel le pouvoir actuel ne dÃĐçoit pas, c’est bien en son abnÃĐgation à aller toujours plus loin dans la saloperie. Nos gouvernants ont beau perdre leur temps en moulinets rhÃĐtoriques et brasser du vent par quintaux, une ÃĐvidente ligne directrice ÃĐmerge de leurs gesticulations. Celle du contrÃīle social - de plus en plus fort - et de l’ÃĐtouffement des libertÃĐs, de politiques ÃĐconomiques inÃĐgalitaires et d’une tendance totalitaire à ficher, filmer, enregistrer, annoter, portiquer, sÃĐcuriser, apeurer et, au final, paranoÃŊser.
Un asservissement consciencieux qui s’inscrit dans une ligne historique, constitue le point d’aboutissement d’une logique sociale prÃĐdatrice. Le traitement et la perpÃĐtuation (à dessein ?) d’une certaine misÃĻre sociale portent mÊme à croire que notre gouvernement s’inspire d’autres temps, d’autres ÃĐpoques.
Un des meilleurs exemple en est le parallÃĻle avec la sociÃĐtÃĐ anglaise de la fin du 19e et du dÃĐbut du 20e siÃĻcle, caractÃĐrisÃĐe par le colonialisme, la rÃĐvolution industrielle et l’explosion des inÃĐgalitÃĐs. Deux auteurs-romanciers-journalistes « classiques », Jack London et George Orwell1, ont en leur temps plongÃĐ dans la misÃĻre sociale pour mieux en ÃĐtudier les causes et les ressorts. Des analyses aux rÃĐsonances contemporaines troublantes, qui apportent un ÃĐclairage essentiel sur la situation de l’ÃĐpoque, et partant, sur la nÃītre.
La trame de Dans la dÃĻche à Paris et à Londres2 est connue. Orwell y raconte quelques mois de « Vache enragÃĐe » (le titre sous lequel la premiÃĻre ÃĐdition a ÃĐtÃĐ publiÃĐe en France) dans les annÃĐes 20, entre les deux capitales. En revanche, on ignore souvent que Jack London a fait quasiment la mÊme expÃĐrience quelques annÃĐes auparavant dans l’East End londonien, s’habillant en clochard pendant des semaines pour enquÊter sur la pire poche de pauvretÃĐ de toutes les sociÃĐtÃĐs industrielles de l’ÃĐpoque. MisÃĻre sans nom sur laquelle bouffaient, s’engraissaient et enflaient sans trÊve l’industrie et l’Empire britanniques. Cela donna Le peuple de l’abÃŪme3, une enquÊte socio-journalistique passionnante, sur laquelle je te conseille de te jeter dÃĻs que possible.
Cette enquÊte, ainsi que les quelques mois durant lesquels il a partagÃĐ la vie de vagabonds amÃĐricains4, ont contribuÃĐ Ã faire ÃĐmerger chez London de solides convictions ÃĐgalitaires et libertaires. C’est dans Le Talon de fer, publiÃĐ quelques annÃĐes plus tard, en 1908, qu’il dÃĐveloppe vÃĐritablement ses thÃĐories politiques, sous la forme d’un roman ÃĐtrange5. Dans ce rÃĐcit d’anticipation, la RÃĐvolution qui sous-tend l’ensemble du roman, les accents ÃĐpiques de son hÃĐros et la lutte des classes cruelle qu’il met en scÃĻne ont d’ÃĐtonnants accents prophÃĐtiques : il va mÊme jusqu’à imaginer la premiÃĻre vÃĐritable rÃĐvolte sociale de l’ÃĒge moderne, « la Commune de Chicago », qu’il situe dÃĐjà enâĶ 1917. Le caractÃĻre d’anticipation de l’Åuvre fait ÃĐvidemment songer à 1984 d’Orwell. Ãtonnantes trajectoires parallÃĻles chez ces deux auteurs, dÃĐcalÃĐes de quelques annÃĐes seulement, et qui les poussent pourtant à des conclusions diamÃĐtralement opposÃĐes : l’un imagine la RÃĐvolution et l’instauration d’une sociÃĐtÃĐ plus ÃĐgalitaire, l’autre brosse gÃĐnialement les traits d’un totalitarisme absolu.
Tu t’en doutes, il n’est pas question de te raconter ces livres par le dÃĐtail, mais plutÃīt d’en tirer au compte-goutte quelques analyses, expÃĐriences et descriptions, parfois frappantes d’actualitÃĐ.
Quand la faim justifie les moyens d’oppression
L’ÃĐlÃĐment rÃĐcurrent, celui qui sous-tend ces deux ouvrages (et plus particuliÃĻrement celui d’Orwell), c’est la faim.
« La faim rÃĐduit un Être à un ÃĐtat oÃđ il n’a plus de cerveau, plus de colonne vertÃĐbrale. L’impression de sortir d’une grippe carabinÃĐe, de s’Être muÃĐ en mÃĐduse flasque, avec de l’eau tiÃĻde qui circule dans les veines au lieu de sang. L’inertie, l’inertie absolue, voilà le principal souvenir que je garde de la faim. »
Orwell, Dans la dÃĻche à Paris et à Londres.
Une population rÃĐduite à cet ÃĐtat prÃĐsente l’avantage de fournir une « armÃĐe de rÃĐserve » (de chÃīmeurs, en sommeâĶ) prÊte à travailler pour rien, à prendre à tout prix la place de ceux qui se font exploiter. Il est alors aisÃĐ de maintenir des salaires bas, de sous-payer l’ensemble de la population. Une population rÃĐduite à l’ÃĐtat de pÃĒte à modeler sociale, la voilà la grande, l’excellente idÃĐe. Par là -mÊme, on ÃĐtouffe tout ce qu’il peut y avoir de fondamentalement humain en chacun afin de constamment affirmer et rÃĐassurer les rapports de domination.
Jack London fait ÃĐcho à ce constat par l’intermÃĐdiaire de l’ÃĐvÊque du Talon de Fer, personnage qui se dÃĐvoue à nourrir les misÃĐreux : « J’ai appris une grande leçon. On ne peut pas soigner l’ÃĒme, tant que l’estomac n’est pas satisfait. »
Autre stratÃĐgie du pouvoir : satisfaire l’estomac au minimum, tout en abrutissant la population6. Donner quelque chose à perdre, un simple os à ronger pour la plupart alors qu’une infime partie de la population se gave, voilà la meilleure maniÃĻre de conserver les gens dans un ÃĐtat de lÃĐthargie : le plus prÃĻs possible de l’abÃŪme, sans qu’ils n’y tombent tous en masse, sans quoi la rÃĐvolte risquerait d’ÃĐclater. Il faut rendre les populations mallÃĐables tout en les conservant en ÃĐtat de travailler. Toute la difficultÃĐ est dans le dosage. London, parlant des habitants de l’East End un peu moins mal lotis que les autres, dÃĐtaille :
« Mais quand on va au fond des choses, on se rend compte que ce bonheur est trÃĻs triste, c’est une joie animale, le contentement de l’estomac bien rempli. Le caractÃĻre dominant de leur existence, c’est le matÃĐrialisme â ils sont stupides, lourds et dÃĐpourvus de toute imagination. L’AbÃŪme semble exhaler vers eux une intense atmosphÃĻre abrutissante de torpeur, qui les enveloppe et les ÃĐtouffe. [âĶ] Ce ne serait pas trop mal pour eux, si tout se rÃĐsumait dans ces petites joies. Mais ça n’est pas le cas : la torpeur satisfaite dans laquelle ils se plongent est une sorte de paralysie implacable qui prÃĐcÃĻde l’anÃĐantissement. Ils ne font aucun progrÃĻs, et, dans leur cas, ne faire aucun progrÃĻs, c’est reculer et tomber dans l’AbÃŪme. Ils commencent à vaciller dans leur propre temps de vie, et la chute sera complÃĻte lorsqu’on en viendra à leurs enfants, et à leurs petits-enfants. L’homme obtient toujours moins que ce qu’il demande, et comme dans leur propre cas ils ne demandent que le minimum, le peu qu’ils reçoivent ne peut absolument pas les sauver. »
London, Le peuple de l’AbÃŪme
Orwell prolonge cette rÃĐflexion et dÃĐgage un canevas social de ces expÃĐriences. Il en tire ainsi certaines analyses aux connotations plus politiques, semblables à celles que l’on retrouve dans d’autres de ses Åuvres, Hommage à la Catalogne et ses accents anarchisants par exemple.
« [Le plongeur] est l’esclave d’un hÃītel ou d’un restaurant, et son esclavage est d’une utilitÃĐ discutable. Car aprÃĻs tout, en fin de compte, quelle est rÃĐellement la nÃĐcessitÃĐ des grands hÃītels et restaurants chics ? Ces ÃĐtablissements sont censÃĐs apporter du luxe, mais en rÃĐalitÃĐ ils n’offrent qu’un piÃĻtre et mesquin semblant de luxe. [âĶ] Il faut bien, sans doute, qu’il y ait des hÃītels et des restaurants, mais cela n’implique nullement que des centaines de personnes doivent pour autant Être rÃĐduites en esclavage. Le travail rÃĐellement indispensable ne constitue pas l’essentiel dans ces ÃĐtablissements : le principal, ce sont les faux-semblants censÃĐs reprÃĐsenter le luxe. [...] Un hÃītel chic, c’est avant tout un endroit oÃđ cent personnes abattent un travail de forçat pour que deux cents nantis puissent payer, à un tarif exorbitant, des services dont ils n’ont pas rÃĐellement besoin. [...] »
Selon Orwell, la moindre parcelle de libertÃĐ rÃĐelle accordÃĐe aux prolÃĐtaires menace directement celle des classes dominantes. Ces derniÃĻres poussent donc à un systÃĻme ÃĐconomique empilant les tÃĒches inutiles par peur de la foule, « animaux d’une espÃĻce si vile qu’ils pourraient devenir dangereux si on les laissait inoccupÃĐs. Il est donc prudent de faire en sorte qu’ils soient toujours trop occupÃĐs pour avoir le temps de penser ». Voilà pourquoi il faudrait agir d’un cÃītÃĐ pour « permettre à la plupart de penser », et attaquer de l’autre ceux qui ont clairement intÃĐrÊt à ce que ce systÃĻme politique, ÃĐconomique et social se perpÃĐtue.
Dans l’AbÃŪme
Dans la dÃĻche à Paris et à Londres et Le peuple de l’AbÃŪme : ces deux ouvrages, ÃĐtonnamment complÃĐmentaires, sont avant tout des rÃĐcits d’expÃĐriences vÃĐcues, l’histoire d’une plongÃĐe dans la couche la plus basse et la plus misÃĐreuse des populations de l’ÃĐpoque. Si l’approche de chacun diffÃĻre - beaucoup plus « journalistique » pour London, tandis qu’Orwell se retrouve vraiment dans la dÃĐbine - , certains passages sont troublants de ressemblance. Ainsi, la force de l’habillement comme marqueur social est dÃĐcrite quasiment avec les mÊmes mots chez les deux ÃĐcrivains, lorsqu’ils font le rÃĐcit du moment oÃđ ils ÃĐtrennent leur nouvel accoutrement de vagabond :
« Cela fait une drÃīle d’impression de se retrouver ainsi accoutrÃĐ. Il m’ÃĐtait dÃĐjà arrivÃĐ d’Être habillÃĐ Ã la diable, mais jamais à ce point. Ces hardes ne se contentaient pas d’Être sales et informes : il y avait aussi en elles, comment dire, une sorte d’inÃĐlÃĐgance intrinsÃĻque, une patine à base de vieille crasse qui allait infiniment au-delà de l’ÃĐlimÃĐ ou de la tenue nÃĐgligÃĐe. C’ÃĐtait le genre de frusques que l’on voit sur le dos d’un marchand de lacet ou d’un chemineau. Dans l’heure qui suivit, à Lambeth, je vis venir vers moi un pauvre hÃĻre aux allures de chien battu, un vagabond de toute apparence. Et aussitÃīt aprÃĻs, je m’aperçus que c’ÃĐtait moi-mÊme, ou plus exactement mon reflet dans une vitrine, que je voyais. La saletÃĐ s’ÃĐtait dÃĐjà incrustÃĐe sur mon visage. La saletÃĐ choisit ses victimes : elle vous laisse en paix tant que vous Êtes bien habillÃĐ, mais sitÃīt que vous n’avez plus de faux col, elle s’abat sur vous de toutes parts. [âĶ] En changeant de vÊtements, j’ÃĐtais passÃĐ sans transition d’un monde à l’autre. Tous les comportements ÃĐtaient soudain bouleversÃĐs. [âĶ]. Je dÃĐcouvris aussi à quel point l’attitude des femmes varie selon ce qu’on a sur le dos. Croisant un homme mal habillÃĐ, une femme rÃĐagit par une sorte de frisson traduisant une rÃĐpulsion comparable à celle que pourrait lui inspirer la vue d’un chat crevÃĐ. Tel est le pouvoir du vÊtement. HabillÃĐ en clochard, il est trÃĻs difficile, tout au moins au dÃĐbut, de ne pas ÃĐprouver le sentiment d’une dÃĐchÃĐance. C’est le mÊme genre de honte, irrationnelle mais trÃĻs rÃĐelle, qui vous prend, je suppose, quand vous passez votre premiÃĻre nuit en prison. »
Orwell, Dans la dÃĻche
Et Jack de lui faire ÃĐcho :
« A peine avais-je fait quelques pas dans la rue que je fus impressionnÃĐ par le changement complet produit par mes nouveaux vÊtements sur ma condition sociale. Toute trace de servilitÃĐ avait disparue dans l’attitude des gens du peuple avec lesquels j’entrais en contact. En un clin d’Åil, pour ainsi dire, j’ÃĐtais devenu l’un d’eux. Ma veste rÃĒpÃĐe et dÃĐchirÃĐe aux coudes signalait à tout venant la classe à laquelle j’appartenais, et dont ils faisaient eux aussi partie. Nous ÃĐtions dÃĐsormais de la mÊme race : à la place de la flagornerie servile et de l’attention trop respectueuse dont j’avais ÃĐtÃĐ l’objet jusqu’ici, je partageais maintenant avec eux une sorte de camaraderie familiÃĻre. L’homme en costume de velours cÃītelÃĐ et au foulard crasseux ne s’adressait plus à moi en me disant « Monsieur » ou « Gouverneur », mais me donnait maintenant du « mon pote » gros comme le bras ! C’est un terme exquis et plein de cordialitÃĐ, dont la sonoritÃĐ a une chaleur, une intimitÃĐ que l’autre terme ne possÃĻde pas. Gouverneur ! Cela sent la puissance, l’autoritÃĐ, la supÃĐrioritÃĐ â c’est le tribut que rend l’infÃĐrieur au supÃĐrieur dans l’espoir secret que celui à qui ce vocable s’adresse voudra bien s’allÃĐger de quelques menues monnaies. C’est, en fait, une façon dÃĐguisÃĐe de mendier. [âĶ] je dÃĐcouvris un tas d’autres changements, survenus à cause de mon nouvel accoutrement. Lorsque je traversais, par exemple aux carrefours, les encombrements de voitures, je devais dÃĐcupler mon agilitÃĐ pour ne pas me faire ÃĐcraser. Je fus frappÃĐ par le fait que ma vie avait diminuÃĐ de prix en proportion directe avec la modicitÃĐ de mes vÊtements. »
London, Le peuple de l’AbÃŪme
A l’ÃĐpoque, une loi avait cours an Angleterre, interdisant de dormir dans la rueâĶ de nuit. Situation inspirant d’ailleurs à Orwell cette rÃĐflexion qu’à Londres (à la diffÃĐrence de Paris) « il est tout bonnement impossible de s’asseoir sans payer ».
Nos sociÃĐtÃĐs contemporaines semblent avoir intÃĐriorisÃĐ ces stratÃĐgies poussant à compliquer encore la vie de ceux qui se retrouvent dans la dÃĐbine. A titre d’exemple, citons ce mobilier urbain hÃĐrissÃĐ de dÃĐfenses (voir le travail sur ces « anti-sites » rÃĐalisÃĐ par le Survival Group) et pensÃĐ pour empÊcher les SDF de s’asseoir ou se reposer, qui se rÃĐpand en nos villes sans que personne ne s’en offusque.
Si on les confronte à de tels dispositifs, à cette volontÃĐ de relÃĐguer les SDF loin des regards, oÃđ ils ne dÃĐrangent pas le confort repus des bourgeois et des touristes, les propos de London n’ont pas pris une ride :
« Mais, bonnes gens bien nourris et repus de viande appÃĐtissante, et dont les draps blancs et les chambres confortables vous attendent chaque soir, comment pourrais-je vous faire comprendre toute la souffrance d’une seule nuit sans sommeil dans les rues londoniennes ? Croyez-moi, on a l’impression que mille siÃĻcles se sont passÃĐs avant que l’est se colorie des nuances de l’aurore ; on frissonne, jusqu’à en crier, tant chaque muscle endolori fait mal, et l’on s’ÃĐtonne aprÃĻs toutes les souffrances endurÃĐes, d’Être encore en vie. Si l’on s’ÃĐtend sur un banc et que l’on ferme les yeux, parce qu’on tombe de fatigue, un policeman vous rÃĐveille et vous intime grossiÃĻrement l’ordre de « dÃĐgager ». »
Des soupapes de sÃĐcuritÃĐ, pour ÃĐviter que ça ne pÃĻte vraiment
Au fond de l’abÃŪme, les populations sans espoir ont recours à tous les ÃĐchappatoires, et surtout à l’alcool, le vÃĐritable opium du peuple en ce dÃĐbut du 20e siÃĻcle. Une fois ses habits de vagabond endossÃĐ, la premiÃĻre rencontre que fait London dans l’East End est celle de ce marin palÃĐopunk sans femme ni enfants, sans futur : « Lorsque je lui demandai quel ÃĐtait son but dans la vie, il me rÃĐpondit sans hÃĐsitation « me saouler ». »
Orwell lui fait ÃĐcho lorsqu’il raconte ses abominables beuveries anesthÃĐsiantes de fin de semaine : « C’est ainsi que j’occupais la plupart de mes samedis soirs. Et tout compte fait, les deux heures oÃđ l’on goÃŧtait un parfait et sauvage bonheur valaient bien la gueule de bois qui s’ensuivait. Pour beaucoup d’hommes du quartier, sans femme et sans nulle perspective d’avenir, la beuverie du samedi soir ÃĐtait la seule chose qui donnait un semblant de sel à la vie. »
Laisser une infime porte de sortie hors de la misÃĻre quotidienne, relÃĒcher un tout petit peu la pression pour que la cocotte-minute de souffrance n’explose pas, accorder un semblant de libertÃĐ aliÃĐnante afin de mettre un paravent devant la vÃĐritable domination et l’absence de choix qui se profilent derriÃĻre, c’est alors le rÃīle de l’alcool. Une aumÃīne de libertÃĐ, afin de mieux conserver la population dans les fers.
NÃĐcessaire corollaire à l’interdiction de dormir dans la rue, les Anglais disposaient à l’ÃĐpoque d’un systÃĻme pour ceux qui n’avaient vraiment rien du tout : les asiles. Une sorte de prison surpeuplÃĐe dans laquelle les indigents devaient trimer â souvent inutilement â en ÃĐchange d’un « repas » (un immonde brouet : une bouillie à base d’eau et de farine d’avoine, et parfois un bout de pain dur) et d’une nuit de sommeil (mÊme pas dans un lit : ils dormaient la plupart du temps par terre dans des cellules minuscules, sans la moindre couverture). Des lieux si inhospitaliers et ÃĐpouvantables que la grande majoritÃĐ prÃĐfÃĐrait ne pas y dormir, mais rester dehors jusqu’à l’extrÊme limite de l’ÃĐpuisement, trois ou quatre jours durant, entre deux nuits dans ces bagnes7.
Le Grand Soir du Talon de Fer
Ãvidemment, de telles expÃĐriences les ont amenÃĐs tous deux à une certaine radicalisation politique. Quelques temps aprÃĻs ces nombreuses semaines au cÅur de l’AbÃŪme, London a ainsi consacrÃĐ le Talon de fer aux logiques sous-tendant la domination capitaliste à l’ÃĐpoque et à la RÃĐvolution. Par les diatribes de son hÃĐros charismatique, Ernest Everhard, il exprimait une rage politique, un sentiment d’impuissance chauffÃĐ Ã blanc. Jusqu’à proposer de mener un million et demi d’hommes dans les maisons de tous les nantis pour leur voler leurs dividendes : « C’est prÃĐcisÃĐment ce que nous sommes en train de faire. Et notre intention est de prendre non seulement les richesses qui sont dans les maisons, mais toutes les sources de cette richesse, toutes les mines, les chemins de fer, les usines, les banques et les magasins. La rÃĐvolution, c’est cela. C’est une chose ÃĐminemment dangereuse. Et je crains que le massacre ne soit plus grand encore que nous ne l’imaginons. Mais comme je le disais, personne aujourd’hui n’est tout à fait libre. Vous avez dÃĐcouvert que vous y ÃĐtiez prise vous-mÊme, et que les hommes à qui vous parliez y ÃĐtaient pris aussi. [âĶ] Vous dÃĐcouvrirez que tous sont esclaves de la machine. »
Les oligarques du Talon de fer ne sont d’ailleurs pas uniquement prÃĐsentÃĐs comme des brutes cyniques. Leur conviction absolue - et sincÃĻre - d’Être le seul rempart contre la barbarie les soude davantage que n’importe quoi d’autre : « Ils ÃĐtaient convaincus que leur classe ÃĐtait l’unique soutien de la civilisation, et persuadÃĐs que s’ils faiblissaient une minute, le monstre les engloutirait dans sa panse caverneuse et gluante avec tout ce qu’il y a de beautÃĐ et de bontÃĐ, de joies et de merveilles au monde. Sans eux, l’anarchie rÃĐgnerait et l’humanitÃĐ retomberait dans la nuit primordiale dont elle eut tant de peine à ÃĐmerger. L’horrible image de l’anarchie ÃĐtait constamment mise sous les yeux de leurs enfants, jusqu’à ce qu’obsÃĐdÃĐs par cette crainte entretenue, ils fussent prÊts à en obsÃĐder leurs propres descendants. Telle ÃĐtait la bÊte qu’il fallait fouler aux pieds, et son ÃĐcrasement constituait le suprÊme devoir de l’aristocrate. En rÃĐsumÃĐ, eux seuls, par leurs efforts et sacrifices incessants, se tenaient entre la faible humanitÃĐ et le monstre dÃĐvorant ; ils le croyaient fermement, ils en ÃĐtaient sÃŧrs. »
Comme quoiâĶ Il n’ÃĐtait pas nÃĐcessaire d’attendre Bourdieu pour mettre en lumiÃĻre les mÃĐcanismes profonds de reproduction des ÃĐlites. Ni de voir à l’Åuvre les rÃĐgimes fascistes du XXe siÃĻcle pour mettre en ÃĐvidence cette stratÃĐgie de diabolisation d’un bouc ÃĐmissaire, afin de liguer toute une catÃĐgorie de la population contre lui.
Se plonger dans ces livres, c’est surtout courir le risque de ne pas rÃĐsister à l’envie impÃĐrieuse d’en copier-coller ici la quasi intÃĐgralitÃĐ. Mais si l’on pourrait continuer à lancer des pistes et dresser des parallÃĻles pendant des heures, vient un moment oÃđ il faut savoir terminer un billet (Thorez ÂĐ).
Au moment de conclure, des visages s’imposent, ceux des hÃĐros de ces livres. Des trimardeurs, clodos, travailleurs-esclaves de l’ÃĐpoque. Furex par exemple, indÃĐcrottable - « communiste à jeun, il se muait en fÃĐroce patriote dÃĐs qu’il avait un peu bu » - qu’on observe se lancer dans des diatribes enflammÃĐes et d’apoplectiques Marseillaises, puis vomir sur sa table de rage avant de s’ÃĐvanouir, lorsqu’un drÃīle a le toupet de lui crier « vive l’Allemagne ! » .
Ou encore Bozo, l’artiste orgueilleux brillant et cultivÃĐ, trainant la patte ÃĐtÃĐ comme hiver sur les quais de la Tamise, crÃĐant chaque jour des Åuvres d’art sur les trottoirs londoniens. Une sorte de DiogÃĻne infirme, un ovni du trimard, magicien ÃĐphÃĐmÃĻre dans cette crasse dÃĐbectante.
C’est qu’avant d’Être des ouvrages politiques, ces livres sont aussi - et surtout - des galeries de portraits, de ceux d’en bas. De ceux qui, malgrÃĐ les coups assÃĐnÃĐs par le talon de fer, finiront par se faire porteurs d’espoir.
« Nous devons nous contenter d’une consolation philosophique, en admettant que dans l’ÃĐvolution sociale la phase capitaliste est à peu prÃĻs au mÊme niveau que l’ÃĒge simiesque dans l’ÃĐvolution animale. L’humanitÃĐ devait franchir ces ÃĐtapes pour sortir de la vase des organismes infÃĐrieurs, et il lui ÃĐtait naturellement difficile de se dÃĐbarrasser tout à fait de cette boue gluante. »
London, dans une perspective future, in le Talon de Fer
1 Et oui, toujours luiâĶ.
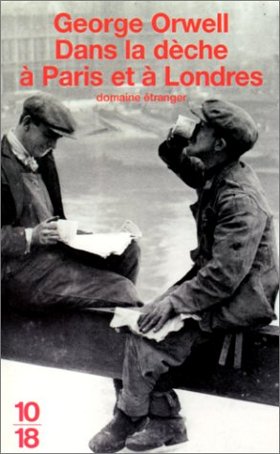
3 Une expression qu’on retrouve ensuite dans Le talon de fer, et qu’il reconnaÃŪt avoir pompÃĐ « au gÃĐnie de H.G. Wells ».
4 The road en anglais, paru sous le titre Les vagabonds du rail en français aux ÃĐditions PhÃĐbus.
5 Pour te donner une idÃĐe, il jongle avec les mises en abÃŪme tout au long du bouquin en cherchant à donner l’impression, par sa narration et au travers de notes de bas de pages faramineuses (certaines font quatre pleines pages de long), que l’ouvrage, ÃĐcrit par une rÃĐvolutionnaire de l’ÃĐpoque racontant le parcours de son amant - un leader ouvrier ultra-charismatique - a ÃĐtÃĐ retrouvÃĐ, commentÃĐ et annotÃĐ sept siÃĻcles plus tard dans une sociÃĐtÃĐ (« communiste » ?) devenue depuis plus ou moins parfaite. Un peu bordÃĐlique, je te l’accorde.
6 Pas besoin de revenir ici sur l’ÃĐvident parallÃĻle avec la tÃĐlÃĐvision, le spectacle, le pain et les jeuxâĶ
7 Dans l’ensemble, les descriptions d’Orwell sont ÃĐgalement impressionnantes en ce qu’elles rappellent des tÃĐmoignages sur la vie à la rue aujourd’hui. Qu’il s’agisse des lieux d’accueil, de la dÃĐchÃĐance physique ou mentale des protagonistes, il est marquant de retrouver des descriptions si proches à quasiment un siÃĻcle d’ÃĐcart.