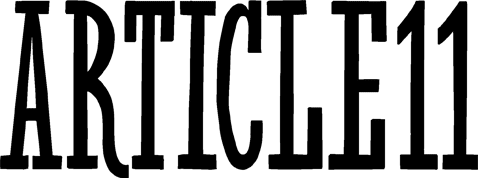mardi 12 mai 2009
Littérature
posté à 14h24, par
0 commentaire
Ceux qui s’intéressent à l’Amérique du Sud vont être comblés : voici un bouquin qui met à jour et défriche l’imbroglio politique du continent. Du Brésil au Venezuela, en passant par l’Argentine et la Bolivie, Marc Saint-Upéry remet en cause les simplifications hâtives, clichés nationaux et autres visions partiales de cette vague de gauche qui s’est abattue sur l’Amérique du Sud. Essentiel.
Certes : c’est la chronique d’un énième bouquin sur l’Amérique du Sud. Mais qu’importe, ce livre publié par La Découverte est bien écrit, approfondi, très récent1 et répond à une question essentielle : quid de cette vague de gauche qui a déferlé sur l’Amérique du Sud ces dernières années ? S’axant surtout sur le Brésil, le Venezuela et l’Argentine, l’auteur démonte le mythe des « deux gauches », qui verrait les nouveaux régimes politiques partagés par une ligne de distinction basique : d’un côté, une gauche « dure », de type chaviste, de l’autre un courant « social-democrate » et quasi néolibéral, façon Lula. Alors que la réalité est beaucoup moins manichéenne… Le Rêve de Bolivar est donc une excellente introduction à la politique latino-américaine, complément idéal d’un autre bouquin de poids sur ce continent, Les Veines ouvertes de l’Amérique Latine2.
Dix ans de vie et de voyages en Amérique du sud, quatre ans d’enquêtes, des centaines d’entretiens : l’auteur n’a pas ménagé sa peine. Ça tombe bien, le résultat est à la hauteur de ce qu’on pouvait espérer, une réelle enquête pour montrer une réalité sud-américaine bien plus complexe que ce que nous en laissent voir la plupart des médias. Les romantiques invétérés en seront pour leurs frais : la révolution « bolivarienne » - dans le sens d’une grande nation sud-américaine unie - n’est pas pour demain… Reste - c’est l’essentiel - qu’une même tendance sociale est à l’œuvre dans ces régimes3.
Comme on ne voulait pas réécrire le bouquin, on s’est contenté de développer deux exemples principaux (le Brésil et le Vénézuela), sûrement ceux dont l’image est la plus déformée dans les médias occidentaux.
Lula au Brésil : à social-traitre, social et demi
En octobre 2002, lorsque Luiz Inacio Lula Da Silva est élu président de la République au Brésil, beaucoup y voient quelque chose de véritablement révolutionnaire, nouvelle page d’histoire en cours d’écriture. Le parcours du bonhomme y est sans doute pour beaucoup : il a été cireur de chaussures, vendeur de cacahuètes, tourneur puis ouvrier métallurgiste, avant de devenir président du Syndicat des ouvriers de la métallurgie, puis d’entreprendre une carrière politique plus orthodoxe (gouverneur, député, candidat à plusieurs élections présidentielles).
Las : ces espoirs auraient fait faux bond, en apparence rapidement démentis par une politique économique décevante et par un énorme scandale de corruption au sein du parti présidentiel, le PT (Parti des travailleurs). Ce qui n’a - pourtant - pas empêché Lula d’être réélu en octobre 2006. C’est que les électeurs ne considèrent pas tous que le président soit devenu ce chantre du néolibéralisme le plus abject et ce suppôt du grand capital que beaucoup dénoncent en Europe.
× Le scandale, d’abord : en mai 2005, une vidéo montrant un directeur du service des postes Brésiliennes recevant un pot-de-vin met le feu aux poudres. Peu à peu, des proches de Lula ou des membres du gouvernement se retrouvent impliqués, accusés4 d’avoir participé au système de financement occulte par le Parti des travailleurs de certains de ses alliés. Mais ni les trois commissions parlementaires mises en place, ni la droite hargneuse, qui compte bien ne pas laisser passer cette chance inespérée, ni la presse ne parviennent à prouver l’existence de ce système. D’autant que certaines des accusations sont pour le moins étranges : certains des députés « pourris » montrés du doigt sont eux-mêmes membres du Parti des travailleurs (pourquoi aurait-il besoin de corrompre ses propres membres ?), tandis qu’un élu prétendument corrompu n’avait jamais voté en faveur du PT…
En clair : l’ensemble fleure bon les accusations à l’emporte-pièce et les manipulations d’un monde politique et médiatique surexcité par l’odeur du sang et la possibilité de se « payer » l’ancien métallo. En revanche, l’existence de liens financiers entre le PT et certaines entreprises est prouvé, et le parti présidentiel - criblé de dettes - reconnaît l’existence d’une caisse noire de campagne de 21 millions d’euros, ce qui entraine l’explosion du cabinet et un remaniement ministériel d’urgence. Le PT paye là pour les autres : les caisses noires sont banales dans le monde politique brésilien, aucun parti ne pourrait faire campagne sans.
En filigrane de ce scandale, l’idée de ne rien laisser passer à un PT qui s’est toujours posé comme le seul garant politique de la vertu, de l’honnêteté et de la probité. Mais les électeurs - eux - ont « pardonné » à Lula et à son parti, considérant sans doute que c’était là l’héritage d’un passé pourri et peu de chose par rapport à la corruption de l’opposition et des anciens gouvernements. Résultat : un an plus tard, Lula a été réélu, avec plus de 60 % des voix au second tour.
× La conversion libérale, ensuite : bien qu’il ait mis en place une politique économique critiquée, notamment en raison de son orientation libérale et de sa bonne volonté envers le FMI (dont il dépasse les objectifs fixés dès fin 2003…), Lula n’est pas aussi « social-traitre » qu’on le dit. L’homme a mené une vraie politique de redistribution sociale, qui a rapidement porté ses fruits.
Sa politique de transferts sociaux concerne fin 2006 près de 11 millions de familles (soit dans les 40 millions de personnes, sur les plus de 190 millions que compte le pays), grâce notamment au programme Bolsa Familia (allocations familiales) et à l’augmentation du salaire minimum5. En outre, le système universitaire reçoit plus de bourses et d’aides qu’auparavant.
En 2006 toujours, les investissements en infrastructures d’hygiène publique ont augmenté en moyenne de 281 % par an depuis son arrivée au pouvoir. Une hausse significative si on considère que seulement 53 % des foyers brésiliens étaient raccordés aux égouts en 2007. Ce que Lula souligne : « La quantité d’argent que nous investissons dans certains secteurs est supérieure à tout ce qui s’est fait dans l’histoire du Brésil, parce que tout cela était considéré comme de la simple dépense. Améliorer ces infrastructures, c’est améliorer la qualité de vie des gens. Pour chaque real que vous investissez dans ce domaine, vous en économisez quatre en matière de santé publique. »
En 2006 enfin, les riches brésiliens le sont encore plus. Mais les pauvres le sont clairement moins : le revenu des travailleurs a augmenté, les inégalités de revenus hommes-femmes et entre régions ont fortement baissé, tandis qu’un nouveau programme en direction des municipalités les plus pauvres a été lancé.
C’est cela, Lula : une politique économique contestable, mais avec de vraies mesures sociales derrière. A preuve, ses résultats électoraux de 2006 : Lula engrange au second tour plus de 80% des voix dans les régions les plus pauvres du pays (Nord et Nordeste). Un seul vrai point noir : il n’a rien pu faire contre la violence monstrueuse de la société brésilienne et la hausse dramatique d’une délinquance meurtrière.
Le Venezuela de Chavez : plus opportuniste que réellement socialiste
Chavez attise les passions. Surtout au sein d’une opposition qui le diabolise, transie de peur devant ses déclarations à l’emporte-pièce. Saint-Upéry remet tout de suite les choses d’aplomb :
« Contrairement aux fantasmes de l’opposition, les cercles bolivariens ne sont pas des organisations paramilitaires destinées à controler la population et à fomenter la terreur chez les adversaires du régime. Bien au contraire, la plupart se signalent par une forte adhésion aux valeurs de la démocratie et du pluralisme (même si cette adhésion n’exclut pas un certain sectarisme à l’égard des opposants dans la pratique) et par un refus de la violence comme solution aux conflits politiques et sociaux. En outre, le dévouement des membres des cercles au bien-être de leur communauté est un fait indéniable, qui se traduit par nombre d’activités d’aide et de solidarité envers les plus défavorisés. »
Cette polarisation autour de Chavez pousse aussi bien ses partisans à exhiber des armes durant les périodes de tension que ses détracteurs à élaborer « des plans d’autodéfense apocalyptiques contre l’invasion imaginaire d’une populace perçue comme ivre de pillage et de viol ». D’où l’exacerbation des différences de toutes sortes, sociales, ethniques, économiques, de classes ou de genres, instrumentalisées par les protagonistes pour faire monter la sauce et justifier le moindre débordement de violence.
Point par point, Saint-Upéry démonte les critiques d’une éventuelle dérive autoritaire du régime « bolivarien ». Lesquelles ne font pas dans la mesure : il est régulièrement reproché à Chavez « le contrôle politique des organes judiciaires, en particulier du Tribunal suprême de justice, et de l’autorité électorale ; la politisation partisane de l’armée et la militarisation de la vie sociale à travers la création d’un corps de réserve de type cubain contre la soi-disant menace d’invasion américaine ; la volonté de discipliner et de contrôler les ONG à travers une législation restreignant leurs sources de financement ; l’idéologisation du système éducatif à travers l’inculcation des « valeurs de la révolution » ; les menaces répétées à l’encontre de l’autonomie des universités sous prétexte de lutte contre leur « élitisme » ; et surtout, les attaques systématiques contre la presse et la liberté d’expression. »
En réalité, et si l’on prend seulement l’exemple de la presse, il n’y a au Venezuela ni censure, ni intervention dans les rédactions, ni contrôle du net. Et si on n’appelle plus en direct au meurtre du président pendant le journal télévisé - comme aux pires moments de l’année 2002 - , le niveau de haine envers Chavez - régulièrement comparé à Hitler - dans les médias reste absolument hallucinant : ce point seul suffit à prouver combien la liberté de la presse est garantie. Il n’en est pas tout à fait de même pour la concentration des pouvoirs et la manipulation de la justice : si elles ne sont pas pires que dans la plupart des démocraties voisines, elles peuvent davantage poser question.
Au-delà, un point principal se fait jour, et c’est plutôt là que le bât blesse : Chavez est loin d’être aussi à gauche qu’on veut bien le dire. En clair : le « caudillo » sait jouer avec les mots. Ses grandes diatribes vengeresses sont souvent dépourvues d’implications pratiques, il reste totalement dépendant des États-Unis pour la vente du pétrole6 et il se montre grand pote avec le très droitiste président colombien Uribe. Quant aux riches vénézuéliens, ils conduisent des affaires florissantes, et rien ni personne ne semble pour l’instant en mesure d’y changer quoi que ce soit.
Trois obstacles principaux s’opposent en réalité au discours ronflant sur le « socialisme du 21e siècle » : l’énorme importance du secteur informel - les Vénézuéliens étant ceux qui se disent le plus « entrepreneur » au monde devant la Thaïlande et les États-Unis - , l’usage néopatrimonial de l’appareil d’état et l’appropriation quasi-mafieuse des ressources publiques et enfin la corruption minant le gouvernement et l’entourage de Chavez, ce dernier « laissant faire ».
Face à l’absence d’informations réellement sérieuses et de statistiques autres que celles du gouvernement, l’auteur tire deux conclusions provisoires sur la situation du Venezuela de 2006 : « En l’absence d’une modification profonde de la structure productive et du fonctionnement de l’État, il est très peu probable qu’on assiste à une réduction durable de la pauvreté et de la marginalité socio-économique au Venezuela. […] Il semblerait donc que, pour l’instant, la « révolution bolivarienne » offre aux secteurs populaires plus de « reconnaissance », certes assortie de toute une gamme de programmes d’urgence, que de réelle redistribution. »
Un constat à nuancer, précise t-il : « Pour une mère célibataire au chômage, par exemple, l’accès aux consultations et aux médicaments gratuits auprès d’un dispensaire médical de la mission Barrio Adentro (Au cœur du quartier), l’achat d’aliments à moitié prix dans un centre de distribution populaire Mercal, l’éventuelle obtention d’une bourse de rattrapage éducatif de la mission Robinson et le fait que l’école bolivarienne du quartier garde ses enfants toute la journée en leur offrant diverses activités socioéducatives et trois repas équilibrés par jour au lieu de les renvoyer au foyer ou à la rue en début d’après-midi se traduira logiquement par une nette amélioration de son niveau de « développement humain ». »
Pas de véritable révolution sociale donc, ni de réelle remise en cause des structures de la société, mais tout de même une petite amélioration de la situation de certains des plus défavorisés. Laquelle achoppe sur l’absence de vraie réforme de fond et sur une pénurie des produits de première nécessité que le gouvernement Chavez n’a jamais réussi à résoudre. Résultat : les critiques contre lui - y compris par ses partisans - se font plus nombreuses.
Plusieurs gauches, mais une seule légitimité : le peuple
Le reste du bouquin est tout aussi passionnant. L’auteur revient notamment sur le néo-péronisme de Nestor Kirchner, un outsider politique appliquant un type de politique propre à l’Argentine, dans la lignée de celles des Peron : un libéralisme économique mâtiné de préoccupations sociales et teinté d’une forte personnalisation du pouvoir, quasi-autoritaire sans toutefois vraiment tomber dedans. Même si Kirchner rompt aussi avec les anciens cadres politiques argentins, avec sa reconnaissance du combat des mères de la place de Mai, son soutien aux plus démunis et aux modes de fonctionnement économiques « alternatifs » - les entreprises coopératives fleurissent en Argentine - ou sa manière de renégocier la dette argentine au FMI, obtenant le plus gros rabais de l’histoire de l’institution.
Enfin, dans sa postface mise à jour en juillet 2008, l’auteur revient sur les dernières évolutions advenues depuis l’écriture du bouquin. Soit la réélection de Chavez, la question du référendum sur la non-limitation du nombre de mandats présidentiels et un certain ras-le-bol de la population vénézuélienne face au manque de réformes de fond de son président ; l’élection de Corréa en Equateur, réformateur semblant mener une véritable politique sociale ; les difficultés récentes de Kristina Kirchner en Argentine et de Michèle Bachelet au Chili ; l’élection de Fernando Lugo au Paraguay ; ou encore la crise régionale de mars 2008, très largement surjouée, entre Chavez et Uribe.
Reste une question : quid de Bolivar dans tout ça ? Il est justement l’un des grands absents du livre. Une simple figure tutélaire, servant à montrer à quel point tous ces gouvernements de gauche divergent encore, loin de réaliser son rêve d’une Amérique du sud forte, unie et consciente de sa particularité.
1 L’édition de poche a été mise à jour en juillet 2008, le reste a été écrit environ deux ans avant.
2 Article11 en avait parlé ICI.
3 Aujourd’hui, presque tous les pays d’Amérique du Sud ont un gouvernement marqué - plus ou moins - à gauche (à l’exception de la Colombie d’Uribe, des Guyane et de Suriname) : Bachelet au Chili, Kirchner en Argentine, Correa en Équateur, Chavez au Venezuela, Morales en Bolivie, l’ex-évêque Fernando Lugo, élu en octobre 2008, au Paraguay et Tabaré Vazquez en Uruguay (coalition de partis de gauche) depuis 2005.
4 Notamment par une presse très loin d’être toujours neutre…
5 Un augmentation de plus de 13 %, pour le bénéfice direct de plus de 40 millions de Brésiliens.
6 Les exportations pétrolières représentaient 85,3 % du total des exportations vénézuéliennes au premier semestre 2005, contre 68,7 % en 1998.