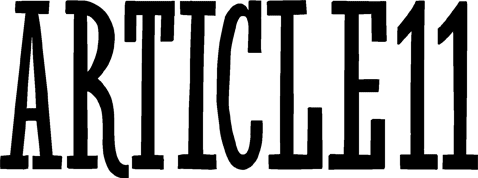vendredi 7 janvier 2011
Textes et traductions
posté à 23h37, par
4 commentaires
Il faudrait sans doute parler ici de néocolonialisme sémantique. Dans ce texte, publié en introduction de The Politics of Genocide, le linguiste Noam Chomsky revient longuement sur le double discours des pays colonisateurs. Et explique de quelle manière ces derniers utilisent le langage pour gommer la réalité des exterminations qu’ils ont provoquées. Traduction.
Ce texte - dont l’original est disponible ICI - est la préface de The Politics of Genocide, livre portant sur l’utilisation du terme « génocide ». Les auteurs reviennent sur l’instrumentalisation du mot - dans la deuxième moitié du XXe siècle - par les gouvernements, médias et universitaires pour diaboliser ceux qui s’opposent aux politiques impérialistes du capitalisme américain. Une lecture de l’histoire parfaitement en phase avec celle de Chomsky1.
Deux grandes questions parcourent ce texte. Quel est le véritable sens des mots que l’on utilise, et particulièrement du terme génocide ? Et surtout, comment les États-Unis ont-ils réussi à faire oublier au reste du monde que la fondation de leur pays repose sur l’une des plus grandes exterminations de masse qui soit ?
La fin de la guerre froide a ouvert la porte à une ère de négation virtuelle de l’Holocauste. C’est peut-être la leçon la plus bouleversante de cette magistrale enquête. Comme le disent les auteurs plus sobrement, « Au cours des dernières décennies, le mot « génocide » a augmenté en fréquence d’utilisation et a été utilisé de manière de plus en plus insouciante, si bien que le crime du 20e siècle pour lequel le terme a été inventé à l’origine semble souvent galvaudé. » Ils montrent qu’un usage courant de ce terme est une insulte à la mémoire des victimes des nazis.
Il peut être utile, toutefois, de rappeler que les pratiques sont profondément enracinées dans la culture intellectuelle en vigueur, si bien qu’elles ne seront pas faciles à éradiquer. Nous pouvons observer cela en considérant les cas de génocides les moins ambigus et leur dévalorisation sémantique. Les cas pour lesquels le crime est reconnu par ceux qui l’ont perpétré, mais est désormais perçu comme insignifiant, voire a été rétrospectivement nié par ceux qui en ont profité, jusqu’à aujourd’hui.
Le colonialisme d’occupation, souvent la forme la plus vicieuse de conquête impériale, en fournit des illustrations frappantes. Les colons anglais en Amérique du Nord ne s’embarrassaient pas d’états d’âme. Le général Henry Knox, héros de la guerre révolutionnaire et premier secrétaire à la guerre dans les colonies d’Amérique nouvellement libérées, a ainsi décrit « le déracinement complet de tous les Amérindiens dans la plupart des régions peuplées de l’Union » comme ayant été réalisé de manière « plus destructrice pour les indigènes Américains que ne l’a été l’attitude des conquérants du Mexique et du Pérou ». Ce qui n’aurait pas été une mince affaire. Dans ses dernières années, le président John Quincy Adams a reconnu le sort de « cette malheureuse race d’indigènes Américains, que nous exterminons avec tant d’impitoyable et perfide cruauté, [comme faisant partie] des abominables péchés de cette nation, pour lesquels je crois que Dieu [la] jugera un jour. »
Les commentateurs contemporains voient les choses différemment. L’éminent historien de la guerre froide John Lewis Gaddis salue en Adams le grand stratège qui a posé les bases de la Doctrine Bush selon laquelle « l’expansion est la voie vers la sécurité. » De façon plausible, et avec une évidente satisfaction, Gaddis considère cette doctrine comme systématiquement applicable tout au long de l’histoire de « l’empire naissant », comme George Washington appelait la nouvelle République. Gaddis passe sous silence les contributions macabres d’Adams aux « abominables péchés de cette nation », lors de l’établissement de cette doctrine et de celle de la guerre décidée par l’exécutif - en violation de la Constitution - dans un célèbre document du Département d’État justifiant la conquête de la Floride selon des prétextes totalement fallacieux de légitime défense. La conquête a fait partie du projet d’Adams de « déplacer ou éliminer les Amérindiens du sud-est », pour reprendre les termes de William Earl Weeks, le grand historien du massacre, qui fournit un compte-rendu macabre de la « démonstration d’assassinat et de pillage » prenant pour cible les Indiens et les esclaves en fuite.
Pour citer un autre exemple, dans le numéro du 11 Juin 2009 d’un leader mondial des revues intellectuelles libérales, The New York Review of Books, l’analyste politique Russell Baker décrit ce qu’il a appris du travail de l’ « héroïque historien » Edmund Morgan : à savoir, que Christophe Colomb et les premiers explorateurs ont « trouvé une immensité continentale faiblement peuplée par des agriculteurs et des chasseurs... Dans le monde sans limites et préservé qui s’étend de la jungle tropicale au nord congelé, il pouvait y avoir à peine plus d’un million d’habitants. » Le calcul est estropié de plusieurs dizaines de millions, et l’ « immensité » comprenait des civilisations avancées, mais peu importe. L’exercice de déni du génocide nécessite peu de préavis, sans doute parce qu’il est si banal, et réalisé pour la bonne cause.2
La conquête impériale illustre une autre thèse qu’Herman et Peterson explorent : Ce que l’ambassadrice d’Obama à l’ONU, Mme Susan Rice, appelle la « norme internationale émergente reconnaissant le « devoir de protection » dont disposent les civils innocents face à la mort à grande échelle ». Il est bon de garder à l’esprit que la norme n’est pas « émergente », mais plutôt séculaire, et a constamment été une ligne directrice impériale, invoquée pour justifier le recours à la violence quand d’autres prétextes font défaut.
Les conquistadors espagnols du début du XVIe siècle ont pris soin d’apprendre aux indigènes que si vous « reconnaissez l’Église comme souveraine et régnante sur le monde entier, » alors nous « vous accueillerons dans l’amour et la charité, et vous laisserons, vous, vos épouses, vos enfants et vos terres, libres et hors de la servitude, » et même « nous vous accorderons de nombreux privilèges et exemptions et vous donnerons de nombreux avantages, » accomplissant ainsi notre devoir de protection, selon la terminologie actuelle. Mais ceux qui sont protégés ont aussi des responsabilités, comme n’ont pas manqué de sévèrement le rappeler les humanitaires espagnols : « si vous [manquez à ces obligations, alors] nous entrerons dans votre pays avec fracas, et ferons la guerre contre vous de toutes les façons que nous pourrons ... et nous considèrerons que les décès et pertes découlant de ceci sont de votre fait, et non de la faute de leurs Altesses ou de la nôtre, ni de celle de ces cavaliers qui viennent avec nous » - des mots paraphrasés par certains groupes extrémistes islamiques - se considérant sans doute aussi comme bienveillants et humanistes - dans leurs mises en garde aux infidèles occidentaux.
Le Requerimiento des conquérants espagnols a trouvé un écho un siècle plus tard, parmi les colons anglais s’installant en Amérique du Nord. À ce jour, les États-Unis sont vus avec respect et admiration, chez eux du moins, comme « une ville sur une colline » ou, comme préférait l’appeler Ronald Reagan, « une ville qui brille sur une colline ». En avril 2009, l’historien britannique Geoffrey M. Hodgson s’est fait sermonner par le journaliste libéral du New York Times Roger Cohen, parce qu’il avait décrit les États-Unis comme « juste un grand - mais imparfait - pays parmi d’autres. » Cohen a expliqué que l’erreur d’Hodgson est son incapacité à comprendre que, contrairement aux autres États, « L’Amérique est née comme émerge une idée », comme une « ville sur une colline », une « notion inspirante » ancrée « en profondeur dans la psyché américaine. » Ses crimes ne sont que de simples défaillances malheureuses, qui ne ternissent pas la noblesse essentielle de la « finalité transcendante » de l’Amérique, pour reprendre l’expression de l’éminent savant Hans Morgenthau, l’un des fondateurs de l’école réaliste et insensible de la théorie des relations internationales, comme il l’écrit concernant « le but de l’Amérique. »
Comme les Espagnols, les colons anglais ont été guidés par les « normes humanitaires émergentes » de Rice. L’expression inspirante « ville sur une colline » a été inventée par John Winthrop en 1630, lorsqu’il décrivait l’avenir glorieux d’une nouvelle nation « sanctifiée par Dieu ». Une année plus tôt, sa colonie de la baie du Massachusetts recevait sa charte du roi d’Angleterre, et établissait son Grand Sceau. Le Sceau représente un indien tenant une lance pointée vers le bas en signe de paix, et suppliant les colons de « venir et nous aider ». La Charte stipule que la conversion de la population - les sauver de leur amer destin païen - était « le but principal de cette implantation. » Les colons anglais aussi réalisaient une mission humanitaire lorsqu’ils déplacèrent et exterminèrent les indigènes - pour leur propre bien, comme l’ont expliqué leurs successeurs. Pendant son deuxième mandat en tant que président il y a un siècle, Theodore Roosevelt a expliqué à un groupe de missionnaires blancs que « l’expansion des peuples de sang blanc, ou européen, au cours des quatre derniers siècles... s’est accompagnée d’un bénéfice durable pour la plupart des peuples vivant déjà sur les terres sur lesquelles l’expansion a eu lieu, » en dépit de ce que les Africains, les Amérindiens, les Philippins et les autres bénéficiaires pourraient croire à tort.
La politicisation vulgaire de la notion de génocide, et la « norme internationale émergente » de l’intervention humanitaire, semblent être des produits de la fin de la guerre froide, qui a supprimé les prétextes standards d’intervention tout en laissant intact le cadre institutionnel et idéologique menant à sa pratique régulière au cours de ces années. Il n’est pas surprenant, alors, que dans l’ère post-guerre froide, comme l’ont observé Herman et Peterson, « tout comme les gardiens de la « justice internationale » doivent toujours trouver un seul crime commis par une grande puissance blanche du Nord contre des gens de couleur qui relèverait de leur domaine de compétences, de même tous les beaux discours sur la « responsabilité de protéger » et la « fin de l’impunité » n’ont jamais été étendus une seule fois aux victimes de ces mêmes pouvoirs, quelle que soit la gravité des crimes commis. »
Ce résultat avait été prévu il y a soixante ans dans l’une des premières décisions de la Cour internationale de justice qui a statué à l’unanimité en 1949, dans le cas du Détroit de Corfou, que « La Cour ne peut considérer le prétendu droit d’intervention que comme la manifestation d’une politique de puissance, telle que celles qui ont donné lieu aux abus les plus graves par le passé et qui ainsi ne peuvent pas, quels que soient les défauts de l’organisation internationale, trouver une place dans le droit international... ; de par la nature des choses, l’[intervention] serait réservée aux États les plus puissants, et pourrait aisément conduire à pervertir l’administration de la justice elle-même. » L’intervention est comme le fleuve Mississipi, ainsi que l’a remarqué le spécialiste de droit international Richard Falk : elle coule du nord au sud.
Dans les grandes lignes, la même conclusion a été établie en 2004 par un groupe de haut niveau convoqué par l’Organisation des Nations Unies afin d’examiner le nouveau concept à la mode de « devoir de protection », invoqué par les États-Unis et ses alliés pour justifier une intervention militaire sans l’autorisation du Conseil de Sécurité. Le groupe a rejeté ce concept, en adoptant le point de vue du Sommet du Sud - représentant les victimes traditionnelles - qui avait condamné « le soi-disant « droit » d’ingérence humanitaire » à la suite des bombardements de la Serbie par l’OTAN. Le groupe de l’ONU a réaffirmé les conclusions de la Charte des Nations Unies, selon laquelle la force ne peut être déployée qu’avec l’autorisation du Conseil de sécurité, ou en vertu de l’article 51, dans la défense contre une agression armée jusqu’à ce que le Conseil de Sécurité agisse. L’article 51 est généralement interprété comme autorisant l’emploi de la force lorsque « la nécessité d’une action est immédiate, inévitable, ne laissant ni le choix des moyens, ni le moindre instant de réflexion », selon l’expression classique de Daniel Webster. Le groupe a conclu que « l’article 51 n’a besoin ni d’extension, ni de restriction quant à son champ d’application élargi, ... il ne doit être ni réécrit ni réinterprété. » Le comité a ajouté que « Pour ceux qu’une telle réponse ne satisfait pas entièrement, la réponse doit être que, dans un monde plein de menaces potentielles perçues, les risques envers l’ordre mondial et la norme de non-intervention sur laquelle il continue d’être fondé sont tout simplement trop importants pour accepter la légalité de l’action unilatérale préventive, par opposition à l’action collectivement approuvée. Permettre à l’un d’agir ainsi, reviendrait à le permettre à tous. »
Permettre à tous d’avoir les droits d’une puissance occidentale serait évidemment impensable. Ainsi, quand le vice-président Joe Biden dit (le 6 Juillet 2009) qu’Israël a le « droit souverain » d’attaquer l’Iran, et que les États-Unis ne peuvent pas entraver une telle action (avec l’équipement dont ils disposent) parce que Washington « ne peut pas dicter à un autre pays souverain ce qu’il peut et ne peut pas faire », il ne veut pas dire que l’Iran a le « droit souverain » d’attaquer Israël si le pays prend au sérieux les menaces régulières d’agression par la puissance nucléaire régnant sur la région, alors que les États-Unis se tiendraient tranquilles. Il est toujours nécessaire de se rappeler la maxime de Thucydide : « Tel que va le monde, le droit ne se discute qu’entre égaux dans le pouvoir, alors que les forts font ce qu’ils peuvent, et que les faibles subissent ce qu’ils doivent. » Ceci est le principe fondamental en vigueur dans l’ordre international.
Les pouvoirs impériaux traditionnels sont les seuls à adopter la « norme internationale émergente » de Rice sous la forme classique que cette dernière avait sans doute à l’esprit. Encore une fois, cela ne devrait guère être une surprise. Quant au terme « génocide », la voie la plus honorable serait peut-être de le radier du vocabulaire jusqu’au jour, si jamais il arrive, où l’honnêteté et l’intégrité deviendront une « norme émergente ».
Pour ceux qui souhaitent approfondir, les autres articles concernant Chomsky sur le site : Son hommage à Howard Zinn, la retranscription d’une de ses conférences : « le moment unipolaire et l’ère Obama », un retour sur la polémique le liant à l’antisémite Faurisson, ou encore sur sa visite récente à Paris.
1 Ce dernier considère que le terme génocide est aujourd’hui galvaudé, parce qu’il n’a plus grand chose à voir avec sa signification originelle. Selon lui, ce terme ne devrait être utilisé que lors de l’extermination d’un peuple à très grande échelle - la Shoah, par exemple. À moins - sinon - de re-qualifier un certain nombre d’actes, commis notamment par les puissances occidentales, en « génocides ».
2 Note de l’auteur : Aucune lettre n’est arrivée en réaction. Toutefois, quatre mois plus tard (le 8 octobre 2009), les éditeurs ont publié une « clarification », qui se lit comme suit : « Dans sa critique du recueil d’essais de Edmund S. Morgan Heros Américains : profils d’hommes et de femmes qui ont façonné l’Amérique à ses débuts NYR, 11 Juin, Russell Baker, en s’appuyant sur des estimations mentionnées dans l’essai de Morgan de 1958 L’Indien inflexible, a écrit que dans l’Amérique du Nord à l’époque de Christophe Colomb, il pouvait ne pas y avoir beaucoup plus d’un million d’habitants. Toutefois, les données archéologiques et des recherches démographiques au cours des dernières décennies suggèrent que ce nombre était beaucoup plus important, avec des estimations allant jusqu’à 18 millions d’habitants. » La « clarification » est peut-être même pire que l’original. Baker ne parlait pas de l’Amérique du Nord (« de la jungle tropicale »). Plus de trente ans auparavant, il était déjà de notoriété publique qu’en Amérique du Nord (telle que définie dans l’ALENA, Mexique compris), les populations se chiffraient en dizaines de millions, et beaucoup plus au-delà ; et que même aux États-Unis et au Canada, les chiffres étaient d’environ dix millions ou plus. Il était également connu, même bien avant, que l’ « immensité faiblement peuplée ... le monde préservé » comprenait des civilisations avancées (aux États-Unis et au Canada aussi). Cet épisode remarquable reste un « déni de génocide », souligné par la « clarification ».