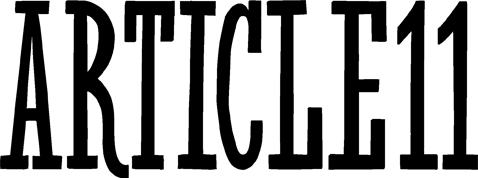vendredi 17 mai 2013
Politiques du son
posté à 18h37, par
0 commentaire
Deuxième partie d’une biographie subjective commencée ici et initialement publiée par la revue Geste : où l’on s’avise que la guerre sonne terriblement bien au théâtre et que l’on peut beaucoup s’amuser en manipulant les spectateurs ou, ce qui revient sensiblement au même, les ouvrières.
Le premier épisode est à lire ICI.
*
La guerre, et plus particulièrement la seconde mondiale, fut un terrain prolixe pour Burris-Meyer, c’est là qu’il put déployer pleinement ses recherches antérieures. La guerre comme matière du son, la guerre comme décor du son, la guerre comme objectif du son. Avant elle, il avait gagné en célébrité par les « sound shows » (les spectacles sonores) qu’il organisait, à la fois aboutissement et publicité de son travail scientifique (« scientifique ? », diront ses détracteurs) au Stevens Institute depuis les années 1930. Il était fervent défenseur de l’introduction du son électronique au théâtre pour augmenter l’intensité dramatique des représentations : « Les spectateurs d’aujourd’hui ont été endurcis par leur intense fréquentation des théâtres », disait-il1. – il convenait donc de surenchérir en effets sonores pour obtenir une réaction émotionnelle valable : un organisme accoutumé aux stupéfiants réclame des doses plus conséquentes. Il appelait cela « le contrôle du son » – c’était surtout, on l’aura compris et il ne se privait pas de le clamer haut et fort, le contrôle du public et de ses émotions. Il aurait bien voulu qu’un « psychogalvanomètre » puisse être branché sur les spectateurs pour mesurer précisément leur réaction aux effets sonores2 (en 1950, il déposa d’ailleurs un brevet pour un « appareil de mesure et d’enregistrement de l’attitude physique des individus » visant à déterminer avec précision l’évolution de leur « état émotionnel »3). John Bracewell, l’un de ses anciens étudiants devenu expert théâtral et sonore à son tour, ajoute : « Harold insistait toujours sur le fait que le meilleur laboratoire de recherche sur les gens – et il parlait de vraie recherche, de recherche empirique et mesurable – c’était le théâtre. Je ne connais absolument personne qui l’ait pris au sérieux, pas même moi, la première fois qu’il me l’a dit du moins. Il avait raison, bien sûr. »4 Il plaçait des haut-parleurs au milieu des rangées de fauteuils, peaufinait son « système de contrôle du son », modulait les voix avec le Vocoder récemment mis au point par les Laboratoires Bell Telephone, s’ingéniait à masquer les sources des sons, inventait des bruits mystérieux et avait créé un système de retour pour que les vedettes s’entendent, dans les vastes salles, aussi bien que dans leur chambre. Cette dernière technologie (un micro caché qui était relié un haut-parleur très directionnel placé à quinze mètres de l’interprète et audible de lui seul) était devenue « la Technique Robeson », du nom du chanteur et acteur enthousiaste avec qui il l’avait d’abord expérimentée. Le New Yorker s’en inquiétait en 1940 : « Si notre intuition est bonne, ’’l’enveloppe acoustique’’ (…) risque de faire regretter à la race humaine d’être dotée d’un larynx. Laissez croire à tous les hommes publics qu’ils ne font que se parler à eux-mêmes dans une pièce aussi petite qu’un coffre, et il est bien possible que vous inauguriez la plus grande époque de démence que le monde ait connu. »5
Bien avant Gaspar Noé et son infrabasse de 28 hertz dans la première demi-heure du film Irréversible, Burris-Meyer plaçait des fréquences « subsoniques », disait-on à l’époque, « infrasoniques » dirait-on aujourd’hui (12 Hz, c’est-à-dire si graves qu’elles en deviennent inaudibles, leurs seules vibrations demeurant perceptibles), juste avant et pendant la scène inaugurale de la pièce The Emperor Jones, pour que les spectateurs en aient une inexplicable chair de poule6. Un « écran à tonnerre », à savoir une feuille de cuivre tendue dans un cadre en bois, frottée, tapée ou griffée, permettait d’obtenir bon nombre d’effets, immédiats ou électroniquement retravaillés7. Dans une représentation d’Hamlet, il avait fabriqué au fantôme (une image projetée sur la scène) « une voix sépulcrale » qui se déplaçait en même temps que le spectre, un réalisateur dans les coulisses ajustant le volume des divers haut-parleurs au fur et à mesure de sa progression8. On dit que ses expérimentations en son multicanal ne furent pas étrangères à l’invention du « Fantasound », la stéréophonie mise au point pour le Fantasia de Disney par Leopold Stokowski (un compositeur) avec William Garity (un ingénieur du son) et John Hawkins (un mixeur). En quoi exactement, et puis, est-ce certain ? Ce n’est pas clair. James Tobias, auteur du rapport critique publié par la Rockefeller Foundation, ajoute qu’il y avait de grandes différences entre les objectifs de Disney et ceux de Burris-Meyer : le premier produisait un son reproductible à l’identique dans un maximum de salles quand Burris-Meyer, DJ avant l’heure, créait des environnements mixés en direct ; et surtout, Disney inventait le son surround, qui deviendra la marotte acoustique de la seconde moitié du XXe siècle, tandis que Burris-Meyer se concentrait sur le son localisable9, objet de toutes les attentions industrielles et militaires au début du XXIe siècle. Et quoique Burris-Meyer ait de facto conduit en 1941 les premiers enregistrements stéréophoniques pour Bell Labs (des lectures jouées de The Emperor Jones et Cyrano de Bergerac)10, l’histoire de la stéréo a tranché comme les autres : à Disney tous les lauriers, Burris-Meyer n’y apparaît que furtivement.
« Harold répétait : ’’Le rôle du théâtre c’est d’allumer le public.’’ Ce qu’il voulait dire, c’est que le théâtre (et toute forme d’art) doit s’emparer des gens à travers leurs émotions, mais que pour y parvenir de manière fiable et reproductible, il nous fallait apprendre comment les émotions humaines étaient programmées – il nous fallait des données expliquant pourquoi et comment les gens réagissent comme ils le font, et la manière dont les stimuli sensoriels affectent la réponse émotionnelle. Après tout, le théâtre n’est qu’une affaire de stimuli sensoriels. »11 Burris-Meyer glissait doucement des sciences de la représentation à celles du comportement, qui commençaient à occuper sérieusement les esprits policiers et militaires de l’époque. Dans Adding Machine d’Elmer Rice, il frôlait sa grande ambition, qui était de produire à volonté des « hystéries de masse » au moyen du son12 : « Nous avons essayé de faire de l’expressionisme sonore (…) et de rendre les spectateurs complètement fous au moment où le personnage principal perdait la raison. Nous avons presque réussi. Et le principal dispositif pour cela était un son vibrant quasiment pur dont on a augmenté la hauteur et l’intensité pendant 32 secondes, alors que le décor tournoyait et que M. Zero se transformait en tueur. »13. À la même époque, Orson Welles diffusait à la radio sa fiction extraterrestre La guerre des mondes et déclenchait une panique générale. Certains à la Rockefeller Foundation trouvaient Burris-Meyer un peu « naïf »14. Ils le soupçonnaient de surestimer franchement l’impact émotionnel de ses manipulations sonores sur le public : « Burris-Meyer a développé une technologie très prometteuse mais il ne sait pas s’en servir proprement. (…) Lui et ses collaborateurs sont si obsédés par la création du son qu’ils semblent n’avoir aucun esprit critique sur l’effet obtenu. Par exemple, ils sont bien parvenus à produire des voix parfaitement étranges pour les sorcières de Macbeth, mais si étranges que les deux tiers des phrases étaient incompréhensibles. »15
Terrifier ou aider, apaiser ou piéger, c’était tout un pour Harold Burris-Meyer, on n’allait pas se mentir : il ne s’agissait ni plus ni moins que de donner au pouvoir – politique, militaire, industriel, médical ou éducatif, nécessairement légitime et donc irréprochable, suppose-t-on, légitimant et moralisant de fait toutes les actions de qui s’y inféode – le moyen de manipuler un individu à travers ses oreilles. Burris-Meyer s’en inquiétait parfois, mais il fallait bien reconnaître que tout cela était terriblement amusant à inventer. En 1940, il avait commencé à travailler pour Muzak Corporation : « Muzak », une contraction de « music » et « Kodak » trouvée par son fondateur, le major général George Owen Squier – il fallait inventer la musique automatique, disponible sur demande, et les tuyaux qui la diffuseraient. Le succès de l’entreprise et de la contraction furent tels que « muzak » entra ensuite dans le dictionnaire comme synonyme de ce que la société fabriquait à la chaîne, de la musique d’ascenseur. Burris-Meyer fit paraître en 1943 dans le magazine Mechanical Engineering le produit de ses recherches sur « La musique dans l’industrie ». C’était la guerre, et il fallait stimuler la production ouvrière, essentiellement féminine, pour soutenir l’effort national – la musique fut enrôlée et se montra, suivant les conclusions de Burris-Meyer, fort bonne patriote. Les journaux s’empressaient de relayer ses statistiques : « Suite à l’introduction de programmes musicaux dans 16 usines, la production moyenne mesurée en unités par employé a augmenté de 6,25 %. (…) Le départ des postes de travail avant l’heure correspondait à 2,52 heures manquantes par personne avant la musique, contre seulement 0,845 après. L’absentéisme du lundi matin a chuté de 22,75 % à un petit 2,85 % de moyenne après que la musique soit devenue une réalité quotidienne. »16
La vraie trouvaille de Muzak n’était pas dans la diffusion sur le lieu de travail en tant que telle – après tout, comme disait Burris-Meyer, « il y a bien longtemps, beaucoup de travaux ne pouvaient s’accomplir sans musique »17 – mais dans la programmation. Burris-Meyer avait mis au point avec son collègue et ami Richard Cardinell la méthode révolutionnaire de Muzak, la « Progression du stimulus ». L’idée en était attribuée à Don O’Neill, l’un des dirigeants : la musique était organisée en quarts d’heures d’intensité variable « suivant une ’’courbe ascendante’’ qui luttait contre la ’’courbe de l’efficacité industrielle’’ ou, comme la nommait certaines autorités, la ’’ courbe de fatigue’’ de l’employé. »18 Il y avait un programme calme pour les bureaux et un programme plus fort, avec des cuivres, pour les usines. On prenait garde à ne pas mettre de morceaux trop distrayants ni trop euphorisants (bientôt on adapta les tubes du moment en les nettoyant de toute aspérité) : la musique était là, rappelait Burris-Meyer, pour « concentrer l’homme sur sa tâche, donner au travail le statut d’un métier et faire de ce travail, non pas un gagne-pain, non pas le moyen de toucher une enveloppe, mais un élément central de la vie d’un homme. » Tout cela était très scientifique, précisait-il : « Nous disposons d’une masse considérable d’informations physiologiques et psychologiques. Grâce au stimuli auditifs, nous pouvons contrôler le métabolisme (Tartchanoff et Dutton). Nous pouvons augmenter ou abaisser l’énergie musculaire (Feré, Tartchanoff et Scripture). Nous pouvons accélérer la respiration (Binet, Guibaud, Weed). Nous pouvons augmenter ou abaisser le rythme cardiaque (Grétry, Hyde, Scalapino). Essayez donc ça sur vous-même. (…) Nous pouvons contrôler le seuil de perception sensorielle (Kravkov, Diserens, Urbanschisch), crucial dans le travail de précision. Nous pouvons réduire, différer ou augmenter la fatigue (Diserens et Tartchanoff). En contrôlant tous ces phénomènes, il est possible d’établir une base physiologique permettant de générer une émotion (James Lange). »19 N’en déplaise aux tristes sires d’université qui trouvèrent sa méthode de fabrication des statistiques plutôt légère et ses conclusions, par conséquent, douteuses, c’est donc très naturellement que Burris-Meyer se fit ardent promoteur de la génération industrielle des émotions et que Muzak continua de faire fortune en mettant de la musique efficace partout, usines, magasins, restaurants, lieux publics.
1 James Stokley, « New Theater Sound Effects... », op. cit.
2 James Tobias, « Composing for the Media : Hanns Eisler and Rockefeller Foundation Projects in Film Music, Radio Listening, and Theatrical Sound Design », Rockefeller Foundation Archives, 2009, p. 68.
3 Harold Burris-Meyer, « Apparatus for Measuring and Recording the Physical Attitudes of Subjects », United States Patents Office, brevet n°2 688 873, déposé le 5 décembre 1950, octroyé le 14 septembre 1954.
4 « Harold Burris-Meyer, 1902-1984, comments by John Bracewell », Usitt, hiver 1985.
5 « The Talk of the Town », The New Yorker, 21 décembre 1940, p. 9.
6 Harold Burris-Meyer, Vincent Mallory, Lewis S. Goodfriend, Sound in the Theatre, Theatre Arts Books, 1979, p. 6.
7 James Stokley, Science Remakes Our World, Ives Washburn, 1942, p. 252.
8 « Stage Sounds Moved at Will by Remarkable New Method », Popular Science, août 1934.
9 Email de James Tobias le 8 août 2012.
10 « Harold Burris-Meyer », Who’s Who in the American Theatre, Heineman, 1966, p. 331.
11 « Harold Burris-Meyer, 1902-1984, comments by John Bracewell », op. cit..
12 James Tobias, « Composing for the Media », op. cit., p. 66.
13 James Stokley, « New Theater Sound Effects... », op. cit.
14 James Tobias, « Composing for the Media », op. cit., p. 62.
15 James Tobias, « Composing for the Media », op. cit., p. 69.
16 « War Work Set to Music », Popular Mechanics, décembre 1943, p. 42.
17 Harold Burris-Meyer, « Music in Industry », Mechanical Engineering, janvier 1943, p. 31.
18 Joseph Lanza, Elevator Music : A Surreal History of Muzak, Esay-Listening and other Moodsong, Quartet Books, 1995, p. 49.
19 Harold Burris-Meyer, « Music in Industry », ibid..