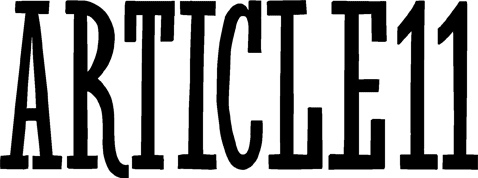Le cortège avançait lentement. De temps en temps, un grondement brisait le silence : « Assassins, assassins ! » La police avait disparu. L’énorme masse de la manifestation progressait d’un bloc de façon irréelle.
Cet article a été publié dans le numéro 18 d’Article11
*
« Destituer le pouvoir, c’est le priver de son fondement.
C’est ce que font justement les insurrections. »
Comité invisible, À nos amis
Soutenir qu’une histoire a toujours sa version officielle, celle des « vainqueurs », est aujourd’hui un lieu commun. Le récit manichéen du Pouvoir réduit la complexité des aventures communes et gomme l’intensité des expériences partagées. Après une défaite politique, les « perdants » sont souvent mutiques et apathiques. Éclatés collectivement, anéantis personnellement. La douleur, intime, est recluse. Le silence est de mise.
Un passé oublié et simplifié peut se recomposer à l’aune du présent et de l’à-venir1. Il en va ainsi de l’ébullition politique, sociale et culturelle italienne des années 1970. Pour les centaines de milliers de protagonistes de cette lente épopée insurrectionnelle qu’était l’Autonomie, le « Mouvement de 1977 » ne s’est jamais fondu dans l’épitaphe « les années de plomb ». Traversé d’une foule d’autonomies, ledit mouvement était avant tout un ethos collectif opposé au travail et à l’État. Il a occupé les usines, les universités, les rues et les places, les quartiers, les asiles, les corps, les sexes, le temps et bien d’autres « lieux ». Il a créé ses propres langages, ses formes de communication, et surtout la conscience commune de participer à une même révolution.
Traditionnellement, on situe la naissance de l’Autonomie ouvrière au mois de mars 1973 à Bologne, lors de la 1re Convention nationale des assemblées et organismes autonomes d’usines et de quartiers. Elle trouve ses racines théoriques dans la revue néo-marxiste Quaderni Rossi, née en 1962, et dans son avatar Classe Operaia, publiée entre 1964 et 1967. De ces débordements du Parti communiste italien (PCI) sont issus de nombreux groupes extra-parlementaires qui, après 1968 et les luttes étudiantes, commencèrent à s’articuler aux réseaux émergents de la contre-culture, du féminisme et de l’écologie balbutiante.
C’est en 1973, dans le contexte du coup d’État au Chili et de la « crise » pétrolière, que le PCI engage un « compromis historique » avec la Démocratie chrétienne (DC), véritable Parti-État, au pouvoir sans interruption depuis 1948. À partir de cette rupture politique, l’Autonomie ouvrière s’oppose radicalement et définitivement au PCI et aux syndicats ouvriers officiels. L’usine Mirafiori de la Fiat à Turin devient pour plusieurs années l’un des principaux foyers d’expérimentation de l’Autonomie. Les nombreuses petites usines, dans lesquelles les statuts des ouvriers sont précaires, ne sont pas en reste. Lentement, le Mouvement glisse de l’autonomie ouvrière à l’autonomie dans la société. Étudiants, femmes, homosexuels, prisonniers, chômeurs et exclus en tout genre entrent en lutte. La révolte féministe ouvre notamment à l’Autonomie de nouvelles perspectives : elle met la gestion des corps au cœur du processus révolutionnaire. Le personnel devient politique, la qualité de la vie un enjeu. Les subjectivités militantes évoluent.
À partir de la fin 1974, des cortèges hebdomadaires fleurissent dans de nombreuses villes, traversant les rues, occupant les places et alimentant subrepticement une atmosphère insurrectionnelle qui culmine les 11 et 12 mars 1977 à Bologne et Rome à l’occasion de deux imposantes manifestations. Ce moment de quasi guerre civile devient aussi celui d’une rupture : effrayé, le gouvernement italien accentue violemment la répression. Il déclare l’« État d’exception », intensifie la « stratégie de la tension », et provoque finalement un reflux du mouvement vers l’intime - fuites, héroïne, folie, morts et trahisons pour tristes issues dans la défaite. Face à un mouvement acéphale, la Justice cherche des « chefs » : ce seront les intellectuels et quelques meneurs identifiés. Enfin, certains groupes multipliant les actions armées entre 1977 et 19792, il se produit un processus de séparation. L’entrée en clandestinité marque la fin de l’ethos commun, d’une certaine forme de vie – un retour à l’absence au monde. L’État italien, sa justice et ses médias diabolisent et criminalisent l’ensemble d’un mouvement fertile, hétérogène et complexe.
Condenser en quelques paragraphes le foisonnement d’histoires, de luttes, de théories et de pratiques incarnant ce mouvement est périlleux. On peut seulement en esquisser les grandes lignes en s’appuyant sur l’introduction des trois volumes de témoignages (inédits en France) coordonnés par Sergio Bianchi3 et Lanfranco Caminiti, Gli autonomi. Le storie, le lotte, le teorie, publiés par les éditions Derive Approdi en 2007 et 2008. Cette œuvre minutieuse de constitution d’une archive à plusieurs voix, parfois dissonantes, fuit la vulgate officielle et offre un matériau neuf pour penser cette époque.
Ci-dessous, la traduction de l’un de ces textes, extrait du 1er volume. Il s’agit d’un retour personnel et sensible sur la manifestation romaine du 12 mars 1977, signé Davide Germani. Un bref moment où le temps est suspendu, où le collectif se condense dans l’intime, où s’institue « le vrai état d’exception »4, et où le déroulé des événements et la question de la violence face à l’appareil oppressif d’État – toujours si contemporaine – imposent de facto une décision.
*
12 mars
Le téléphone sonnait. Des vêtements mouillés, imbibés de gaz lacrymogènes, émanait une odeur âcre. Dans la pièce, l’air était irrespirable. Le téléphone continuait de sonner. Rita allongea le bras et répondit. Elle acquiesça de la tête et passa le combiné à Matteo. Sa voix préoccupée n’augurait rien de bon : « Vous ne devez pas passer. Il faut abandonner la voiture et poursuivre à pied. » Nous étions chez Rita depuis plus d’une heure, attendant que l’étau des filtres de police se desserre. Après l’impressionnante manifestation de l’après-midi, la ville était de nouveau sous le contrôle des forces de l’ordre. Matteo raccrocha et lança, les traits tirés : « Il y a un poste de contrôle à hauteur de la prison de Regina Coeli. Fabio, Mara et Luca se sont arrêtés dans un bar. » Il ajouta : « Fabio veut essayer de passer. » Je lui ai demandé : « La voiture est nettoyée ? » Clignant des yeux, il me fit signe que non. Le silence tomba sur la pièce.
*
Ce jour de mars, le ciel était divisé en deux : d’un côté, un bleu azur intense, d’où resplendissait le puissant soleil du printemps romain ; de l’autre, un nuage menaçant, grave et gris comme le plomb. Depuis les premières heures de l’après-midi, la piazza Esedra s’était progressivement remplie. Le climat était tendu. La veille, lors d’une manifestation à Bologne, les carabiniers avaient, dans les affrontements, tué un camarade5. Cela faisait environ trois mois que, chaque samedi, le mouvement occupait le centre de Rome par d’énormes manifestations. Cette journée était cependant un peu différente, et pas seulement pour ce qui était arrivé à Bologne.
Les files serrées du service d’ordre ouvraient un cortège sans drapeaux, se dirigeant droit vers la via Nazionale. À l’entrée de la rue s’avançait une petite patrouille de policiers, majoritairement en civil. Un petit groupe des nôtres alla à leur rencontre. Ça se passait souvent comme ça avant les départs. On mesurait les forces, les intentions des flics, et par conséquent le parcours du cortège. Mais, ce jour-là, cette habitude sauta. On ne parlait pas, on ne menaçait pas, on ne cachait pas nos objectifs. On se contentait de communiquer du regard. Et on se comprenait parfaitement.
Nous savions où aller et ils savaient où nous attendre. Ce qu’ils ne savaient pas, c’était comment on y arriverait. Nous fîmes semblant de descendre par la via Nazionale et ils se disposèrent à nous en empêcher, mais à la première perpendiculaire nous prîmes à gauche pour aller vers la via Cavour. Ce mouvement les déconcerta. Ils ne comprenaient pas pourquoi nous avions renoncé à descendre par la via Nazionale. Mais nous savions quelle était notre destination et nous voulions arriver en position favorable. Les cortèges du mouvement avaient une grande souplesse, parce qu’ils savaient prendre des décisions rapidement et se déplacer tout aussi vite. Une aptitude largement démontrée les mois passés.
Devant nous, la via Cavour était déserte. Une longue descente sans voitures, sans passants, avec tous les commerces fermés. Il commença à pleuvoir. Le cortège avançait lentement. De temps en temps, un grondement brisait le silence : « Assassins, assassins ! » La police avait disparu. L’énorme masse de la manifestation progressait d’un bloc de façon irréelle. Compacts et déterminés, on ne s’arrêta même pas pour briser les vitrines de l’hôtel Palatino, étape obligée de toutes les manifestations passant dans le coin. La légende du mouvement voulait que le propriétaire ait été militaire dans la Decima Mas6. Nous avons continué à descendre vers la via dei Fori Imperiali. Alors que la pluie redoublait, la nuit tombait et les lumières de la ville tardaient à s’allumer. Je regardais les visages trempés de mes camarades, leur rage, leur égarement.
On arriva piazza Venezia du bon côté, c’est-à-dire avec le Vittoriano7 dans le dos, la via del Corso face à nous. C’était là que nous voulions aller. Et c’était là qu’ils nous attendaient. On stoppa et les équipes du service d’ordre commencèrent à se déployer autour de la place. Cela faisait des années que je manifestais, mais je n’avais jamais vu une telle démonstration de force et d’organisation.
Même si c’était une manifestation nationale, la majorité des personnes composant le cortège venait des périphéries romaines. Indépendamment des idéologies plus ou moins fumeuses qui existaient au sein du mouvement, et au-delà du fait que les membres du cortège fussent femmes ou hommes, jeunes ou vieux, étudiants ou ouvriers, chômeurs ou oisifs, leur essence propre était d’affirmer le droit d’en être. La pluie n’avait pas cessé et les lumières de la ville ne s’allumaient toujours pas. Quasiment plongée dans le noir, la place n’était éclairée que par les clignotants des blindés, dont l’avant pointait vers le Vittoriano, et qui obstruaient l’entrée de la via del Corso. L’attente commença. Nous ici et eux là, rangés comme dans une bataille antique, quand l’ennemi était encore visible.
Lors des échauffourées avec la police, il y a toujours un moment où tout semble se ralentir. Il advient généralement après l’impact initial, lorsque s’éteint le feu des premiers cocktails molotov et que monte la fumée des premiers gaz lacrymogènes. Au sein de cette zone enveloppée d’un silence absolu, alors que tout autour est en mouvement, hurle et fuit, les belligérants peuvent percevoir leurs propres voix, leurs propres ordres, leurs propres insultes. Si la peur pouvait faire du bruit, voilà ce que l’on entendrait : ces voix et ces insultes. Ce jour-là, la place entière était envahie de cette peur, qui remontait tout le cortège jusqu’à la piazza Esedra.
Ce jour-là, sans que personne ne l’ait décidé, donc sans aucun désaccord, un objectif commun s’était dégagé : pénétrer la zone interdite, se diriger vers les palais de la République. Comme préparée à l’événement, la ville semblait s’être abandonnée à l’éventualité de ce règlement de comptes.
On entrevoyait le long de la via del Corso, derrière les blindés, les milliers de casques de la police et des carabiniers qui brillaient, baignés par la pluie. Une vision d’enfer. Nous faisions face à se déploiement avec toute notre force, si importante et dérisoire à la fois.
Avant une décision, même de peu d’importance, se crée en chacun de nous un état d’exception, pendant lequel les « pour » et les « contre » alternent dans une régression à l’infini. Ce jour-là et sur cette place, par je ne sais par quelle alchimie, ce même statut d’exception se manifesta de façon collective, provoquant une sorte de suspension. Règles, rôles et hiérarchies perdirent leur sens et tout sembla possible. La pluie ne s’arrêtait pas et les lumières ne s’allumaient pas. Tout était arrêté, tout semblait inévitable. Les différentes formations se regardaient, dans l’attente du premier geste. Seul mouvement : l’affairement d’un petit groupe de camarades discutant vivement au sein du cortège et tentant de s’arroger la possibilité d’une décision. Combien d’entre nous avaient rêvé ce moment ? Combien s’étaient battus pour qu’il arrive ? Combien l’avaient craint ? Et voilà que nous étions là, suspendus dans l’instant, en attente de quelque chose.
Qui n’advint pas.
Nous ne décidâmes pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas quelle importance ça peut avoir de savoir. Nous tournâmes vers la via del Plebiscito, les laissant décider de notre trajet. Et ce cortège devint ainsi un autre cortège, et cette histoire une autre histoire.
*
Dans la pièce, l’air était de nouveau respirable. Le téléphone ne sonnait plus. Désormais secs, même si l’odeur acide persistait, nous regardions le journal télévisé. Des affrontements en divers endroits de la ville, des centaines d’arrestations, des centaines de blessés parmi nous et les forces de l’ordre, des saccages, des dizaines et des dizaines de voitures et d’équipements publics incendiés, voilà ce que racontait un présentateur qui s’interrompit tout à coup. On lui tendit une feuille et il commença à lire : « Tard dans la soirée, aux alentours de la prison de Regina Coeli, a eu lieu un échange de tirs entre une patrouille de carabiniers et les occupants d’une voiture qui ne s’est pas arrêtée au contrôle. Deux carabiniers et l’un des passagers ont été grièvement blessés. » Nous n’avons pas dit un mot, nous contentant de fixer les images sur l’écran, stupéfaits.
Ces deux aspects apparemment contradictoires avaient marqué cette journée. L’indécision de la place et le vide de la décision unilatérale de mes camarades synthétisèrent de manière parfaite les limites pesant sur le mouvement. Ce sont les mêmes qui pèsent sur chaque mouvement quand les événements ne s’agencent pas comme ils devraient. Les choses arrivent, quand elles arrivent, simplement parce qu’elles doivent arriver.
Davide Germani8
***

- Rome, 1977 - photo de Tano d’Amico
Une manifestation explosive
La manifestation du 12 mars 1977 à Rome réunit environ 100 000 personnes. Un certain nombre sont armés. Contrairement à Davide Germani et ses amis, de nombreux autonomes restent dans les rues après l’éclatement du cortège. Le soir, les affrontements entre des groupes de manifestants organisés et les forces de l’ordre durent pratiquement cinq heures. Près de 500 cocktails molotov sont lancés piazza del Gesù. Le siège de la DC est attaqué. Piazza del Popolo, le bar Rosati (lieu de rendez-vous des fascistes) et le poste de commandement des carabiniers sont pris pour cibles. D’autres lieux sont saccagés : un commissariat de police, le siège du quotidien de la DC, l’ambassade du Chili, une filiale de la Fiat, une caserne de police municipale, les bureaux de la compagnie de téléphone SIP, l’hôtel Palatino (épargné l’après-midi) et de nombreux commerces et banques. Des dizaines de voitures et de bus sont incendiés et servent de barricades. Une bombe explose au poste de commandement régional des carabiniers. Deux armureries sont saccagées et pillées. Le ministère de la Grâce et de la Justice est pris d’assaut, en vain. Les arrestations sont nombreuses, les blessés de part et d’autres aussi.
1 Cet incipit comme le prologue est largement redevable à l’indispensable ouvrage Autonomie ! Italie, les années 1970 de Marcello Tarì, publié par les éditions La Fabrique en 2011.
2 Le président du Conseil, Aldo Moro, de la DC, est notamment enlevé puis assassiné en mai 1978 par les Brigades rouges.
3 La nouvelle « Je ne sais pas », signée Sergio Bianchi et traduite par Serge Quadruppani, a d’ailleurs été publiée dans le n°15 d’Article11. A lire ICI.
4 Selon la formule de Marcello Tarì.
5 Francesco Lorusso, étudiant en médecine et militant du groupe extra-parlementaire Lotta continua. (Toutes les notes sont du traducteur.)
6 Unité de nageurs de combat de la Marine royale italienne qui a opéré au cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle disparut à la chute de Benito Mussolini. Certains des plongeurs fascistes partirent combattre les partisans, d’autres rejoignirent les Alliés.
7 Monument construit à la gloire du roi Victor-Emmanuel II, considéré comme un des piliers de l’unification italienne en 1861.
8 L’auteur a choisi un pseudonyme. Il est originaire de la périphérie romaine, a été membre de Potere Operaio puis de l’Autonomie. Il a été arrêté et condamné. Il est aujourd’hui commerçant.