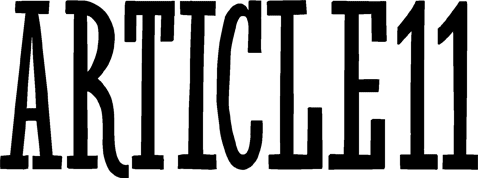mercredi 8 juillet 2015
Vers le papier ?
posté à 16h57, par
5 commentaires
Lancé il y a dix ans, La Directa est un hebdomadaire au fonctionnement horizontal, diffusé en Catalogne. Né sur papier, présent sur le web depuis 2011, et rédigé en catalan, ce « média d’information au service de la transformation sociale » a ses locaux dans l’effervescent quartier de Sants, à Barcelone. Rencontre avec Jesús Rodríguez, artisan historique de cet enthousiasmant journal, dont l’existence participe grandement de la vivacité politique locale (1).
Comment est né le journal ?
« La Directa a vu le jour aux alentours de 2005, impulsé par deux groupes de personnes très en lien avec les mouvements sociaux. D’un côté, des activistes et des gens en lutte, pour beaucoup investis dans les espaces de communication des mouvements auxquels ils prenaient part. Ils avaient donc l’habitude de communiquer avec la presse, parce qu’ils se chargeaient des équipes médias lors des actions ou parce qu’ils participaient à des revues impliquées dans divers mouvements de lutte : d’occupation, féministes, écologistes, indépendantistes, anarchistes... Et de l’autre côté, il y avait des gens qui étudiaient le journalisme, principalement à l’université autonome de Barcelone. Tous partageaient une vision critique de la profession, considérant que le journalisme mainstream se résume à défendre les intérêts des marchands ou des institutions.
Ces personnes, issues de deux types de parcours bien différents, ont donc constitué un groupe de travail, avec l’idée de lancer une nouvelle publication papier. À l’époque, nous avons beaucoup débattu de la ligne éditoriale, du rubriquage, de la périodicité, du système de distribution – toutes ces grandes questions qui agitent forcément une nouvelle publication de presse. L’une d’entre elles concernait le schéma économique qui nous permettrait d’atteindre un point d’équilibre financier. Au moment de sortir le premier numéro, nous avions 150 souscripteurs/abonnés, ce qui représentait un manque à gagner hebdomadaire de 1 000 euros. Cela rendait le projet très fragile, puisque nous étions forcés de trouver d’autres sources de financement – nous organisions alors des concerts pour récolter un peu d’argent pour le journal.
Avec le temps, le nombre d’abonnés a augmenté. À la fin de la première année, ils étaient 500 – un chiffre qui ne permettait pas de payer les frais et coûts du journal (impression et local de travail). Et encore moins de rémunérer, comme nous avions prévu de le faire, les tâches les plus techniques : le boulot administratif, la gestion des abonnements, la publicité, la mise en page, la correction, et la coordination des photographes. Ces tâches sont les plus ingrates ; elles ne peuvent éternellement rester bénévoles dans un journal ambitionnant de devenir pérenne. Pour parvenir à créer cette structure de base de 8 ou 9 personnes payées à mi-temps, nous avions besoin d’atteindre les 1 500 abonnés, ce qui nous a pris cinq ans.
À partir de 2011, le projet a évolué. Il nous a semblé important que le journal s’adapte aux nouveaux modes de lecture : nous avons lancé notre site, et créé des comptes Twitter et Facebook. Nous avons également redécoupé la version papier en grandes sections (enquêtes, reportages, analyses, opinions et entretiens), pour bien marquer la différence avec le web. Car c’est cette année-là que nous avons commencé à séparer les contenus entre le papier et le web, ainsi que les équipes dédiées aux deux supports. Chaque section du papier est désormais coordonnée par au moins une personne, et deux personnes coordonnent les contenus web. »
Concrètement, comment s’organise le journal et les prises de décision ?
« Nous faisons des réunions décisionnelles toutes les semaines, tous les mois, et tous les trimestres. Les réunions hebdomadaires correspondent à des conférences de rédaction – on y décide des contenus web et papier du numéro suivant, voire de ceux d’après. Quant à l’assemblée mensuelle, elle permet de traiter d’autres questions que celles concernant le contenu : les débats publics que nous organisons, les collaborations avec d’autres collectifs (par exemple dans le cadre de la réalisation d’un documentaire), les suppléments ou numéros spéciaux, voire la gestion des abonnements. Souvent, ce sont les coordinateurs qui font part d’un problème spécifique, lequel est ensuite résolu collectivement. Mais on aborde aussi lors de ces réunions mensuelles des questions plus personnelles ou affectives : est-ce que telle personne se sent bien avec son travail, est-ce qu’elle se sent reconnue pour ce qu’elle fait, est-ce qu’il y a des embrouilles entre nous, etc.
Nous ne lançons pas d’invitation publique pour ces assemblées mensuelles, mais elles sont ouvertes à qui souhaite y participer – ce n’est pas le cas des réunions hebdomadaire. Rencontrer de nouvelles personnes prend du temps et demande de l’attention, deux choses dont nous manquons quand nous nous trouvons dans le speed des parutions hebdomadaires. Si quelqu’un veut filer un coup de main ou s’engager dans La Directa, on préfère qu’une personne de l’équipe prenne d’abord un peu de temps pour lui expliquer notre fonctionnement et nos protocoles, et ensuite, elle peut venir à la prochaine assemblée.
Enfin, les assemblées trimestrielles servent à discuter de la ligne éditoriale, des aspects plus généraux du projet, des objectifs à moyen terme, et des stratégies à venir. Par exemple, c’est l’assemblée trimestrielle qui pourrait décider de renforcer notre présence sur le web. »
Un désir commun a-t-il mené à la création de La Directa ?
« Au tout début, nous étions une vingtaine de personnes, puis la participation a baissé et nous nous sommes retrouvés à dix. C’est seulement quand le projet a commencé à réellement se matérialiser que le nombre des participants est remonté. Au total, il nous a fallu un an pour débattre de ce que nous voulions faire avant de lancer réellement le journal. Si nous partagions une même envie de créer un média de communication différent, nous étions quelques-uns à nous sentir littéralement obsédés par les effets des mass media. Nous étions exaspérés par le goût de la manipulation et par la servilité des grands groupes de presse. Dès le départ, nous nous sommes donc placés dans un rapport de confrontation avec le journalisme classique. Nous voulions livrer notre vision des choses, et ainsi montrer à quel point celle des grands médias était manipulée, distordue, au service d’intérêts très éloignés de ceux de la rue. De cette frustration est né le désir de reprendre en main le récit des événements et de l’actualité.
Dès le départ, nous avions décidé qu’il n’était pas question de devenir le porte-voix d’un groupe déterminé, d’une organisation ou d’un mouvement. Au contraire, nous voulions rendre compte de la richesse de la contestation et des mouvements sociaux, bref de la réalité. D’autant que nous étions issus de mondes différents : de l’université, des mouvements, du journalisme classique, etc. Mais nous partagions toutefois un même souci de la méthode, avec le recoupement des sources, l’enquête, le reportage. »
Votre travail de journalistes s’inscrit-il dans le contexte politique local et national ?
L’Espagne (et particulièrement la Catalogne) a connu une évolution des idéologies. Avec une profonde mutation, ces dernières années, de la façon de faire de la politique : le déclin des idéologies fermées, celles des manuels, des livres staliniens, s’est accompagné de l’émergence d’idéologies beaucoup plus liquides, c’est-à-dire en mesure de s’adapter aux réalités, au jour le jour. Ce qui est écrit dans les manuels ne fonctionne qu’à l’intérieur de ces derniers, sans jamais servir aux réalités que nous vivons. À l’inverse, je crois que les luttes et les mouvements sociaux, ces dernières années, se sont davantage fondés sur la pratique que sur la théorie. Avec par exemple le mouvement d’occupation des logements (Okupa), la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), les luttes autour des questions psy, etc. Ces mouvements matérialisent des formes de compréhension de la société, mais surtout, ils s’appuient sur la pratique et sur les rencontres (dans la rue, les centres sociaux ou les assemblées), construisant ainsi du lien social. Au final, on s’est rendus compte que les mouvements plus théoriques facilitaient beaucoup moins la communication entre les gens. Des journaux tels que La Directa ou Diagonal2 à Madrid sont issus de ce type de mouvements concrets et inscrits dans la pratique. Nous avons une expérience des actions collectives, ce qui donne une âme particulière à nos médias. »
Parvenez-vous toujours à rémunérer les personnes qui fabriquent le journal ? Ne craignez-vous pas que la question de l’argent professionnalise vos pratiques, au risque de perdre de vue l’engagement anticapitaliste ?
« Aujourd’hui, il y a neuf salaires à mi-temps, même si les gens concernés ne comptent pas leurs heures... Et dans tous les cas, la question de la rémunération reste ouverte, et le débat est permanent. Il a commencé aux débuts du journal et se poursuit encore aujourd’hui, en s’adaptant à nos besoins concrets. La question n’est pas vraiment articulée autour d’antinomies (professionnalisme/amateurisme, indépendance/financements), mais plutôt autour de nos objectifs. Par exemple, si nous voulons faire tant de pages avec tant d’articles, nous nous posons ensuite la question de savoir comment ces objectifs peuvent être remplis, avec quelle part de travail bénévole et quelle part de travail rémunéré.
Mais globalement, nous nous sommes rendus compte qu’il y avait une partie du boulot qu’il était impossible de réaliser de manière bénévole, parce qu’il demande une implication très intense, avec un potentiel d’épuisement extrêmement fort – au bout d’un an ou deux, les gens auraient pété les plombs. D’autant que certains ont des enfants ou terminent leurs études, que d’autres s’investissent dans des mouvements d’occupation de logement... Bref, si nous ne pouvons garantir à nos camarades une vie digne alors qu’ils mènent un travail indispensable pour le collectif, ce dernier ne peut pas aller bien loin.
Il nous paraît très contradictoire de défendre un modèle de société digne, sans exploitation, tout en construisant dans le même temps une forme d’organisation du travail qui exploite, parfois autant que dans les entreprises qu’on critique ! À l’inverse, il n’est pas possible de rémunérer tout le monde, et il n’est pas non plus souhaitable que La Directa devienne une entreprise comme les autres. Du coup, nous avons opté pour un modèle mixte : il s’agit d’évaluer rationnellement la part des tâches indispensables, qu’il faut rémunérer, et de celles qui peuvent se réaliser bénévolement.
Le travail de rédaction et de photographie fait appel à un réseau très large de collaborateurs, ce qui nous permet un large choix d’articles. Mais il est très difficile, voire impossible, d’appliquer ce modèle à des tâches plus techniques comme la maquette ou la gestion des abonnements, où tout repose en général sur une ou deux personnes, lesquelles ont une vision de l’ensemble qui se partage très difficilement. De plus, certaines tâches indispensables, et notamment les plus administratives, sont celles qui sont le moins reconnues socialement ; au contraire de la rédaction d’un article ou d’une série de photos, qui permettent à tout le moins une rémunération symbolique. Nous l’avons constaté : généralement, les personnes qui écrivent bénévolement dans un journal ne partent pas pour des questions de thunes, tandis que celles qui se fadent les corvées administratives finissent toujours par aller travailler ailleurs si elles ne sont pas payées. La question n’est pas celle de l’argent en soi, mais de la possibilité de conserver une vie digne tout en s’inscrivant dans une forme de lutte. Sinon, l’extrême précarité qui nous menace nous affaiblit chaque année davantage.
De fait, La Directa fonctionne très bien avec ce modèle mixte. Le fait de rémunérer certaines personnes n’a pas été vécu comme une manière de marchandiser le projet. Et ce dernier reste perçu comme un soutien à la lutte, un outil pour les mouvements sociaux, une manière différente de faire du journalisme, une attaque contre le pouvoir. »
Où et comment êtes-vous diffusés ?
« Notre tirage est seulement de 2 500 exemplaires, mais il est important de préciser que chaque exemplaire trouve son acheteur. Nous avons 1 900 abonnés, et 400 exemplaires supplémentaires sont distribués dans 80 points de dépôt pour lesquels nous nous chargeons de la livraison et des retours. Il s’agit d’athénées3, de maisons occupées, de librairies ou d’infokiosques. La distribution se fait dans toute la Catalogne (la moitié à Barcelone), mais aussi à Perpignan et Valence. Enfin, nous gardons 200 exemplaires pour des ventes directes lors de débats publics, d’assemblées, de soirées spéciales, etc. »
Pourquoi avoir choisi une mise en page conventionnelle, proche de la presse classique ?
« C’est le fruit d’une décision collective visant à ne pas compliquer la lecture. Avec cette forme, les gens qui sont habitués à lire la presse classique ne sont pas perdus quand ils nous lisent. Les codes restent les mêmes avec une disposition en titres, sous-titres, photos d’ouverture, etc. Toucher un large public nous a semblé plus important que de proposer une forme trop avant-gardiste qui rebuterait des lecteurs non avisés. »
Comment avez-vous intégré Internet, les réseaux sociaux et les applications sur smartphones à votre pratique du journalisme ?
« L’Espagne est le pays d’Europe qui compte le plus de possesseurs de smartphones. Nous pensons qu’il faut en prendre acte et que la lutte doit se mener par tous les moyens nécessaires, par tous ceux qui sont à notre disposition, depuis la lutte armée jusqu’à l’utilisation d’Internet. Si on se veut un peu pragmatique, on constate qu’il y a une part importante de la population qui se montre active sur les réseaux sociaux et alimente Facebook ou Twitter. Il nous semble donc judicieux d’être présent dans cette réalité sociale aussi. On essaie de l’utiliser comme une arme plutôt que de l’ignorer.
Les réseaux sociaux occupent une place très importante dans le journalisme d’aujourd’hui. Quant à l’instantanéité de la diffusion d’informations sur un service comme Twitter, elle se révèle assez utile si l’on veut, par exemple, échapper à un barrage policier lors d’une manifestation. Il s’agit en fait de l’héritage le plus réussi des médias libres type Indymedia des années 2000. Ils permettaient de coordonner des actions directes qui engageaient des milliers de personnes lors des mouvements sociaux. Twitter permet aussi cela, mais en élargissant l’audience à des gens qui ne sont pas militants et qui, lors d’une manifestation par exemple, auront plus volontiers le réflexe d’utiliser ce type de réseaux sociaux qu’Indymedia, connoté très ’’radical’’.
Il est certain qu’Internet rajoute une couche au contrôle social. Mais il permet aussi de s’organiser pour surprendre le pouvoir lors des mobilisations, et d’éviter ainsi sa brutalité. Au final, cela peut s’avérer très utile. Ici, à Barcelone, avec le mouvement du 15-M4, nombre de résistances aux expulsions et de soutiens se sont organisées grâce à Twitter. Il me semble même que cela aurait été impossible sans. Certes, en 1936, on s’en passait, mais il existait d’autres mécanismes de mobilisation : les usines, les coopératives ouvrières, les athénées, qui voyaient des centaines de personnes concentrées en un même lieu et en mesure de communiquer d’un endroit proche à l’autre. Aujourd’hui, la plupart des gens restent enfermés chez eux ou dans des bureaux cloisonnés d’entreprise. Dans cette situation, les réseaux sociaux constituent de parfaits mécanismes de mobilisation pour toucher des milliers de personnes en un court laps de temps.
L’utilisation de ces moyens de télécommunication n’exclut aucunement la création en actes d’espaces de sociabilisation fondés sur le modèle des athénées ou de ce qu’a fait auparavant vivre le mouvement ouvrier. Au contraire : on constate qu’apparaît aujourd’hui une nouvelle génération d’athénées, de maisons occupées, de centres sociaux. À travers eux s’opère une véritable redécouverte de la communication entre les habitants d’un même quartier. Et cela advient alors même qu’on utilise Twitter lors des manifestations ou pour communiquer une information. En réalité, ces deux processus n’ont rien d’exclusif. Et dans tous les cas,nous considérons qu’à partir du moment où ces réseaux sociaux existent, et qu’une majorité de personnes les utilisent, c’est à nous de savoir comment nous les réapproprier.
Je crois qu’on peut même dire que ces réseaux ont fini par créer des réalités dans les quartiers. À l’occasion de certaines explosions de mobilisations dans la rue, appuyées par les réseaux sociaux, on a vu des générations de gens qui ne se connaissaient pas se rencontrer : des anciens antifranquistes, des gens investis dans les cultures alternatives pendant la Transition, des activistes des centres sociaux, etc... Bref, des jeunes d’aujourd’hui et des anciens se sont rencontrés. Et ces rencontres ont perduré, notamment grâce à l’émulation permise par Twitter au moment du 15-M. Beaucoup ont noué contact sur les places - c’est là que sont nés de nombreux projets, dont ceux qui ont abouti à la construction de locaux et de centres sociaux à Barcelone. On peut prendre l’exemple de l’Athénée La Flor del maig, dans le quartier de Ploblenou5 : les gens qui ont initié ce lieu, en lien étroit avec le voisinage, se sont au départ organisés sur Twitter. Aujourd’hui, ils en ont fait un lieu tangible avec une mutuelle d’achats, un centre d’accueil social, des assemblées avec des migrants, des réunions féministes, un groupe qui travaille sur la mémoire des luttes, etc. Ils ont converti l’organisation qu’ils avaient entamée sur les réseaux sociaux en un centre social de quartier.
Aucune technologie n’est le patrimoine exclusif du capitalisme, pas même Internet. En Catalogne, par exemple, il existe un réseau social qui fonctionne sur le modèle des assemblées, sans hiérarchie ni rapports marchands. Il se nomme guifi.net, et est utilisé par 40 000 personnes qui partagent des ressources sur le web, à l’écart du réseau Internet classique. Il s’agit en fait d’une sorte d’intranet ne dépendant d’aucune multinationale, très utile pour les luttes et les militants d’ici. »
Le fait de fabriquer un média en langue catalane s’inscrit-il dans une lutte revendiquée de la part du journal pour l’indépendance de la région vis-à-vis de l’État espagnol ?
« En tant que média, nous défendons les droits des opprimés et leurs libertés, et nous soutenons bien sûr les revendications ayant trait à l’émancipation des peuples vis-à-vis des États ou des entreprises. Dans cette optique, nous nous plaçons aux côtés de ceux qui luttent pour que vive la langue catalane et pour que la Catalogne obtienne son indépendance. Cela ne relève pas d’une question identitaire, mais plutôt d’un désir de liberté. Ce n’est pas toujours facile à faire comprendre, par exemple quand nous discutons avec des militants français ou allemands : ils se demandent comment on peut se revendiquer de la gauche radicale, autonome ou libertaire, et défendre en même temps le processus d’indépendance de la Catalogne. Je pense qu’il s’agit d’un processus fort complexe : il existe des indépendantistes d’extrême-droite, portant une défense des identités très classiste et raciste, tout autant que des indépendantistes se revendiquant de l’extrême-gauche radicale, anticapitaliste et anarchiste.
De fait, publier un journal en catalan constitue un acte politique en soi, même si cela ne nous coûte pas grand-chose. Ce qui est certain, c’est qu’on ne s’est pas posé la question de le publier dans une autre langue, pas plus que l’on ne s’est posé celle de parler ou non catalan. C’est juste la base de notre culture, celle dans laquelle on a grandi. Il n’y aurait pas plus de raison pour nous de faire un journal en espagnol qu’en français ou en anglais. Le catalan n’est pas un folklore ici, mais quelque chose de naturel avec lequel nous sommes habitués à vivre au quotidien depuis la naissance.
La Directa ne publie pas de tribunes ni de papiers éditoriaux, qu’ils correspondent à un point de vue partagé par l’équipe de rédaction ou à celui d’un quelconque éditorialiste. Nous publions simplement les sujets qui nous semblent le mieux embrasser les points de vue et les luttes en cours autour de nous. C’est pourquoi on n’écrira jamais ’’Nous sommes indépendantistes’’, pas plus que ’’Nous sommes communistes, ou anarchistes, ou ceci cela’’. Nous essayons plutôt de faire en sorte que les mouvements qui luttent pour différentes causes soient entendus, et cela grâce à l’effort de sélection de nos assemblées. Le travail éditorial se joue à cet endroit précis, et à cet endroit seulement : la sélection des contenus à publier ou non. Notre ligne éditoriale se lit donc dans l’ensemble dans nos choix et de nos refus de publication. »
(Propos recueillis en décembre 2014)
1 Merci à Oriol et Arnau pour leur aide à la traduction.
2 Voir l’entretien avec Alvar, du journal Diagonal, « cousin » de La Directa à Madrid : « On garde le même ennemi, mais on l’attaque autrement », article mis en ligne le 20 janvier 2012.
3 Les athénées sont des lieux collectifs issus de la tradition du mouvement ouvrier du XIXe siècle où s’organisent conférences, assemblées, groupes de lecture, etc. Avec une optique libertaire, ils ont été particulièrement importants pour les Républicains de la guerre civile dans les années 1930.
4 Voir« Madrid : les racines du 15-M », article publié dans le numéro 7 de la version papier (décembre 2011) et mis en ligne le 9 mai 2012.