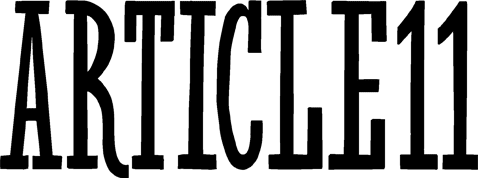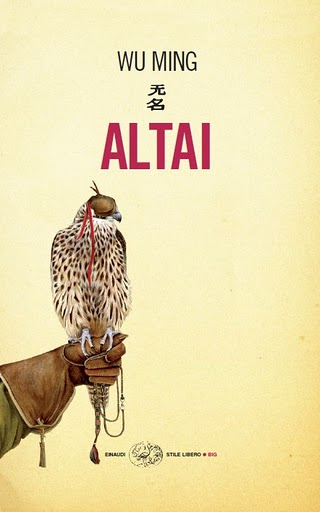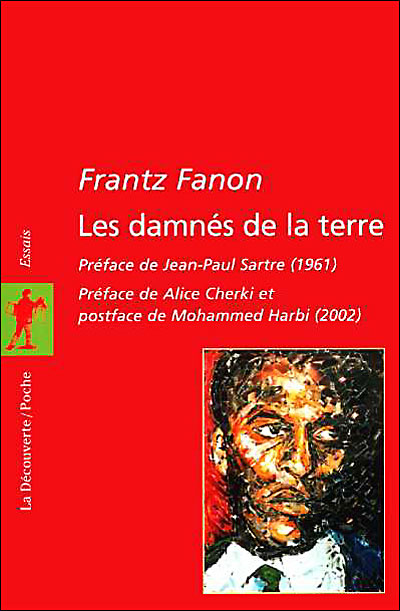lundi 10 décembre 2012
Inactualités
posté à 16h21, par
9 commentaires
En Italie (comme en France), le legs colonial et la persistance d’un fort racisme restent sous-estimés, voire totalement niés. Alors qu’un monument à la gloire d’un boucher colonial - Rodolfo Graziani - vient d’être érigé dans la province de Rome, deux intellectuels italiens, Wu Ming 2 et Giuliano Santoro, débattaient récemment de la situation.
On trouvera ci-dessous, traduit par mes soins, un échange entre Wu Ming 2, membre du collectif d’écrivains bolognais Wu Ming, déjà présenté sur ce site1 et Giuliano Santoro, intellectuel italien. Leur dialogue tourne autour de deux sujets : l’érection récente dans la province de Rome d’un monument à la gloire d’un boucher colonial fasciste et le livre que Wu Ming 2 a co-écrit avec Antar Mohamed, histoire vraie dont les personnages sont Isabella, née en 1925 d’un soldat italien et d’une Somalienne, son frère, partisan noir qui a combattu en Italie, tué par les nazis quelques jours après la fin de la guerre2, et le fils d’Isabella, en butte comme elle aux persécutions de l’administration italienne d’aujourd’hui. Les thèmes abordés, outre qu’ils éclairent sur l’Italie contemporaine, ne devraient pas manquer d’évoquer pour les lecteurs attentifs des problématiques bien françaises.
S.Q.
Un dialogue entre Wu Ming 2 et Giuliano Santoro
G.S. : Et c’est ainsi qu’au beau milieu de l’automne de la crise et des sacrifices « techniques » se matérialisa dans le débat public le monument à Rodolfo Graziani, gouverneur de la Cyrénaïque et criminel de guerre de l’époque fasciste. Graziani fut gouverneur durant la domination fasciste de la Libye, commandant au cours de l’invasion de l’Éthiopie, vice-roi d’Éthiopie en 1936-37 et commandant des forces armées de la République de Salò, l’État fantoche mussolinien qui, de facto, représenta un protectorat nazi, de 1943 à 1945. Le monument à ce boucher du colonialisme et du nazifascisme a été inauguré le 11 août dernier à Affile, petit village de la province de Rome, au bord de la région de Frosinone. Le mémorial n’a pas, au début, provoqué de scandale puis, grâce entre au cri d’alarme lancé en septembre sur le site Giap3, il a conquis l’attention des journaux et est devenu symbole du manque de mémoire de notre pays. Néanmoins, le monument au criminel de guerre Rodolfo Graziani est encore là. C’est une occasion à saisir pour comprendre comment les scories des post-fascistes au gouvernement et l’héritage toxique de la période berlusconienne ont influencé notre rapport avec l’histoire.
Dans un article publié dans la revue internationale d’études post-coloniales Interventions en 2007, Miguel Mellino se demandait comment il était possible qu’en Italie – pays doté d’un passé colonial et traversé de flux migratoires – les études postcoloniales et le débat critique sur ces thématiques n’aient pas trouvé de terrain fertile. Une des conclusions de Mellino était que cette lacune pouvait seulement être comblée (plus encore : commençait déjà à être comblée) dans les « zones frontières » entre recherche académique et luttes sociales. J’ai discuté de cela avec Wu Ming 2, un des membres du collectif Wu Ming. Mon interlocuteur a écrit avec Antar Mohamed Timira4 – roman métis qui raconte l’histoire d’Isabella Marincola, femme ayant vécu dans une perspective « in-between » la période qui va du colonialisme fasciste à nos jours. Le thème du colonialisme et du rapport avec les histoires incompatibles qui agitent l’inconscient collectif, et qui sont en mesure de nous montrer des côtés obscurs et des « perspectives obliques », ce thème traverse toute la production littéraire des Wu Ming. Pour s’en tenir à deux textes récents, Manituana est situé au milieu de la « révolution » américaine contre le colonialisme britannique et Altaï nous raconte la bataille de Lépante (vrai mythe fondateur du concept d’Occident) du point de vue des infidèles. Encore : entre février et mars de l’année prochaine sortira Point Lenana. Ce roman aussi, signé par Wu Ming 1 et Roberto Santachiara, affronte le thème des relations entre l’Italie et l’Afrique, du point de vue insolite des événements liés à l’escalade du Mont Kenya par trois italiens dans les années de la Deuxième Guerre mondiale.

- Le monument d’Affile
Donc j’arrache Wu Ming 2 à l’écriture de L’Armée des somnambules (tel est le titre du prochain roman du collectif, qui sera situé dans les années de la « terreur » ayant suivi immédiatement la Révolution française) et je lui demande, pour commencer : le monument d’Affile représente vraiment l’impossibilité pour l’Italie de se confronter à son passé colonial ?
W.M.2 : Je dirais plus généralement que le monument d’Affile est un monument à l’incapacité italienne à s’affronter à son histoire. Au moment où on discutait de cette Vespasienne Sanglante5, beaucoup de journaux ont publié en première page la nouvelle que le Tribunal de Stuttgart avait relaxé les huit inculpés pour le massacre de Stazzema6. De tous les articles, outre la juste indignation pour la sentence, émanait un sentiment critique envers la nation allemande entière, pas encore assez résolue dans la reconnaissance de l’immensité des crimes nazis. Et pourtant, il n’y a rien de particulièrement « allemand » dans le tribunal d’un État qui utilise le code pour défendre ses propres forces de l’ordre. C’est un film vu et revu, qui ne connaît pas de frontières. Au contraire, il y a beaucoup de la spécificité italienne dans la dégradation de l’histoire en simple nostalgie, terrain de chasse, vénération de façade, petit jeu électoral. Pensez à ce qui se serait passé si une commune du Bade-Wurtemberg avait érigé un monument à l’un des accusés du procès de Stazzema. Vous voyez ? Voilà, tel est le sentiment qu’éprouvent les Éthiopiens et les Libyens à l’idée qu’en Italie, il y a un monument à la mémoire de Graziani. Mais ce sont des nègres et des bédouins, qu’est-ce que vous vouez que ça nous fasse ? Ce mémorial est donc aussi un monument au racisme des Italiens. Sans oublier que ces mêmes Italiens devraient éprouver un semblable sentiment de répulsion, puisque Graziani, juste pour donner un exemple, fut aussi signataire d’un décret de février 1944 qui prévoyait que ceux qui ne se présentaient pas pour être enrôlés dans l’armée seraient fusillés.
Graziani était colonialiste et fasciste. J’ai noté qu’on tend souvent à distinguer entre les crimes du nazifascisme et ceux du colonialisme, peut-être parce que ces derniers ont été commis aussi avant même le fascisme, comme vous l’avez rappelé à l’occasion d’une de vos conférences sur l’anniversaire de l’unité de l’Italie. Et pourtant, il y a une relation historique entre les deux phénomènes. Fans son Discours sur le colonialisme, l’intellectuel et poète martiniquais Aimé Césaire écrivait : « Oui, il vaudrait la peine d’étudier, cliniquement, dans le détail, les démarches d’Hitler et de l’hitlérisme et de révéler au très distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du XXe siècle qu’il porte en lui un Hitler qui s’ignore. » Césaire rappelait aussi que le nazisme avait « appliqué à l’Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu’ici que les Arabes d’Algérie, les coolies de l’Inde et les nègres d’Afrique ». En effet, la persécution des juifs en Europe ne sort pas du néant. Au contraire, elle a pu prendre pour modèle la « socialisation à l’indifférence » qui avait été déjà expérimentée avec les colonisés ; tout comme les camps et les pratiques d’ « anéantissement administratif » l’ont été dans les colonies. Tout en distinguant entre eux des phénomènes historiques comme la Shoah et les massacres coloniaux, nous sommes contraints de prendre acte du fait que l’Holocauste est aujourd’hui – heureusement – reconnu comme « mal absolu » parce que les survivants en ont transmis la mémoire, non sans rencontrer quelques obstacles au début. Mais il n’en est encore rien en ce qui concerne le colonialisme. Quelles cordes de l’inconscient collectif touche cette histoire refoulée et comment se fait-il qu’elle ne soit pas devenue objet de débat public ?
Je suis extrêmement d’accord avec le discours de Césaire, d’autant que dans Timira, j’ai essayé de mettre à nu le « petit colonialiste » que je me suis retrouvé dans le cerveau, alors même que je me croyais immunisé contre une telle culture. Néanmoins, je retiens qu’en Italie il est important de distinguer entre les crimes colonialistes de l’époque libérale et ceux des fascistes : on démontre ainsi que ce fut le fascisme (et le racisme) qui se greffa sur le colonialisme, et pas le contraire, que le deuxième fut un élément constitutif du premier (le Parti nationaliste, grand défenseur de l’entreprise coloniale, se fondit dans le Parti fasciste en 1923). La rhétorique impériale fasciste a fini par faire coïncider, dans l’imaginaire collectif, l’époque des colonies avec la dictature, et c’est là un premier motif de refoulement : si nous attribuons au fascisme la férocité coloniale et les délires sur la race, alors nous en faisons le bouc émissaire de ces horreurs. Et une fois le bouc immolé, nous pouvons croire avoir nettoyé l’histoire de la patrie et notre ADN de cette saleté.
Cela dit, je crois que le colonialisme et le fascisme – quoique distincts – doivent être mis en étroite relation, et qu’on ne peut comprendre pleinement le deuxième si on n’étudie pas en profondeur le premier. Il en va de même pour la lutte de Libération : je pense que notre Résistance a été en grande partie une guérilla anticoloniale, enracinée sur le territoire, dirigée contre une armée d’invasion et contre un régime qui avait colonisé les consciences. Wu Ming 1 travaille beaucoup sur ce parallélisme dans les pages de son prochain livre, Point Lenana. Beaucoup d’Italiens prirent les armes et devinrent antifascistes justement quand ils se sont retrouvés à vivre dans une colonie du IIIe Reich. Cette condition coloniale créa une espèce de court-circuit, un insight soudain et contradictoire. Dans les mémoires de ces soldats italiens qui, après le 8 septembre 1943, désertèrent du front grec et yougoslave, nous trouvons souvent la participation à des épisodes de résistance, mais il n’y a jamais le souvenir de ce qui se passa avant le 8 septembre, quand les mêmes soldats faisaient partie d’un armée d’invasion qui commettait des abus, des massacres et des fusillades. La conscience anticolonialiste de ces soldats, une fois réveillée, a effacé le souvenir de ce qu’eux-mêmes avaient commis en colonialistes. Je crois qu’en partie, le refoulement de notre expérience coloniale de l’inconscient collectif est aussi en rapport avec cela : les deux mythes fondateurs de notre nation, à savoir le Risorgimento et la Résistance, sont des mythes anticolonialistes. Donc, qu’est-ce qu’on est allés faire en Afrique, sinon des ponts, des hôpitaux, des routes ?
En second lieu, comme le démontre bien le fameux discours de Pascoli en faveur de l’invasion de la Libye (1911), une bonne partie de notre rhétorique expansionniste naît du victimisme : les Italiens sont alors partout objets de dérision, traités comme des merdes, considérés comme des gens sales et bagarreurs. Le moment semblait venu de faire voir au monde ce que nous valions, de ne plus être seulement victimes, mais civilisateurs, maîtres à la maison et dans une maison plus grande. Mais alors, ce colonialisme « de victimes » n’a pu être que bon, compréhensif, au pire un peu minable. Certainement pas féroce.
Enfin, comme nous avons perdu les colonies avec la Deuxième Guerre mondiale, nous n’avons rien connu de comparable à la guerre d’Algérie ou à la révolte des Mau-Mau. En fait, dans l’après-guerre, De Gasperi s’employa à obtenir quelques ex-colonies en Administration fiduciaire des Nations Unies. Il utilisa le crédit de l’antifascisme et de la Résistance pour souligner que l’Italie n’était pas comme l’Allemagne ou le Japon, qu’on ne pouvait pas l’humilier en lui retirant ses colonies. Il lui fallait une petite satisfaction, et vu qu’entretemps nous avions retiré la chemise noire et avions appris la démocratie, il s’offrit de l’apprendre aux sauvages qui ne la connaissaient pas encore et obtint qu’on nous confie pour une décennie l’ex-Somalie italienne, pour la diriger vers l’indépendance. L’Administration fiduciaire italienne en Somalie fut une espèce de colonie temporaire, avec échéance en 1960. Mais c’était une colonie, tout comme les « opérations de police internationale » sont des guerres et les bombes intelligentes des engins de mort. Les Somaliens, en fait, ne se laissèrent pas abuser et réinterprétèrent aussitôt le nouvel acronyme (AFIS – Administrazione fiduciaria della Somalia, « Administration fiduciaire de la Somalie ») en Ancora Fascisti Italiani in Somalia (« Fascistes italiens encore en Somalie »). Bureaucrates et fonctionnaires, en effet, étaient les mêmes qu’avant la guerre, et même les lois racistes ne furent pas changées. Mais cela nous permit de penser que tandis que les autres pays européens devaient combattre contre les guérillas de libération, nous, en revanche, étions en accord avec nos ex-colonisés, au point que nous pûmes carrément fêter avec eux, à Rome, cette indépendance qui leur avait coûté tant de sueurs. Et ce fut là un autre couvercle de plomb posé sur les crimes de notre colonialisme.
Réfléchissant à propos de la mémoire du passé colonial en Italie, Paolo Jedlowski et Renate Siebert rappellent qu’on n’entend pas seulement les représentations explicites quand on parle de « mémoire », mais que s’expriment aussi des « comportements, attitudes, pratiques, images et notions diffusées et considérées comme évidentes, qui proviennent du passé et se prolongent dans le cours du temps ». « En fin de compte, soutiennent les deux sociologues, la forme sous laquelle a survécu cette mémoire est le racisme même. » En d’autres mots, un trauma, comme dans le cas de la violence coloniale, que la mémoire publique ne ré-élabore pas, resurgit sous forme latente dans la vie quotidienne, sous forme d’abus de pouvoir, de racisme et, ajouterais-je, de domestication de la force de travail migrante. De quelle manière la narration d’histoire, le « déterrement de haches de guerre », pour utiliser une de vos métaphores, peut-il contribuer à faire émerger ce « trauma culturel » ?
Je suis convaincu que la narration est une méthode de recherche de la vérité. Le type de vérité qu’on peut trouver n’est évidemment pas le même que celui que visent la méthode historique et la méthode scientifique. La vérité narrative consiste surtout à sélectionner les événements, à les mettre ensemble et à en faire sortir significations et contradictions.
Je suis donc persuadé que romans et objets narratifs peuvent contribuer à nous montrer le sens du colonialisme : un sens, une direction qui pointe droit sur notre présent. Parce que raconter le colonialisme signifie justement tracer une généalogie du racisme italien qui arrive jusqu’à nos jours. Et cela signifie traquer le petit colonialiste qui réside – souvent sans être combattu – dans nos cerveaux.
Tout cela n’est en rien plaisant. Seule une portion très réduite de la population italienne réussit aujourd’hui à admettre – et en ce cas revendique – d’être raciste. Beaucoup, beaucoup plus font des discours racistes déguisés derrière des déclarations d’intention égalitaires. Et c’est là un autre des motifs qui ont conduit au refoulement de l’imaginaire de notre colonialisme : presque personne n’aime se sentir raciste, tandis que parler du colonialisme de manière un tantinet approfondie revient à reconnaître que nous avons été, et que nous sommes toujours, un peuple raciste, sûrement pas « brava gente » (des braves gens). Il s’agit ni plus ni moins que d’une séance psychanalytique susceptible de mettre à nu de vastes zones d’inconscient. Voilà pourquoi je ne suis pas sûr que tout le monde veuille la faire, et je pense donc que la narration postcoloniale, si nécessaire soit-elle, n’a pas un résultat certain. L’effet pourrait être même celui d’un refus supplémentaire ; mais au moins, ce serait un refus dicté par un minimum de conscience.
Il y a quelques mois, alors que Timira, le roman que tu as écrit avec Antar Mohamed venait de sortir, tu m’as raconté la difficulté du monde culturel italien à se confronter avec le refoulement colonial. En effet, si on excepte Ennio Flaiano avec Tempo di uccidere (où il raconte le meurtre d’une abyssine par un soldat italien et le complexe de culpabilité qui l’accable, dans une espèce de « ligne d’ombre » conradienne à l’envers où le rite de passage est constitué par l’abus de pouvoir) et les cas récents de Carlo Lucarelli7 et d’Enrico Brizzi8, il y a peu de romans qui se sont occupés du colonialisme italique. Comment se peut-il que le monde littéraire, y compris celui « de gauche » dans un sens large, n’ait jamais affronté ce thème ?
Il faut d’abord souligner que le monde littéraire n’est jamais « meilleur » que la société dans son ensemble. En outre, de vastes portions de la société italiennes ne sont devenues « post-coloniales » qu’à une époque récente. Après la guerre, le PCI s’opposa durement au projet de l’AFIS mais en soulignant toujours qu’il ne remettait pas « en question le droit de l’Italie à avoir des colonies ». On critiquait une pratique spécifique pas l’hypothèse coloniale dans son ensemble. Mohamed Aden Sheik, grand intellectuel somalien, rappelle que dans les années 1950, il vint étudier en Italie et s’aperçut que personne ne connaissait la Somalie et encore moins l’histoire coloniale. Il décida alors de proposer un cycle de conférences, appuyé par Ignazio Silone. Le résultat fut qu’il écopa d’une série de poursuites pour outrage aux forces armées. Erminia Dell’Oro – écrivaine italienne née en Erythrée, auteure de plusieurs romans sur le colonialisme – me racontait que dans les années 1980, elle proposa à plusieurs éditeurs un livre sur les crimes de Graziani, mais on le lui refusa parce qu’il était trop dur. Aujourd’hui, elle le retravaille pour essayer de le publier. Pour ne pas parler du Leone del Deserto (« Le lion du désert »), le film sur la résistance libyenne aux Italiens, bloqué par la censure pendant près de trente ans.
Outre cela, il y a le fait que Afrique et Littérature forment un binôme dont personne n’a rien à foutre, à moins qu’on ne parle d’enfants (soldats ou affamés) et de mutilations génitales féminines. L’Afrique est un continent énorme sur lequel nous ne connaissons presque que des stéréotypes. Son histoire ne nous intéresse pas, nous ne l’étudions jamais. En conséquence, quand tu dis à un éditeur que tu veux t’occuper de ça, il te regarde d’un air bizarre, s’inquiète, il te demande s’il peut mettre en couverture un beau paysage exotique, au moins, comme ça, ça soutiendra les ventes. Et si tu racontes l’histoire d’une femme italo-somalienne qui a servi de modèle à Guttuso et a été actrice dans Riz amer, qu’elle a eu un frère partisan et qu’elle a vu la guerre à Mogadiscio, les rédactions des journaux féminins répondent qu’elles n’en parleront pas, parce que ce n’est pas le genre d’histoire qui intéresse les lectrices. Et alors, se demande l’écrivain italien, pourquoi j’irais parler de ce truc ?
Pour notre chance, ces dernières années des femmes et des hommes d’origine somalienne, éthiopienne, érythréenne ont commencé à écrire. Et la littérature a essayé de « suivre le courant » avec des écrivaines comme Shirin Ramanzanali Fazel, Igiaba Scego, Gabriella Ghermandi, Carla Macoggi, Kaha Mohamed Aden, Cristina Ali Farah, Ribka Sibhatu, Martha Nasibù et des auteurs comme Garane Garane, Ali Mumin Ahad, Amid Barole Abdu.
Sur Giap, vous avez (re)lancé de manière efficace la « malédiction de Graziani ». Celui-ci, en 1937, a ordonné d’exterminer les conteurs, les devins et les guérisseurs, coupables de répandre le poison et de prêcher contre l’occupation italienne. Ce furent de véritables représailles contre les contre-narrations, qui coûtèrent la vie à des milliers de gens mais provoquèrent la dénommée « malédiction de Graziani ». De ce moment, écrivez-vous, il devint une espèce de « Roi Midas à l’envers », et tout commença à mal tourner pour lui. Ici, nous remarquons, juste en passant, qu’à partir du moment où a été érigé le monument d’Affile, il est arrivé beaucoup de choses au PDL (« Pôle de la liberté », berlusconien) du Latium, à commencer par la chute calamiteuse du Conseil régional Polverini9. Plus de soixante ans plus tard, est-ce que la voix de ces conteurs est arrivées ici chez nous ? La vraie signification de la « malédiction de Graziani » est-elle la contamination du monde des colonisateurs par celui des colonisés ?
Dans les histoires de zombies, c’est souvent le resurgissement d’un passé refoulé – ou d’une violence cachée – qui cause la résurrection des morts-vivants. Ce n’est pas par hasard si à la fin de La nuit des morts vivants de George Romero, apparaissent les informations sur les victimes des bombardements au napalm au Vietnam. Le mémorial d’Affile a ainsi réveillé des hordes de zombies, de conteurs tués et d’hommes déshumanisés par notre colonialisme.
Frantz Fanon, dans Les damnés de la terre, a le premier mis en relation les zombies et les colonisés, et donc la peur de la zombification avec celle d’un contact rapproché et violent avec les immigrés postcoloniaux. Sartre, dans sa préface au livre, avertit les lecteur européens qu’en se plongeant dans ces pages, ce seront eux finalement qui se sentiront zombies, morts qui marchent. « En regardant ce que nous avons fait dans les colonies, vous comprendrez ce que nous avons fait à nous-mêmes. »
En même temps, je crois que le monument à Graziani est aussi une tentative maladroite de tenir en respect les zombies coloniaux. Ces briques ordinaires, l’inscription « Patrie et Honneur » sur le fronton, semblent vouloir dire : S’il pouvait y avoir quelqu’un qui puisse impunément balancer des gaz sur les Africains ! Qu’est-ce que ça nous arrangerait, un type comme ça. À son époque, les zombies étaient des zombies, sans de bizarres mélanges. À son époque, la vue des zombies ne nous effrayait pas et même nous rassurait sur le fait que nous étions des êtres supérieurs, vivants, sains. Aujourd’hui, nous voudrions tant regarder avec la même assurance les immigrés, alors qu’eux-mêmes refusent de s’auto-représenter comme des zombies ; et ils finissent ainsi par nous contaminer, par renverser la perspective et nous faire sentir comme des morts qui marchent.
La pensée postcoloniale nous a habitués à regarder le monde en nous nourrissant de la sensation de dépaysement qu’il provoque : on ne comprend pas les nouveaux esclaves de Rosarno10 ou bien l’archipel du goulag des Centres de détention pour migrants si on ne repère pas les traits du monde postcolonial. En d’autres termes, quelques-unes des caractéristiques du colonialisme se reproduisent en plein Occident tandis qu’en même temps et sans possibilité de synthèse, certaines caractéristiques censées appartenir au monde « développé », apparaissent au beau milieu de ce qu’on appelle le « Tiers Monde », rendant inutiles ou pour le moins inefficaces les concepts mêmes de « développement » et d’ « arriération », de Sud et de Nord. Le virus du colonialisme, sa violence mais aussi la colère des colonisés, en est venue à frapper à la porte de ce que les Clash appelaient les « maisons sûres européennes ». En 2007, dans l’introduction d’un numéro de la revue Africa e Orienti consacré au « retour de la mémoire coloniale », on pouvait lire que « le flux croissant d’immigrés provenant du monde autrefois colonial a rouvert partout en Europe la mémoire de la fracture coloniale ». Comment s’est insérée dans ce contexte une femme comme Isabella-Timira, avec son histoire métisse et son caractère fort et peu enclin aux accommodements ?
Isabella nous répétait qu’elle avait subi dans l’Italie d’aujourd’hui la pire forme de racisme en 80 ans d’existence. Il va de soi qu’une telle « classification » a un sens relatif et qu’elle est certainement influencée par la distance temporelle. Néanmoins, il s’agit d’une affirmation plutôt lourde dans la bouche d’une femme qui a vécue en métisse et en black italian dans la Rome impériale et fasciste des lois raciales.
Si nous voulions donner une étiquette aux divers aspects que le racisme a pris sur la peau d’Isabella, nous pourrions le définir d’abord comme paternaliste, puis sexuel, religieux et enfin identitaire. Le racisme paternaliste est celui précisément lié à l’empire : la petite Isabella était alors une belle abyssine à cajoler et à montrer, comme une guenon domestiquée, comme démonstration vivante de la capacité italienne à civiliser le monde ; une petite négresse qui sait réciter Carducci de mémoire. Le racisme « sexuel » coïncide avec le début de l’âge adulte et le long après-guerre : des hommes élevés dans la mentalité colonialiste voient dans la femme noire une réserve de chasse, une promesse de sexe brûlant et sauvage toujours disponible. Le racisme religieux est en revanche celui qu’Isabella a expérimenté en Somalie, où on l’appelait « gaal », c’est-à-dire infidèle. Enfin, le « pire » racisme, le racisme identitaire, naît dans une Italie apeurée, pleine d’insécurité, qui craint d’être zombifiée et a donc besoin de discipliner les morts vivants non seulement par un contrôle social et policier, mais aussi en érigeant des barrières mentales précises. Dans ce contexte, Isabella sent que son italianité est remise en cause, au nom de l’équation-barrière italien=blanc. Et cela lui apparaît comme une violence pire, dans la mesure où elle est plus imprévisible que toutes les autres.

- Isabella
Isabella est arrivée en Italie à l’âge de deux ans, elle a grandi dans l’école fasciste, sous des tonnes de nationalisme, elle a étudié et aimé la culture italienne, et jamais elle n’aurait imaginé que quelqu’un, peut-être moins bien instruit qu’elle dans cette culture, pourrait mettre en doute sa citoyenneté. Parmi tant d’incertitudes et d’échecs, elle considérait le fait d’être italienne comme l’unique certitude, quelque chose que personne ne pourrait jamais lui retirer. Et pas en raison de ce père italien qui dans la lointaine année 1925, l’avait reconnue comme fille légitime. Son identité était culturelle, la même que pourraient ressentir hommes et femmes arrivés enfants en Italie et que pourtant nous nous obstinons à considérer comme des étrangers. Un truc du moyen-âge : c’est décidément vrai que les zombies, c’est nous.
1 Un entretien avec le collectif Wu Ming, « Si le pouvoir impose son récit, nous devons rétorquer avec mille histoires alternatives », est à lire ICI.
Par ailleurs, j’avais traduit un texte de Wu Ming 1 il y a plus d’un an, « Fétichisme de la marchandise digitale et exploitation cachée : les cas Amazon et Apple ».
2 Il a été tué à un barrage qu’il tenait avec des partisans, par des Allemands qui se repliaient et ne voulaient pas se laisser désarmer.
3 Soit le site des Wu Ming (ndt).
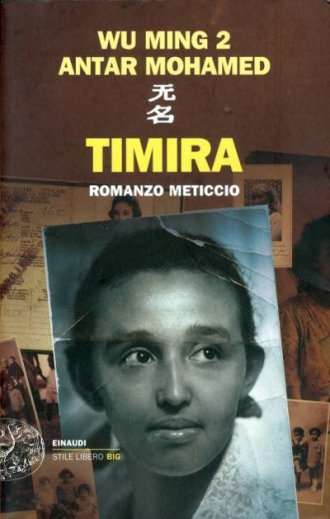
5 Allusion à une série d’affiches apposées sur les sept dernières vespasiennes de Bologne (ville où vivent les Wu Ming) et annonçant sur un ton parodiant les proclamations fascistes le jumelage de ces chiottes avec le monument à Graziani. (ndt)
6 Équivalent d’Oradour-sur-Glane en Italie. Soit le massacre par les SS de 520 habitants (surtout des femmes, des enfants et des vieillards) du village de Sant’Anna di Stazzema (Toscane) le 12 août 1944.
7 Voir son livre La huitième vibration, chez Métailié, qui raconte la colonisation italienne en Érythrée au XIXe siècle.
8 Auteur de La nostra guerra, uchronie sur le fascisme
9 Du nom de la présidente du dit conseil, chute entraînée par le scandale de frais personnels délirants et le gaspillage des deniers publics par les conseillers à leur profit personnel - NdT.
10 Localité de Calabre où, en 2010, une révolte d’ouvriers saisonniers africains, suivie par un véritable pogrom à leur encontre mené par les habitants de la région (manipulés par la ‘ndrangheta), a fait connaître leurs conditions de travail esclavagistes.