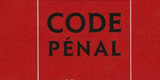jeudi 22 janvier 2009
Sur le terrain
posté à 09h33, par
20 commentaires
Depuis qu’elle ne concerne plus seulement de supposés islamistes, mais aussi des enfants de la classe moyenne, prétendus anarcho-autonomes, « l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » fait beaucoup parler d’elle. Une publicité qui nécessite quelques explications. En m’appuyant sur une conférence du chercheur Laurent Bonneli et du juge Gilles Sainati, je vous propose un retour sur cette singulière figure juridique. Hop !
Il y a Tarnac, neuf jeunes gens interpellés pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ». Ou le cas de cette avocate et de son petit ami qui auraient récemment tenté de mettre le feu à deux véhicules, eux aussi accusés « d’association de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste » parce que, explique benoîtement Le Figaro, « leur supposée sympathie avec la mouvance autonome et les personnes poursuivies pour les sabotages commis le 7 novembre contre les caténaires de la SNCF » le justifiait. Diantre, n’est-ce pas ?
Avant, il y en avait pourtant eu des centaines d’autres, supposés islamistes interpellés et placés en détention pour cette incrimination aussi vague que large, avec des preuves quelquefois inexistante. Ce fut l’opération Chrysanthème : 87 personnes placées d’un coup en garde à vue en 1993, mais trois d’entre elles seulement qui ont fait l’objet d’une instruction officielle. Ou encore, le coup de filet du pseudo réseau Chalabi : 138 personnes interpellées de 1994 à 1998 et 51 d’entre elles qui seront innocentées après une détention longue de trois ans. A chaque fois, cette même incrimination « d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ». Laquelle mérite qu’on revienne dessus, pour essayer de comprendre comment elle fonctionne et de quelle façon elle est instrumentalisée.
La construction d’un pôle antiterroriste
En 1981, François Mitterrand fait abolir la Cour de sûreté de l’Etat, juridiction ayant pour fonction de juger des crimes et délits portant atteinte à la sûreté intérieure et extérieure (dont le terrorisme). Il met ainsi fin à une législation d’exception qui existait depuis 1963. Pas de contrepartie ? Si : Mitterrand fait savoir que tous les faits liés à la violence politique seront désormais impitoyablement punis.
Pourtant, les années 1980 voient une nette reprise de la violence politique. Laquelle offre - logiquement - une belle tribune à tous les acteurs de l’antiterrorisme. Parmi eux, le juge Alain Marceau, qui se fait l’avocat de la centralisation antiterroriste. En 1986, victoire pour ce dernier : une réforme fondamentale centralise le système antiterroriste français, relançant des juridictions d’exception. Sont créés :
× Une justice spéciale : la 14e section antiterroriste, chargée de juger des crimes et délits relevant du terrorisme. Elle compte des membres du parquet et des juges d’instruction spécialisés, qui travaillent en étroite collaboration avec les services de renseignement.
× Une police spéciale : la loi de 1986 créée aussi la Dnat (brigade spéciale antiterroriste au sein de la Police Judiciaire), qui a compétence pour conduire les commission rogatoires ayant à voir avec le terrorisme.
× Un droit dérogatoire : la loi de 1986 prévoit notamment des gardes à vue plus longues (à l’époque de 96 heures, une durée qui peut aujourd’hui augmenter, selon les circonstances, jusqu’à 144 heures) et définit des infractions spécifiques en matière terroriste. Le délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste sera introduit plus tard, par une loi de 1996.
Résultat : le monde antiterroriste français est marqué par une collusion très forte entre police et justice. Un point soulevé par Jean-Marc Rouillan, qui l’évoquait dans un article publié dans CQFD et repris sur le site Action Directe :
« Cela s’est fait discrètement, presque en catimini. Désormais, les juridictions d’exception mises en place avec les lois de septembre 1986 vont suivre les dossiers de bout en bout. La 14e section du parquet dite ’antiterroriste’ mène l’instruction, les cours d’assises spéciales de Paris condamnent et un juge d’application des peines (JAP) spécialisé contrôle les aménagements de peine des condamnés. Comme de bien entendu, les médias n’en ont pas soufflé mot. Dans ce pays, la critique de l’antiterrorisme est taboue. L’expression se veut consensuelle jusqu’au sinistre ridicule. »
Une collusion facilitée aussi par l’idée de la chaîne pénale, théorisée par de pseudos penseurs très marqués à droite et reprise par Nicolas Sarkozy. « Nous sommes une même chaîne pénale », affirmait celui-ci en 2002 en parlant de la police et de la justice. Conception qui voit la justice comme une pièce parmi d’autres, nécessairement solidaire de cette répression qui va de l’arrestation à la prison en passant par l’étape tribunal. Selon le juge Gilles Sainati1 :
"Il est une notion primordiale, celle de la chaîne pénale qui voit comme un continium la police, la justice et la pénitentiaire. Elle a été théorisée par des gens comme Alain Bauer, qui considèrent que la justice doit être partie-prenante de cette chaîne pour être efficace, et mise en application par Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l’intérieur. Cette notion de chaîne pénale repose sur une idée allant totalement à l’encontre du statut d’indépendance du juge, censé prendre ses décisions dans la plus grande neutralité. Il s’agit d’une vision mécaniste de la relation justice-police, avec pour ambition de pratiquer une politique de tolérance zéro, que ce soit contre les jeunes, les arabes, les consommateurs de stupéfiants, etc…
L’idée principale est que les parquets doivent suivre ce que leur disent les policiers. La mise en place du traitement en temps réel des délits n’a fait que faciliter cela : les procureurs donnent désormais leurs consignes par téléphones, n’ont plus sous les yeux le dossier et la procédure. C’est ainsi qu’on assiste de plus en plus à la mise en place d’une justice exécutive, où les procureurs généraux se voient comme des agents du gouvernement et où les procureurs sont convoqués par la Chancellerie quand ils ne font pas les réquisitions qu’on attend d’eux."
Des services qui se tirent la bourre
Créée par la loi de 1986, la Dnat partage les commission rogatoires portant sur le terrorisme avec la DST, en charge du contre-espionnage et de la protection du patrimoine économique et scientifique, ainsi qu’avec les RG, qui s’intéressent à tout ce qui peut troubler l’ordre social et politique du pays. Conséquence : le monde de l’antiterrorisme est aussi celui des luttes technocratiques entre services. « Pour eux, souligne le chercheur Laurent Bonelli, l’antiterrorisme est un marché à exploiter sur lequel ils doivent périodiquement prouver leur utilité au gouvernement. C’est particulièrement évident dans les années 1990 quand, en raison de l’alternance politique, se développent d’importantes contestations à l’existence de ces services. »
Face à ces contestations, ces services vont donc se défendre en faisant valoir leurs compétences et leurs analyses. Dans les années 1990, la DST se lance sur le créneau du terrorisme islamique et les RG se focalisent sur celui des violences urbaines (dans les banlieues) et des affaires politico-financières. Des positionnements qui peuvent évoluer : dans les années 2000, la DST commence à s’intéresser au prétendu danger gauchiste.
En 2007 s’opère la fusion des services de renseignement sous l’étiquette DCRI (Direction centrale du renseignement intérieur). Au sein de celle-ci, c’est la DST qui a emporté le morceau de l’influence, ce qui ne va pas sans soulever de résistances parmi les anciens membres des RG. Bref : un beau panier de crabes, prêt à se tirer dans les pattes à la première occasion.
Or, constate Gilles Sainati, « le parquet et les juges d’instruction du pôle antiterroriste de Paris présentent une proximité étonnante avec ces services de renseignement ». Ils font donc naturellement écho aux luttes de pouvoir qui agitent ces mêmes services de renseignement, facilement abusés ou influencés par eux. « Il y a une lutte d’influence très forte au sein de la DCRI, confirme Laurent Bonneli. Cette lutte a vu la DST mettre l’accent sur le danger gauchiste. On en voit le résultat dans les affaires actuelles et je serais fort tenté de dire qu’ils se sont carbonisés sur ce coup. »
L’actuel épouvantail gauchiste, agité par les services de renseignement, ne serait ainsi qu’une émanation des services de renseignement ? Pas tout à fait : le gouvernement y joue aussi un rôle. Logique. « Il y a une crainte importante au gouvernement, celle d’un contexte de crise, d’effondrement des partis politiques classiques et de montée des radicalités, remarque Laurent Bonneli. Cette crainte est la toile de fond de l’intervention de Tarnac. »
Tous des terroristes ?
Conséquence de la création d’un pôle antiterroriste et de la lutte des services de renseignement, l’instrumentalisation de l’antiterrorisme n’aurait jamais été possible sans la construction d’une figure juridique très particulière, celle de « l’association de malfaiteur en relation avec une entreprise terroriste ». Sa définition ? Le Code pénal la présente comme « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme mentionnés aux articles précédents ». Les éléments développés dans la jurisprudence sont notamment les suivants : l’existence d’un groupement de plusieurs personnes unies dans l’intention de perpétrer un acte criminel collectif ; chaque membre doit avoir pleinement conscience de cette intention et du fait qu’il s’agit d’une entreprise criminelle ; et cette intention doit être démontrée par un ou plusieurs faits matériels. Il n’est pas nécessaire que l’un des participants accomplisse une action concrète pour mettre à exécution un acte terroriste.
Une définition aussi vague que large, donc. Volontairement : « La particularité de la loi est qu’elle nous permet de poursuivre des personnes impliquées dans une activité terroriste sans avoir à établir un lien entre cette activité et un projet terroriste précis. C’est la grande différence avec la situation à l’étranger où vous devez avoir un lien avec un projet précis. Ce texte nous permet de prendre des mesures bien avant la menace et d’agir contre des réseaux de soutien clandestins ou le soutien logistique apporté à ces organisations », expliquait en 2006 Jean-Louis Bruguière, ancien chef de file des juges d’instruction antiterroristes.
Une idée essentielle : il faut agir préventivement. C’est là une exception française que de considérer qu’il faut frapper les supposés terroristes avant qu’ils n’aient commis le moindre délit.
« L’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste consacre une figure judiciaire singulière, qui va permettre une neutralisation préventive, constate Laurent Bonneli. Dit autrement : en matière antiterroriste, il s’agit d’arrêter les gens avant que les délits ne soient commis. C’est quelque chose qui n’existe nulle part ailleurs, pas même aux Etats-Unis. »
Une façon de faire qui ouvre la porte à tous les abus, à toutes les erreurs. C’est d’ailleurs le reproche principal opposé à cette incrimination. De nombreuses voix s’étaient élevées, bien avant Tarnac et la construction d’un pseudo danger anarcho-autonome, pour fustiger cette idée d’une intervention préventive. Dans les années 90, déjà. Plus récemment, avec la parution d’un rapport de Human Rights Watch2, lequel condamnait les poursuites françaises contre « des personnes pour leur association avec d’éventuels suspects d’activité terroriste, mettant à mal les normes internationales en matière de procès équitable, » et démontrait « comment la France utilise un délit à la définition floue (…) pour arrêter un grand nombre de personnes sur la base de preuves minimales ».
Problème : même en juillet 2008, date de la publication de ce rapport accablant, tout le monde s’en fichait plus ou moins. La chose concernait encore majoritairement, aux yeux de l’opinion publique, les supposés terroristes islamistes, arabes et fils des cités. Il en va autrement depuis que des enfants de la classe moyenne, blancs et intégrés, sont aussi touchés.
Revenons à nos moutons (noirs). L’incrimination « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » peut donc englober tout et n’importe quoi, et repose sur la nécessité d’agir avant la commission des crimes ou délits. Un constat que l’éditeur Eric Hazan dressait peu après l’interpellation des neuf de Tarnac3 : « L’inculpation pour ’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste’ est plus que vague : qu’est-ce au juste qu’une association, et comment faut-il entendre ce ’en vue de’ sinon comme une criminalisation de l’intention ? Quant au qualificatif de terroriste, la définition en vigueur est si large qu’il peut s’appliquer à pratiquement n’importe quoi – et que posséder tel ou tel texte, aller à telle ou telle manifestation suffit à tomber sous le coup de cette législation d’exception. »
Nous sommes donc tous des terroristes en puissance, tant il ne s’agit plus de réprimer nos actes mais nos intentions. Et ces dernières peuvent très bien ne reposer que sur des amitiés inappropriées, de mauvaises lectures ou un mode de vie hors norme. Ne pas posséder de téléphone portable, lire L’Insurrection qui vient ou vivre en communauté, dans le cas de la mouvance anarcho-autonome. Ou, versus islamiste : « Le délit d’association [terrorisme] se déduit de la proximité du diable : vous êtes un jeune musulman, vous avez partagé l’appartement avec des salafistes, imprudemment, vous avez échangé des écrits… Le niveau de preuves est faible parce qu’on est sur une intention présumée. Le fait d’avoir été proche d’un salafiste permet de dire que parce que vous auriez pu avoir l’intention de commettre un acte terroriste, il convient de vous mettre en détention », décrit ainsi William Bourdon, un avocat cité par le rapport d’Human Rights Watch.
Dernier point, l’incrimination d’« association de malfaiteur en vue d’une entreprise terroriste » permet de procéder à de très larges vagues d’arrestation, chalut de pêche qui retient énormément de monde dans ses filets, quitte à ne garder que quelques poissons une fois avérée - longtemps après - l’innocence de la majorité du fretin arrêté. « Tout repose sur la stratégie du coup de pied dans la fourmilière : en arrêtant très largement, on parvient forcément à désorganiser un réseau, souligne Laurent Bonneli. Et tant pis si les procès innocentent ensuite 60 à 70 % des gens qui ont été arrêtés… » Dans le tas, aussi, des gens contre lesquels la justice n’a pas de preuve, mais qui seront quand même condamnés.
Exemple resté célèbre, celui du prétendu « réseau Chalabi », évoqué par Human Rights Watch : « En novembre 1994, 93 personnes seront arrêtées en un seul jour, marquant le début d’une série d’arrestations qui se poursuivront pendant deux années et qui viseront des membres présumés d’un réseau de soutien aux combattants islamistes en Algérie. Le 25 juin 1995, 131 personnes seront arrêtées dans cinq villes différentes de France, à nouveau sur présomption d’implication dans une activité terroriste. En définitive, 138 personnes seront jugées en 1998 pour association avec un groupe terroriste, désigné en France sous le nom de ’réseau Chalabi’. En raison d’un manque d’espace au tribunal central, le procès extrêmement controversé se déroulera dans le gymnase d’une prison située en périphérie parisienne. Cinquante et une personnes seront relaxées, dans certains cas après une détention provisoire longue de trois ans, tandis que 87 seront reconnues coupables. Quatre autres seront acquittées en appel. Parmi les condamnés, 39 recevront des peines de moins de deux ans tandis que les quatre principaux accusés, dont Mohamed Chalabi, le chef présumé, seront condamnés à des peines allant de six à huit ans. »
Effrayant, n’est-ce pas ? Je veux… Il est une statistique à retenir en la matière : sur les 358 personnes incarcérées en septembre 2005 pour des infractions en rapport avec le terrorisme, 300 l’étaient sous l’accusation « d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ». Autant dire sur le base de simples présomptions, ni avérées ni prouvées.
Conclusion ?
Le mot de la fin à Laurent Bonneli : « Nous ne sommes pas dans un régime d’exceptionnalisme, mais nous avons des poches d’exceptionnalisme enchâssées au cœur du système. Avec une telle façon de faire, la figure du suspect et celle du coupable tendent logiquement à se confondre ; une logique qui a été poussée à son extrême à Guantanamo, où il n’est plus jamais nécessaire de démontrer la culpabilité des personnes détenues. »
C’est tout. Allez… à plus, les terroristes !
1 Toutes les citations du juge Gilles Sainati et du chercheur Laurent Bonneli, ainsi qu’une partie des données de ce texte, sont issues d’une conférence donnée lundi dernier à Paris par ces deux hommes. Ce bref séminaire s’intégrait dans les « dix jours d’agitation en soutien aux inculpés de Tarnac et d’ailleurs », dont vous trouverez une partie du programme ICI.