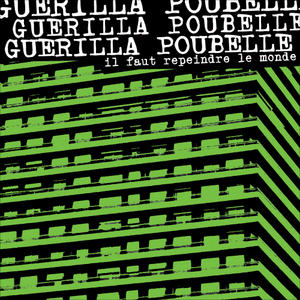jeudi 27 septembre 2012
Entretiens
posté à 18h43, par
15 commentaires
Si tu fais de la musique, publies des textes ou peins des toiles, tu y as forcément eu droit. Cette vieille question : « Et tu gagnes ta vie, avec ça ? » Arghhh... Cela fait dix ans que Till, chanteur des Guerilla Poubelle, l’entend, cette interrogation. Et dix ans qu’il doit expliquer ce choix de ne pas essayer de la gagner, sa vie, avec la musique. Et cette fois encore...
À côté du lycée, il y a un bureau de tabac. À la caisse, le tenancier – Horst Tappert1 qui aurait été mordu par un zombie - se saisit de l’exemplaire du magazine Rock Sound2 que je lui tends, comme on attrape la couche sale d’un nourrisson gourmand. Puis, gêné, je désigne un paquet de dix Marlboros et en demande le prix. Mettez m’en un. Je claque quelques euros, qui sortent tout juste du four de la Banque centrale européenne. Nous sommes en 2002, et j’ai l’impression que l’euro c’est trendy et « moins cher ». J’affronte une dernière fois le mépris du buraliste qui, à son corps défendant, me rend la monnaie et me glisse un « bonne journée », que j’entends comme un « va mourir » et qui vient s’écraser au sol tel un crachat. Derrière moi, une vieille dame achète Le Figaro Magazine et monsieur le buraliste lui consent un sourire, avant de s’enquérir de son état de santé. Cette vilaine sciatique. Mais tant qu’il fait beau, ça va. Tandis que je rejoins mes amis dans un petit parc qui jouxte le lycée, je me dis qu’il y a une idée qui plane au dessus du buraliste, de la vieille dame, de la sciatique et du Figaro. J’ai 16 ans, bientôt Le Pen sera au second tour, et l’idée se fera cliché. De ceux qui permettent de se construire une opinion sur les « choses ». Salauds de droite.
J’arrive au petit parc, mon magazine à la main. Je tends une Marlboro à celui qui roule une grosse cigarette panachée, qu’on observe encore avec curiosité et appréhension, et qui donnera cet après-midi au cours de mathématiques de madame Flotard la dimension psychédélique qui lui revient de droit. Bientôt, le débat s’engage au sujet du magazine. « Le rock, c’est commercial de toute façon », « Non, il n’y a que ceux qui passent à la télé qui sont commerciaux », « Pff, les plus commerciaux ce sont ceux dont les disques sortent sur des majors », « De toute façon, ils sont tous commerciaux, sauf Kyo3 ». On se cherche. Le choc de nos identités incertaines ressemble à s’y méprendre à une partie d’auto-tamponneuses. Le débat s’enlise et je sors de la mêlée en m’envolant, agrippé à une volute de fumée. Persuadé que j’ai raison et que la musique que j’écoute ne saurait être dévoyée par de basses et impures intentions commerciales. Et qu’un jour, ils verront que j’ai raison, même si pour le moment je peine à exprimer mon avis. Passablement fatigué par la cigarette panachée, je feuillette les pages de Rock Sound et tombe sur un article à propos du groupe Les Betteraves. Formation qui pratique un ska-punk insolent, frondeur et rigolard. Les musiciens ont mon âge et tournent déjà beaucoup. Intriguant. Le soir, j’écoute leur morceau sur le CD vendu avec le magazine. Ça me plaît un peu. Comme ça a l’air « tendance » et que personne ne m’en a encore parlé, je décide que ça me plaît beaucoup.
Je sais que c’est pas vrai mais j’ai dix ans
Dix années ont passé. En fait, l’euro, c’était pas « moins cher ». En fait, j’ai jamais eu raison. En fait, tous les cinq ans, on sort l’extrême-droite du placard où elle croupit pour faire peur à celles et ceux qui seraient tentés de ne pas rendre leur copie. En fait, la situation d’urgence est devenue la situation tout court4. Récemment, Madame Flotard a tenté de s’immoler par le feu dans la cour du lycée, et le procureur de la République en charge de l’affaire a parlé de tentative de suicide « en lien avec l’activité professionnelle ». On en arriverait presque à penser que la fable de la croissance et du progrès fait un peu la gueule, bien qu’elle continue à tenir le haut du pavé. À grand renfort de déclinaisons de la guerre sociale à domicile et d’autant de croisades économiques à l’extérieur. La spoliation comme contrat social, aux modalités sans cesse renouvelées et dont il est difficile de comprendre la vitesse et les enjeux. Si tant est qu’on ait encore envie de comprendre. C’est tellement évident que ça n’a pas de sens, que ça a de moins en moins de sens de dire que ça n’en a pas5.
C’est dans ce contexte que tout un chacun est sommé de trouver comment ponctionner de quoi survivre. S’insérer. Et chercher une histoire à se raconter, pour regarder le temps qui passe autrement que comme un vulgaire sablier qu’on a retourné. Pour commencer : trouver un truc à dire à Pôle emploi et à la famille qui s’inquiète. Je me demande ce qu’elles sont devenues ces Betteraves qui chantaient « J’veux pas travailler » ? Cons du punks qui dévoient le capital humain en formation durant son adolescence et n’assurent pas l’après-vente... Pas de nouvelles des dites Betteraves quand je demande aux passeurs de culture légitime, qui ont élu domicile dans une grande FNAC. Quand je pose la question, on m’explique que tout ce qu’il reste des punks, c’est là-bas, au fond du magasin : une photo encadrée et accrochée au mur, avec Sid Vicious qui tire la langue sur fond d’irrévérence désormais socialement acceptable et digérée par le Marché. No futur et rééditions remastérisées.
Punk-rock is not a job
Qu’est devenue cette musique qu’on appelait au milieu des années 1970 le « dole queue rock », c’est à dire « rock de file d’attente de chômeurs » ? Les plus nostalgiques répondront que le punk est mort il y a bien longtemps. Néanmoins, « unemployment’s not dead », et si le terreau reste à peu de choses près le même, comment s’expriment désormais les aspects positifs des jeunes énergies négatives6 ? Au-delà du giron punk, comment vit-on pour et par ces cultures dites « alternatives » dans un contexte économique où la crise permanente est devenue la structure même de la société ? Et dans la « vraie vie d’adulte », y a-t-il encore une place pour prolonger le débat lycéen enfumé et boutonneux sur ce qui est « commercial » et ce qui ne l’est pas ?
J’apprends que les Betteraves ont donné naissance à un autre groupe : Guerilla Poubelle. Et qu’après plusieurs changements de line-up, Till – ex-chanteur des Betteraves – continue d’officier à la guitare et au chant au sein de Guerilla Poubelle. Le groupe déroule un punk-rock décomplexé et incisif, et le compteur kilométrique du camion accuse le coup des quelques 500 concerts de la troupe. Deux ou trois galettes phares, dont un premier disque Il faut repeindre le monde... en noir vendu à plus de 20 000 exemplaires, et un nombre conséquent de collaborations et autres split albums7. En parallèle, Guerilla Asso produit et distribue des disques, majoritairement d’obédience punk-rock, et fédère de nombreux groupes autour d’une scène francophone (mais pas que) qui ne tient pas en place. On murmure que Guerilla Poubelle refuserait de s’inscrire à la SACEM ou de jouer quand le prix des places dépasse les dix euros. Mais quand le groupe a le dos tourné, on fustige son public adolescent, son succès et les contradictions qui iraient avec. Vendus. Pourtant, les textes de Till, des brulots âpres et lucides écrits comme on colle un post-it sur le frigo avec marqué « ne pas oublier de tout brûler », évoquent moins l’adolescence que l’arrivée de la trentaine. Et quand on apprend que le groupe a passé le film La Société du Spectacle de Guy Debord pendant qu’il jouait, on ne sait plus quoi penser. Reste le texte de la chanson « Punk-rock is not a job » extraite du dernier album en date, Punk=Existentialisme :
« Alors on pète le marché ?
On n’a pas les pieds sur terre ?
Pas prêt à faire payer 15 euros le concert.
Je suis prêt a trimer encore avec un job à coté pour garder cet accord, cette putain de liberté.
Je vais même pas essayer de t’expliquer pourquoi,
Pourquoi on est là et pourquoi on fait ça,
S’il y a « Guerilla » dans notre nom c’est pas pour en faire un job. »
Printemps 2011, bien décidé à ce qu’il m’explique malgré tout « pourquoi il est là et pourquoi il fait ça », je rencontre Till dans un café parisien pour parler insertion et plan de carrière. Il s’agira d’être vertueux, les dieux nous observent : derrière nous une photo du Che et une de Johnny Hallyday. Avec le « succès » des Betteraves puis de Guerilla Poubelle, on pourrait imaginer que Guerilla Assso est une petite start-up parisienne où l’on grignote la monture de ses lunettes carrées en rêvant de dividendes, bercé par BFM-TV qui vomit l’actualité à un rythme frénétique (pour qu’on ne puisse pas la comprendre). En réalité, pas vraiment.
« L’asso tourne avec des thunes persos, pour sortir les groupes, et c’est moi qui choisis avec qui bosser. Quelques personnes me donnent des coups de main pour la promo ou la street team. Pour tout le reste - la distribution, le shop qu’on a en ligne, les histoires de label, de fabrication, les envois -, je m’en occupe tout seul. Ça se passe dans mon appart, je suis un peu à l’étroit dans les cartons de disques... Et à côté, on organise des concerts à Paris avec Seb qui bosse pour le webzine Punk Fiction. Il s’agit juste de concerts au black : les thunes qui rentrent à l’entrée servent à payer les groupes, et basta. »
N’ayant pas encore trouvé d’expert comptable appréciant les lignes de basse de Rancid à leur juste valeur, Guerilla Asso pense un modèle économique qui n’en est pas un. Il s’agit juste de s’organiser à plusieurs pour continuer à « faire ». Pas d’accumuler.
« On va dire que la comptabilité n’est pas très « en place » : pas facile de savoir exactement où on en est. Pour l’activité concerts, qui est financièrement à part, on a créé une boîte où on met les thunes [rires], à l’ancienne. Il y a des soirs où on perd un peu d’argent et des soirs où on en regagne. Un fond de caisse de 300 euros nous permet de tourner. Si un jour on perd beaucoup d’argent, on verra s’il faut qu’on mette de notre poche. La seule fois où c’est arrivé, on a réorganisé un concert avec nos groupes pour renflouer le trou.
Ça marche relativement bien, ça demande peu d’investissement. Pour une sortie de disque – soit entre mille et deux mille euros de dépensés pour des disques qui se vendent à quatre cent exemplaires -, on s’y retrouve assez vite. Même s’il y a des disques où je perds de l’argent, on en gagne plus sur d’autres : ça s’équilibre. Ce n’est pas un trou à thunes. »
Till décrit une activité fragile mais relativement pérenne, le tout avec beaucoup de simplicité. Économie informelle, « économie associative », économie à taille humaine, économie alternative : les mots manquent et c’est tant mieux. Et toujours ce fieffé DIY qui tire la langue, perché au dessus des pratiques, et qui nargue l’idée selon laquelle la religion de la croissance contraindrait à y croî(t)re. Incrédule et rigide comme un conseiller Pôle emploi, je questionne mon interlocuteur sur la provenance de la « mise de départ ».
« Quand Guérilla Poubelle a commencé à bien marcher et qu’on gagnait plus qu’on ne dépensait, j’ai refusé d’en vivre. Pas question d’en tirer de l’argent pour bouffer ou pour mon appart : je veux garder un métier à côté. Du coup, cet argent a permis de créer Guerilla Asso ; l’idée est de le réinjecter dans la scène, de s’en servir. Aujourd’hui avec Guerilla Poubelle, on ne tourne pas beaucoup et on ne gagne pas grand chose. Le peu d’argent qu’on gagne sert à réparer le camion ou à payer les billets d’avion pour les tournées à l’étranger. Maintenant, l’asso tourne toute seule. »
Avoir la chance de gagner sa vie en la vivant une guitare à la main et s’en priver. Cela pourrait apparaître indécent à une époque où le chômage et la pauvreté sont brandis comme des chapelets devant quelque impie tenté de faire la fine bouche. Sauf que.
« Je suis un vieux nazi du DIY. La plupart des gens ont cette espèce de vision du rock’n roll où t’es une star et t’en vis. Une image complètement fausse. 99 % des groupes de rock’n roll de la planète perdent de l’argent. Nous, on a juste la chance de ne pas trop en perdre avec tous nos projets, et c’est vraiment cool. Mais je n’ai jamais voulu en vivre, je n’ai connu que des groupes qui galéraient.
On fait de la musique depuis qu’on est gamins, et dès le début on s’en foutait, on ne voyait pas ça comme un métier mais comme une passion. Je préfère que le prix d’entrée aux concerts ne soit pas élevé, que les disques ne soient pas chers, que le choix des dates relève d’une envie et non d’un besoin. On a récemment fait un break d’un an et demi, ça aurait été impossible si ça avait été notre métier. Nous aurions dû continuer à faire des trucs, et ça aurait sans doute tué le groupe.
C’est plus sain ainsi, on est libres, on peut faire ce qu’on veut, on n’a pas de label derrière pour dire : « La pochette, il faudrait que ce soit plus commercial, enfin plus vendeur. » Là je pars quinze jours en tournée, au Canada et aux États Unis, je vais rentrer et je vais être bien dans ma peau [rires] et c’est un truc hyper important. Si ça devient un boulot, qu’est-ce qu’on ferait « à côté » ? »
Till est coursier en scooter à Paris. Option Flexibilité et précarité en deuxième langue. Un contrat de travail qui lui permet de répéter et de partir en tournée fréquemment. En parlant de « job à côté », j’évoque les paroles de la chanson « Punk-rock is not a job » citée plus haut. Un morceau où Till énonce certain de ses principes avant d’admettre la possibilité qu’il faille un jour mettre de l’eau dans la bière.
« C’est la première chanson de l’album qui s’appelait « Punk = Existentialisme » où j’essayais de ne pas être figé dans des attitudes, dans des démarches, et de ne pas affirmer : « Aujourd’hui c’est comme ça, ce sera toujours comme ça ! » C’était une façon d’ouvrir, de dire : « Peut-être que dans cinq ans, on aura des gamins, ce sera plus simple d’en vivre et on passera pour des cons d’avoir dit ça. »
Je suis très pote avec des mecs comme les Uncommonmenfromars qui, eux, font des cachets. Ils n’en vivent pas, ils en survivent. Mais ils ont décidé que ce serait leur métier, et je n’ai aucun problème avec ça. Les Dirty Fonzy aussi, qui font des cachets et essayent d’être un peu pro, font d’autres trucs à côté pour pouvoir faire leurs heures d’intermittence ; je respecte complètement. Mais ça ne me fait pas du tout rêver. On en parlait avec Alex, notre batteur, qui pense que ce n’est pas une histoire de choix ; il appelle ça un « loisir de riche ». Je trouve plutôt juste l’expression, mais pas dans le même sens que lui. Lui estime que je peux me le permettre parce que j’ai eu de la chance dans la vie. Mais ça fait huit ans que je bosse là où je suis, que je me suis arrangé pour que ça soit comme ça, pour avoir un appart où j’ai de la place pour foutre les trucs du label... À côté, je fabrique des badges pour des groupes, pour bouffer, parce que mon salaire c’est la même somme que mon loyer [rires] les bons mois. J’ai un autre boulot où je fais de la saisie, je rentre des traductions de biographie d’économistes sur le site d’une école d’économie à Paris. En fait, j’ai trois métiers pour survivre. Mais « loisir de riche », je trouve ça assez bien ; dans le sens où tu te dis : « Je vais organiser ma vie pour que ce truc-là soit un loisir mais qu’il occupe toute ma vie. » »
Le fameux principe de réalité, que l’on peut apercevoir à l’horizon, tout au bout de cette route que parcourent beaucoup de groupes de concert en concert. N’en déplaise aux gardiens des musées où l’on expose des images d’Épinal donnant à voir une idéalisation romantique de la vie de musicien rock, la routine a ses couplets et les loyers à payer reviennent tous les mois comme un refrain. Cela ne va pas sans poser de problèmes au sein de Guerilla Poubelle, dont certains membres auraient bien tiré un revenu. Pour ne plus galérer. La question continue à se poser et, au delà de positions de principe différentes, tous essaient de se comprendre. Le leitmotiv reste de ne pas se fourvoyer ou se perdre.
« Il y a ce groupe américain8 où les mecs ne font que tourner : ils font deux cent cinquante concerts par an, ils ont rendu leurs apparts, ils tournent en camping-car avec une charrette derrière pour le matos - c’est un choix de vie extrême. Ça implique de vraiment se marginaliser : les mecs n’ont plus de maison, ils voient leur famille je ne sais pas quand, ils ne bouffent pas tous les jours. En même temps, ils jouent quasiment tous les soirs de l’année et ils voyagent. C’est un truc qui fait réfléchir. Ce n’est même pas leur métier, ils ne cotisent pas pour la retraite (rires). C’est séduisant, même si peut-être un peu romantique... C’est vrai que si on me proposait ça, je dirais pas non tout de suite. Ils ne compromettent pas leur musique, ils font ce qu’ils veulent, de la façon dont ils veulent, et vont jouer là où ils le souhaitent.
En France, personne ne fonctionne comme ça. Ce n’est pas ce qu’on appelle « vivre de la musique » dans l’imaginaire commun. Les groupes de rock & roll français qui ont essayé, ça les a souvent tué : ça marche un temps et puis quand ça marche moins bien, comment tu t’en sors ? À part peut-être Burning Heads9 qui a réussi à se sortir de ça et qui aujourd’hui fonctionne un peu comme nous : ses membres ont trouvé un boulot à côté et l’argent gagné va dans leur label. Ils galèrent financièrement mais ils continuent à faire de la zique et c’est assez admirable. C’est hyper difficile de retrouver un boulot où tu n’as pas envie de te suicider en rentrant chez toi tous les soirs, et de continuer à faire de la musique. Le choix se pose beaucoup : est-ce que je fais un taf ou de la musique ? Sans parler d’avoir une famille...Moi, je n’ai rien, pas d’enfant, pas de femme, mais j’ai un label (rires). Ce n’est quand même pas le même investissement, je n’ai pas besoin d’être là tous les soirs pour que mon gamin ait à bouffer. »
Là où d’aucuns seraient encore tentés de mesurer le degré de subversion d’un musicien rock au nombre de guitares détruites sur scène, il convient plutôt de lorgner du côté des coulisses où se joue la partition d’une recherche autrement plus fertile. Cohérence. Indépendance. Ce qui ne va pas sans contradictions et sans concessions. Qu’importe, il ne s’agit pas de fonder un projet de société. Mais de voler un bout de temps à cette dernière pour vivre un peu plus fort et un peu plus vite quand elle a le dos tourné. Difficile de concevoir tout cela comme un « simple travail ».
« J’en parlais récemment avec Bruno de Garage Lopez, un mec de l’ancienne école. Lui est encore plus intégriste, il dit : « Si tu ne trimes pas, que tu ne bosses pas et que t’as pas un truc à côté, c’est que ce n’est pas du rock’n roll » [rires]. Il exagère, mais je le rejoins un peu. Les meilleurs groupes que je connaisse sont composés de mecs qui sont au taf la semaine et qui donnent tout ce qu’ils ont le week-end, qui jouent chaque soir comme si c’était leur dernier concert. Quand c’est ton taf, tu ne fais pas ça.
Il y a eu une époque où tous les groupes type la Ruda Salska et Marcel et son Orchestre sont devenus professionnels. Aujourd’hui, ils font de la soupe. Et les mecs ont maintenant l’air de se faire chier sur scène. Ça, c’est horrible. C’est peut-être aussi parce que j’étais gamin quand j’ai vu ces groupes, qu’ils étaient mortels, qu’ils étaient fous, alors qu’ils sont aujourd’hui devenus des espèces de parodies de groupes de rock. Ça m’a peut-être conditionné à ne pas vouloir suivre le même chemin. Ça fait un peu le même effet quand tu te rends compte que ton père vieillit, que tu lui as raconté un truc la semaine dernière et qu’il ne s’en rappelle plus, ou qu’il a du mal à se concentrer sur des trucs. Il y a des choses qui font vraiment beaucoup de peine... Ce n’est pas tant le sentiment que ces groupes te laissent tomber, c’est juste qu’ils n’y croient plus trop et qu’ils sont un peu blasés ; c’est triste, je trouve. J’espère que ça ne m’arrivera jamais. »
« En vivre ». On est tellement habitués à manier l’expression qu’on en oublierait presque d’ interroger la normalisation des trajectoires – devenues carrières - qui va avec. C’est pourtant l’une des premières questions que l’on pose à quelqu’un pour le « cerner ».
« Les gens me demandent : « Tu en vis ? » Non, je n’en vis pas, mais c’est ça ma vie. Même ma mère, quand elle parle de moi, dit : « Mon fils est musicien. » « Ah ouais, et il arrive à en vivre ? » « Non, non, mais il est musicien. » Pour elle, je suis musicien, je ne suis pas coursier. Ce qui me définit effectivement, c’est musicien, entre guillemets. Mes parents sont fiers de comment ma vie tourne, même s’ils ne comprennent pas vraiment. Ils ont eu des doutes, mais maintenant ils voient que je suis épanoui, que j’arrive à m’en sortir et que c’est un truc que je fais depuis dix ans.
À mon boulot aussi, quand je parle à quelqu’un de mes groupes, on me demande : « Ah, et t’arrives à en vivre ? » Ben non... ils voient bien que je travaille à ce boulot de merde... Et ils me sortent : « J’espère que tu y arriveras un jour. » Ça me rend fou. Quand tu dis que tu joues au tennis, même si tu fais des compétitions, on ne te demande jamais : « Et tu penses en faire ton métier ? » »
Deuxième café. En élargissant, nous nous apercevons que ces problématiques et les positionnements qui en découlent ne sauraient être réduits à la simple toile de fond tendue derrière un bon groupe punk qui brancherait tous les soirs sa colère dans un ampli10. Ça n’a plus grand rapport avec la musique, d’ailleurs. Le sens de l’activité, l’impérieuse nécessité de faire quelque chose soi-même, l’artisanat, le rapport conflictuel à l’argent ou au salariat et la « mythologie » qui se blottit au creux des gestes et des pratiques construits en réaction à ces derniers. Tout cela va bien au-delà d’une quelconque problématique ou posture « artistique » ou d’une culture « alternative ». Au fond, c’est peut-être là le principal héritage de la fin des années 1970 et de l’âge d’or du punk : chercher comment dessiner un point de fuite sur le mur au fond de l’impasse. Et faire d’un rejet une énergie motrice. Penser la nature des moyens comme aussi importante que la fin. Sans pour autant prétendre faire plus ou poser des dogme ; la boussole éthique est à consulter à chaque intersection.
« Il y a beaucoup de gens, en tout cas dans la scène punk, qui mettent en avant, comme un choix politique, d’être DIY, de faire des Cds gravés pas chers. Comme s’ils agitaient un grand drapeau « DIY ! » ou « Underground », alors qu’ils n’en ont pas vraiment fait le choix. Quand ton groupe intéresse vingt punks dans ta ville, c’est sûr que t’es DIY - il n’y a pas à être fier de ça. C’est comme mettre des jeans, « t’as vu je mets des jeans ! », ben oui tu mets un jean... Mais pour un groupe comme le nôtre, où on est arrivés avec un premier album en étant des gamins, en vendant 20 000 disques et en faisant plus de 100 concerts par an, un vrai choix se pose. Est-ce qu’on s’inscrit à la Sacem ? Est-ce qu’on se paye ? Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Nous, on ne s’est finalement pas vraiment posé la question, on s’est juste dit : « Ben ouais, on va faire comme ça. » Et on a fait comme ça. On en parle beaucoup parce que finalement nos vies tournent autour de ça, de cette vie, mais je n’ai pas l’impression - en tout cas, dans les chansons et les interviews - de dire que c’est comme ça qu’il faut faire, que nous avons raison. »
Je me surprends à rêver. Une armée d’activistes armés de décibels et de principes, marchant par milliers sur la cité, afin d’aller couper les respirateurs artificiels des « vieux et des vieilles »11 qui végètent dans de cossus salons tout en légiférant sur nos vies. Changer le monde, en somme. Défendre sa musique tout en s’adaptant au contexte, « réagir », ne ferait-il pas courir le risque de s’enferrer dans des postures défensives ? Pourtant, ivre dans une fosse où tout le monde meugle sa colère devant un groupe qui joue trop fort et trop vite, il est tentant de penser qu’une « culture » et des valeurs partagées pourraient permettre de constituer un « front commun ». On commence quand ?
« Tout ce que je fais est complètement égoïste. Si je ne faisais pas ça, m’impliquer ainsi, baisser la tête et juste foncer, je me suiciderais. Ma vie n’aurait pas de sens. C’est un espèce de vide énorme dans l’existence, qui est quasi impossible à boucher, en tout cas chez moi. Cela revient à s’agiter beaucoup pour oublier qu’il y a un énorme trou.
Je ne fais pas ça pour la cause, c’est sûr. Je le fais parce que je ne me pose pas la question de pourquoi je le fais. Et quand je me la pose, j’ai envie d’arrêter. Parce qu’effectivement, ça ne sert à rien... toute ma vie, je vais faire ça et le monde sera pareil à la fin ; rien n’aura changé. C’est vraiment quelque chose de superficiel : il y a des gens qui crèvent de faim et nous, on fait les guignols avec des guitares. Même si ça reste sans doute moins pire que de faire les guignols en bourse...
Je crois, en fait, que c’est le côte sartrien du truc. Ce n’est pas parce que tu ne prends pas un fusil et que tu ne vas pas tuer des nazis que tu ne résistes pas, juste en t’impliquant dans quelque chose et en donnant un autre exemple de vie. Chanter une vision différente de la société, ça change peut-être un peu le monde aussi ? Il y a beaucoup de gens qui gaspillent de l’énergie en croyant se battre mais qui en fait se chamaillent entre eux. Je le vois beaucoup dans les associations anti-fascistes : être anti-fasciste devient un état, au lieu d’une démarche. Comme si c’était un loisir : il y a des mecs qui sont anti-fascistes comme nous on fait de la musique... Ça n’a pas de sens. Je sais qu’il y a des gens qui font des choses très bien et importantes dans ces mouvements, mais j’ai l’impression que c’est parfois aussi un peu du folklore.
Moi, je ne vote pas, je ne suis même pas inscrit, je ne vais jamais non plus à une manif parce que j’ai du mal à m’identifier à des trucs collectifs. Et ça me semble vraiment difficile de s’impliquer collectivement sans que ce ne soit absurde. Au fond, je ne sais pas si je change le monde ou non, mais je pense que ce n’est pas très grave. De toute façon, c’est un peu vain. »
Ne pas se prendre pour un tribun ou un sociologue. Se baser sur la singularité d’un vécu - avec ce qu’il porte sur le dos de doutes et de contradictions - pour raconter une histoire. Un zeste de cynisme, un soupçon d’espoir, réservez et servez chaud ! Les paroles de Guerilla Poubelle, avec Till pour auteur, révèlent une schizophrénie, celle qu’implique le fait de mordre la main qui nourrit. « On parle de libre-arbitre, un couteau sous la gorge », chante t-il dans le morceau « Quand le ciel sera tombé ». Contraints mais toujours renvoyés à la responsabilité individuelle. Sans désigner aucun « méchant » et en évitant l’écueil du choix imposé d’un côté de la barricade. Y a-t-il seulement deux côtés ? Ne pas attendre du propos qu’il livre une grille de lecture politique cohérente et pré-mâchée : fais-le toi-même. Les textes n’en sont que plus percutants et gênants.
« Ce que je « reproche » à beaucoup de groupes et à certains discours qu’on trouve aussi dans la presse et les fanzines, c’est que les mecs donnent des réponses au lieu de poser des questions. Je préfère soulever des cailloux et regarder en dessous plutôt que planter des clous. Notre chance, avec Guerilla Poubelle, est de fédérer beaucoup de gens différents ; du coup, aux concerts, ça pose parfois des questions. On dit des trucs sur scène, et il y a des gens dans la salle qui ne sont pas d’accord. Ce qui n’arrive jamais dans un squat où est jouée une chanson nommée « Fuck la police », avec tout le public qui fait « Ouais !! »... Tout le monde est content... Et c’est vrai : c’est quand même cool d’être cent dans un lieu, et de tous chanter la même chose ! C’est bon de se retrouver entre nous et de faire un truc qu’on kiffe tous. Même si, au bout d’un moment, ça se mord la queue.
J’essaye de ne pas écrire de textes qui fonctionnent comme ça. Et je pense que Guerilla Poubelle est quand même assez (relativement) diffusé et entendu pour que ça fasse réfléchir. Je reçois d’ailleurs beaucoup de mails de gens qui discutent des textes, qui parfois questionnent les références. Par exemple, après m’être référé à Cioran, des gens m’ont écrit en me demandant : « Tu sais ce que Cioran disait sur les juifs...? » C’est largement plus cool de pouvoir ainsi engager des « débats », des conversations, que de se retrouver à être tous d’accord. »
Sur la pointe des pieds, je me hasarde à une ultime question ; elle concerne l’enchâssement entre la vie, l’art et la politique. Et leur impossible séparation. Rien que ça. Après tout, à citer Debord, Sartre et Cioran dans ses morceaux, il tend le bâton. Réponse en forme de renvoi dans les cordes. Comme si le temps passé à chercher comment qualifier la posture était du temps perdu à « ne pas faire ».
« Je vois ça comme de la philosophie plutôt que comme de la politique. Politique ? Dans ce cas, être trader, c’est aussi politique. Ça ne veut plus vraiment dire grand chose. Personne n’est hors de « la politique », du coup... Il y a des mots qui restent à inventer par rapport à comment la société se met en place. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup plus de choix qui s’offrent. Que le monde, la société en général, va tellement loin dans l’absurdité que ça ouvre plein d’autres voies.
Le terme « activiste » ne veut pas dire grand chose non plus ; et ça sonne un peu façon : « On va poser des bombes. » Et « artiste », ça fait quand même un peu bouffon.... « Miliviste ! » [rires] Mais est-ce qu’on a vraiment besoin de se définir pour faire ? « Tu fais quoi dans la vie ? » Je fais des trucs. »
Il vibre encore, le débat lycéen sur ces groupes qu’on fustigeait pour être trop commerciaux et ceux que l’on percevait comme chastes à travers le prisme du délire de pureté adolescent. Évidemment, le débat a fini par comprendre qu’on ne pouvait occulter la variable financière et qu’avoir le temps d’interroger cette variable était déjà un luxe. Alors, il a changé de vêtements pour ne plus avoir l’air con avec ses baggys et ses sweats Big bang squad. Il s’est habillé en choix de vie et en éthique. En opinion mûre et réfléchie. Souvent il est perdu, voire un peu triste parce qu’il a l’impression de ressasser comme la vieille « folle » qui dort en bas de la rue et se parle à elle-même. Du coup, il a appris à parler moins fort mais faut pas non plus trop le chercher, il reste soupe au lait. Certains diront qu’il refuse de grandir, mais en réalité il ne veut simplement pas devenir l’antithèse de ce en quoi il a cru. Il veut continuer à vivre, ce débat. Punk’s not dead !
1 Acteur allemand qui incarnait le personnage de Derrick dans la série du même nom.
2 Célèbre magazine anglais, décliné en France, qui défend le rock avec un penchant certain pour ses versants mainstream.
3 Groupe pop-rock français de mauvaise vie qui a « cartonné » en 2003.
4 Citation extraite du morceau « Je m’appelle » du groupe Programme, album Agent réel/2010/Ici, d’ailleurs...
5 Citation adaptée, extraite du morceau « S’en sortir pour aller où ? » du groupe Nonstop, album Road movie en béquilles/2005/Ici, d’ailleurs...
6 Titre d’un morceau du groupe Expérience, album Nous en sommes encore là/2008/Boxson
7 Disque sur lequel figure le travail de deux groupes différents.
8 Le groupe en question s’appelle Off with their heads.
9 Représentant mythique de la scène punk-rock hexagonale.
10 Till élargira d’ailleurs en évoquant l’auteur de BD Chester, par analogie avec ses pratiques de musiciens.
11 Extrait du morceau « Qu’est-ce qu’on attend » par le Suprême NTM, album Paris sous les bombes/1995/Epic