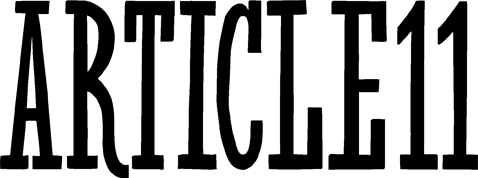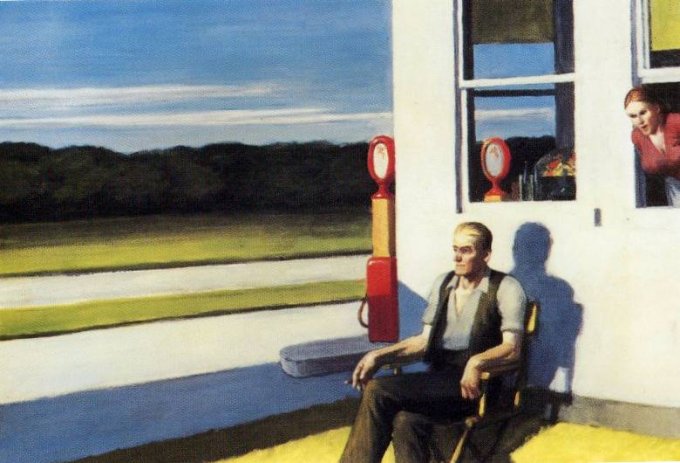Sur le bord des routes, ils se font rares. Mais tous les auto-stoppeurs n’ont pas dit leur dernier mot. À l’image d’Alan Balevi, pratiquant convaincu. Quinze ans qu’il fait du stop. Et quinze ans que certains l’embarquent et que d’autres l’ignorent. Typologie, opus 3.
Cette chronique, troisième d’une série de 4, a été publiée dans le numéro 18 d’Article11
*
En abordant les gens dans les stations-services plutôt qu’en tendant le pouce, j’ai été pris par des centaines de personnes qui n’avaient auparavant jamais pris personne en stop.
Une fois dans la voiture, je lance toujours la conversation par cette phrase : « Vous prenez souvent des gens en stop ? » La plupart du temps, vous me répondez « Non » ou « Jamais ». Vous me dites que vous avez fait une exception parce que j’ai l’air sympathique, mais qu’en général, quand vous voyez des gens faire signe au bord de la route, vous n’avez aucune envie de vous arrêter.
Tout se déroule comme si vous éprouviez habituellement un a priori d’indifférence ou de peur envers les auto-stoppeurs. Comme si, cette fois, en venant à votre rencontre, je vous étais apparu moins dangereux. Ou plus personnifié, plus précis. Sorti d’une case floue et marginale, soudain incarné, face à vous.
La peur de l’autre est le sentiment de base pour énormément d’automobilistes qui préfèrent rester seul et ne rien risquer. Un carjacking, on ne sait jamais, ça passe à la télé donc ça peut arriver. Vous m’avez d’ailleurs raconté la même histoire des centaines de fois : avant, dans les années 1970, tout le monde faisait du stop, même vous, et c’était sympa. « Mais ensuite, il y a eu des faits divers, des histoires sordides » de viol et d’agression, et le stop a cessé d’être sympa. Il est devenu louche. Voilà un bout de la déliquescence de la société, répété dans toutes les voitures.
Les années passant, ces conversations ont commencé à me glisser dessus. J’en ai entendues toutes les variantes. Elles sont sans issue et j’essaye de les briser le plus vite possible. Ou alors, si je vous sens joueur, je me lance dans une envolée politique sur la peur, police mentale de « notre société ». C’est seulement si je me sens bien avec vous.
Une nuit, je me suis retrouvé paumé dans le noir, entre Crest et Die, en pleine Drôme. Je tendais ma pancarte « Die » (petit clin d’œil aux anglophones). Même si je loue la vitesse et l’efficacité du stop sur autoroute, je ne peux pas toujours éviter, en bout de parcours, de me cailler sur le bord d’une route avec un panneau. Cette nuit-là, un homme s’est arrêté. Il m’a ordonné de monter et m’a sermonné. Sa fille avait été tuée en faisant du stop. Il m’a traité d’inconscient.
Je ne me suis pas permis de protester, par égard pour sa douleur et en vertu d’une règle qui s’est imposée à moi. Ne jamais contrarier celui ou celle qui me prend. Mais il faut ici souligner une évidence : toutes les personnes qui se sont fait agresser en stop ont probablement vu passer devant elles, avant de se faire prendre par l’agresseur, des dizaines ou des centaines de chauffeurs qui n’ont pas daigné s’arrêter. Le problème est plutôt là. Comment se fait-il que la seule personne à s’arrêter ait été un agresseur ? Pourquoi les autres n’ont-ils pas fait ce geste ? Mystère social.
Je n’ai vraiment eu peur qu’une seule fois. Et ce n’était pas ce jour où, entre Rennes et Nantes, un septuagénaire garé sur l’aire de Treillières m’a caressé la cuisse. Non, cette fois-là, je n’ai senti que pitié et dégoût. Et puis, nous étions arrêtés, je n’ai eu qu’à ouvrir la porte pour partir. Si j’avais été une fille, j’aurais probablement eu mille fois plus peur, et mille fois plus souvent. Je n’aurais certainement pas fait cent fois le tour de la France en stop, j’aurais renoncé à aller de Rennes à Marseille pour une petite fête.
Je n’ai pas vraiment eu peur non plus quand, sur la quatre-voies entre La Rochelle et Niort, le type qui nous a pris, ma copine et moi, s’est révélé être complètement ivre. Il zigzaguait. Heureusement, une bonne étoile veillait sur nous, un énorme embouteillage s’est formé. Tout le monde à l’arrêt. Nous avons béni les embouteillages. Et pris la poudre d’escampette : « Écoutez, finalement, on a changé d’avis, c’est trop lent, ça n’avance pas, on va descendre si vous voulez bien. - Ah bon, ok, d’accord, d’accord ! Salut. »
La fois où j’ai eu peur, c’était moi qui l’avais abordé, le gars. Il vérifiait la pression des pneus de sa 309 vers Laval et il avait l’air renfrogné. Il était baraqué. C’était encore au temps où je m’efforçais de ne pas faire de discrimination du tout, c’est-à-dire que j’allais voir absolument tout le monde dans les stations. J’étais en permanence très avenant. Et je voyageais hyper vite. C’était l’époque où tout le monde roulait à 150 ou 160, juste avant les années Sarkozy. Ce type fumait joint sur joint et cela ne lui faisait pas du tout le même effet qu’à moi. Lui devenait méchant. Il refusait de me dire où il allait me déposer en région parisienne. Petit à petit, il étalait sa musculature sur une partie du siège passager, c’est-à-dire sur la moitié gauche de mon corps. Il coupait toutes mes phrases, qui devenaient de plus en plus anodines et fluettes. Je tentais des banalités inoffensives sur la clémence de la météo ou sur la fluidité du trafic, mais il s’en foutait complètement. Il m’interrompait dès que j’ouvrais la bouche : « Non ! C’est pas ça ! Tu dis n’importe quoi ! Tu comprends pas, c’est pas ça ! » Il avait fait partie de la Légion étrangère et il m’en parlait avec des exclamations violentes. Je ne comprenais rien.
Il s’est arrêté dans une de ces petites aires d’autoroute où il n’y a qu’une cabine téléphonique et des toilettes. Il a encore roulé un joint. On est remontés dans la voiture, on est repartis vers Paris et là, il m’a dit : « Bon, t’as eu ta chance. On va aller dans une cité à Trappes, et avec mes potes on va s’amuser avec toi ». Là, évidemment, j’ai eu peur. Je ne sais plus si j’ai dit quelque chose. Peut-être que j’ai fait : « Euh ? À Trappes ? » Je lui avais demandé plusieurs fois s’il allait me laisser à une station de RER ou de métro, mais il n’avait pas répondu. Là, à sa manière, il me donnait une première indication géographique. L’habitacle était devenu très silencieux.
Je me suis dit qu’il fallait absolument qu’au péage de Saint-Arnoult, je me débrouille pour sauter de la voiture. Il n’avait pas de badge de « télépéage » permettant de ne pas stopper aux péages - ce n’était pas son genre, et à cette époque presque personne n’en avait. Il allait forcément devoir s’arrêter pour payer. Que ce soit avec une carte bleue ou du liquide, il y aurait alors un laps de temps de quelques secondes durant lequel la voiture serait à l’arrêt. Mon sac était sur la banquette arrière. Je le prendrais si je pouvais, mais la priorité était de mettre la majeure partie de mon corps à l’extérieur du véhicule. Je me suis demandé s’il avait un mécanisme de blocage de ma serrure. Et s’il m’empêcherait de descendre.
Mon cœur battait vite, j’étais pâle, mon sang circulait mal. Saint-Arnoult-en-Yvelines était à trente kilomètres. Coup de théâtre : encore une mini-aire téléphone-toilettes. Il s’y est à nouveau arrêté, sans un mot. Et il a roulé un joint, au volant, portière fermée.
Sur l’aire, il y avait une autre voiture. Une seule. S’il n’y avait eu aucun témoin, il aurait pu commencer à « s’amuser » avec moi. Comme ce n’était pas le cas, je suis sorti et je me suis précipité vers l’autre véhicule. À l’intérieur, un couple de sexagénaires. Je leur ai dit : « Excusez-moi de vous déranger, je fais du stop et là je suis dans la voiture de quelqu’un qui me menace, j’ai très peur, ça ne va pas du tout. S’il vous plaît, est-ce que vous pouvez me prendre et me déposer n’importe où, absolument n’importe où ? »
C’était quitte ou double, il fallait que je sois ferme sans non plus leur faire peur. Il se trouve qu’ils ont compris. J’ai couru chercher mon sac dans la voiture du légionnaire, je lui ai expliqué que j’avais trouvé des gens qui m’emmenaient à Paris et je lui ai dit au revoir et merci comme si de rien n’était. Ils m’ont laissé à la Porte d’Italie. C’était merveilleux d’être debout sur le pont du périphérique et de regarder les voitures filer.
Après, je n’ai plus jamais refait du stop avec la même naïveté. Dans les stations services, au moment de m’adresser à vous, je dois reconnaître que j’opère désormais une forme de sélection.
*
Illustration de vignette : détail de « Four lane road », par Edward Hopper
*
Episodes précédents
L’auto-stop est un sport de combat (1)
L’auto-stop est un sport de combat (2)