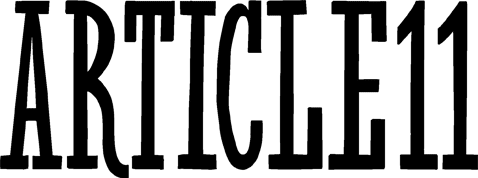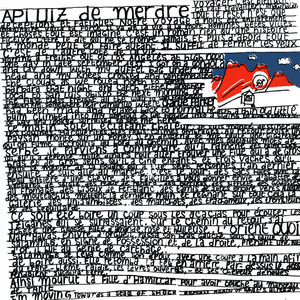mercredi 29 mai 2013
Entretiens
posté à 17h02, par
2 commentaires
Un bail qu’on n’a plus parlé musique sur Article11, et c’est bien dommage : après tout, c’est sans doute la seule chose valable en ce bas-monde (avec le Chardonnay). La pénurie de mélodies se faisant par trop criante, on a toqué à la porte des Potagers Natures, label bordelais siphonné qui mitonne d’étrange et fascinantes tambouilles sonores depuis déjà treize ans.
Les Potagers Natures. Un nom étrange pour un label qui ne l’est pas moins. 57 disques au compteur et pas un seul qui flirte avec le train-train musical. Il y a la puissance brute du noise d’ Headwar, les structures mélodiques affutées de Chocolat Billy, les provocations paillardes d’X-OR, le tango-punk de Radikal Satan... Yep, l’enseigne Potagers Natures attire et enregistre des frappadingues de tous horizons – un genre de mission sacrée.
Comme tout bon micro-label qui se respecte, les Potagers fonctionnent sans assise financière ni plan de développement, à l’arrache. Treize ans qu’ils sortent des disques et organisent des concerts à Bordeaux, à leur manière, sans se presser, sans thunes. Surtout, les Potagers fonctionnent en très petit comité : il y a Yann, le fondateur, qui gère le gros du boulot. Et quelques autres qui mettent la main à la pâte à l’occasion. Parmi ceux-ci, Enrique, qui fait également de la musique avec Yann – au sein d’Api Uiz, trio frappa-noise (Yann à la guitare, Enrique à la basse et le frère de ce dernier à la batterie).
Pour cet entretien, on s’est posés dans un troquet de Montreuil. Yann et Enrique sortaient de répète. On a descendu des bières en causant de leurs activités musicales et de ses soubassements politiques. C’était animé : ces deux-là s’y connaissent pour se renvoyer la balle. C’est d’ailleurs la beauté et le côté fragile de leur association : au fil du temps, ils ont évolué différemment. L’un (Enrique) a trouvé un boulot fixe tandis que l’autre (Yann) continue à tout centrer sur la musique. Mais leur attelage tient encore la route. Et il trouvent toujours plaisir à faire vivre Api Uiz et les Potagers Natures, ainsi qu’à causer musique et pratiques concrètes.
*
Comment sont nés les Potagers Natures ?
E : Vers 1999, Yann a pris l’initiative de rassembler des enregistrements qu’il avait sous la main, réalisés par des gens qui nous entouraient. La qualité des enregistrements importait peu – il y avait même des cassettes. En piochant dans cette matière première, il a commencé à fabriqué des compiles CD-R, avec juste le nom et les références du groupe.
Y : C’était du fait-main, en très peu d’exemplaires. Il y avait un côté archivage ; je n’y réfléchissais pas vraiment. Et je les distribuais sous l’étiquette Les Potagers Nature.
Ce n’est pas moi qui ai trouvé le nom. À l’époque personne n’avait d’ordinateur, à part un pote. Je faisais donc tout avec lui : couper les pistes, faire une introduction, un montage rapide etc... C’est lui qui a proposé d’appeler ça Les Potagers Natures. Ça m’a plu.
E : J’ai aussi souvenir que Yann fabriquait une feuille d’infos, avec des textes anonymes. Une sorte de fanzine format A4 avec des découpages, des collages. Il en distribuait plusieurs dizaines pendant les concerts.
Y : Oui, on écrivait des saloperies...
E : C’était alors surtout dirigé contre Juppé, parce qu’il venait d’arriver à la mairie. Une catastrophe...
Et Api Uiz, à cette époque ?
Y : On apprenait à jouer. Mais il y avait déjà de véritables opportunités pour jouer à Bordeaux. Parce que la scène était dynamique. On pouvait se produire de façon régulière dans différents endroits sans même avoir de démo ou d’enregistrement à proposer.
On a aussi été influencés par des gens qui nous entouraient et nous motivaient. Par exemple, l’arrivée à Bordeaux du groupe Cheval de Frise – un duo guitare-batterie - a été importante pour nous. Fréquenter des gens produisant une musique d’une telle qualité ne peut que te donner envie de faire des choses.
C’est à peu près au moment de la sortie de notre vinyle, cinq ans après qu’on ait commencé à jouer, que s’est mise en place à Bordeaux une scène punk-hardcore qui faisait un peu redécouvrir le Do It Yourself (si on peut l’appeler comme ça) : autonomie au niveau de la production, de l’enregistrement et de la distribution des disques.
E : Au début, on a tenté de trouver un label pour éditer notre premier disque. Mais aucun n’en voulait. On pensait à Vicious Circle1, qui était censé être la voie normale pour les groupes de rock du coin avec l’étiquette un peu indé.
Y : Sauf qu’on s’est vite rendus compte qu’il y avait un énorme décalage avec nous, qu’ils ne vivaient pas sur la même planète.
E : Puis on a entendu parler du pressage en République-Tchèque : on pouvait faire fabriquer le disque pour pas grand chose. Alors nous nous sommes dit qu’il fallait foncer : nous en avons produit 100 exemplaires.
Comme on trouvait naturel qu’il y ait un label derrière, nous avons choisi d’y accoler celui des Potagers Natures. Mais le fric venait uniquement de nous deux : nous comptions nous rembourser en vendant les disques. Le prix de revient était de quatre euros – on le vendait à sept.
Y : C’est ensuite, avec le recul, qu’on a compris que ce n’était pas anodin. Mais au départ, on voulait simplement mettre les morceaux en boîte pour passer à autre chose. C’était vraiment histoire de dire, hop, c’est fait, on peut tourner la page et redémarrer.
E : Comme nous n’avions pas du tout réfléchi à la diffusion, nous nous sommes retrouvés avec une centaine de vinyles qu’on filait aux copains. On essayait aussi d’aller en déposer chez le petit disquaire du coin.
Y : Ce n’est pas si facile : tu t’imagines que ça va partir très vite, mais au final tu n’en vends aucun. Tu apprends ainsi, sur le tas.
E : Une fois ce disque sorti, Yann a continué à réaliser des compiles de groupes de Bordeaux qu’il aimait mais qui ne sortaient jamais de disques. Ça s’appelait Recensement d’une musique populaire.
L’idée de départ ? Archiver l’effervescence musicale de cette ville, surtout les groupes qui jouaient toujours en première partie. On leur proposait de cotiser un peu. Comme chacun y mettait du sien, on arrivait très facilement à réunir le budget suffisant pour presser un disque. Chaque groupe récupérait le nombre de vinyles correspondant à son investissement et le distribuait lui-même.
Y : On était environnés d’une production musicale hyper intéressante – à notre goût, en tout cas. Il nous semblait qu’il fallait absolument en rendre compte, puisque personne ne le faisait.
E : Je pense que prévaut chez beaucoup de gens cette idée que la musique se doit d’être suffisamment aboutie avant que de la passer sur vinyle. Nous, on s’en fichait ; parmi ce que nous faisions presser, il y avait beaucoup de choses bancales, mal enregistrées, de sons pourris.
Y : Sortir un disque n’est pas une fin en soi ; ça permet juste d’imprimer un moment donné. Quand je réécoute aujourd’hui des vieux morceaux, je me replonge immédiatement dans l’ambiance de l’époque. Le contexte est très important - le rapport humain, romantique, amoureux, sentimental, le voyage... Tout ça relève de la mémoire.
Tout à l’heure, vous faisiez référence à la musique populaire. C’est en opposition à une musique qui serait savante ?
E : C’est une question que nous nous sommes beaucoup posé à l’époque ; tout le monde n’était pas d’accord. Pour moi ça faisait référence à une lecture marquante : Asphyxiante culture, de Jean Dubuffet. J’aimais cette idée d’une culture accessible, sans élites. Dubuffet voyait l’art comme quelque chose d’horizontal. Ça nous parlait d’autant plus que nous découvrions alors l’art brut – on répétait d’ailleurs à côté du musée d’art brut de Bègles.
Avant cela, on n’avait pas trop réfléchi à ce que pouvait être une culture de masse, une culture populaire. En découvrant ces idées qui pour nous étaient nouvelles, on essayait de comprendre où on se situait.
Y : Quand on utilisait cette notion de « culture populaire », c’était surtout pour affirmer que la musique devrait être une chose naturelle, un acte simple qui ne demande pas forcément une technique musicale particulière.
E : Ça va dans le sens de l’art brut : c’est pas parce que tu n’as pas de maîtrise technique que tu ne peux pas avoir une pratique artistique intéressante.
À l’époque, on ne se projetait pas dans un cadre professionnel, on ne pensait pas à la musique comme à un emploi. Nous portions simplement une vision critique du rock-business et de ses grands groupes. De notre côté, nous ne demandions rien a personne. Et même s’il y avait des défauts dans la musique, on s’en fichait : on jouait quand même.
Après 57 disques sortis aux Potagers Natures, vous suivez toujours cette impulsion de départ ?
Y : Ce qui est sûr, c’est qu’on ne se restreint pas, qu’on ne se limite pas à la sortie de productions bien calibrées. En fait, on se permet encore beaucoup de liberté au niveau de l’édition du disque.
On a récemment pressé X-OR, un disque de chansons paillardes. Il y a un travail intéressant sur les textes, autour de la caricature, un peu à la Didier Super – pour faire court – mais tout à fait pertinent. Et peu de temps après, on a sorti un disque de l’Ocelle Mare, qui fait une musique qu’on pourrait appeler savante, très intellectuelle.
Le catalogue comprend ainsi des disques très différents - ça nous va tout à fait, et on va continuer comme ça. Mais on est quand même plus sélectifs qu’au début du label. A l’origine, nous voulions l’ouvrir à toute personne souhaitant sortir un disque, sans sélection, en faisant confiance. Mais ça a parfois pris des tournures qui nous échappaient un peu. Nous avons donc décidé de recentrer un petit peu : nous sommes désormais plus réfléchis.
E : Et nous avons aussi monté notre niveau d’exigence en ce qui concerne le travail sur le son, le mix, le produit final.
Y : Par contre, on a conservé un impératif fondamental : ne surtout pas enfermer les disques des Potagers Natures dans un style musical donné.
Personnellement, je n’oublierai jamais combien le fait découvrir des trucs tels que les Béruriers Noirs via Bondage Record a été important : ça m’a littéralement boosté. Dans cette scène française des années 1980, tous les groupes avaient une couleur différente : les VRP, les Wampas, les Washington Dead Cats, Les Bérus, Les Négresses Vertes, les Happy Drivers... A l’époque, certains sont plus ou moins influencés par les disques des autres, s’aiment ou se détestent, ont plus ou moins de succès, etc., mais ce ne sont jamais des clones les uns des autres. Bondage était un très bon exemple en matière d’ouverture.
C’était très important. Te forger une éducation musicale par l’intermédiaire de ces groupes représentait un véritable parcours qui t’amenait à écouter des trucs presque à tes dépends. Par exemple, j’étais en troisième quand j’ai découvert les Négresses Vertes, et j’ai acheté la cassette en pensant que c’était du punk... D’une certaine manière, c’était vrai, puisqu’ils étaient dans une démarche d’autonomie. De même avec les VRP. En voulant écouter du punk, je me suis ainsi retrouvé à découvrir plein de choses différentes.
Les gens que vous enregistrez sont forcément des amis ?
Y : Pas toujours. Quand on a sorti le France, il n’y avait pas d’affinités de départ, on ne connaissait pas ces gens. Je suis tombé sur un catalogue réunissant tous leurs morceaux et j’ai découvert cette piste qui, à mon avis, est vraiment un chef d’œuvre.
Vous vous considérez comme un label ?
E : Au début, ça ne nous serait jamais venu à l’idée de nous qualifier ainsi. On utilisait le terme « pseudo-label », pour nous démarquer. De même, on ne disait jamais « je travaille sur un disque » ou « je travaille sur un mix », c’était inconcevable. Ce jargon ne nous allait pas. Mais ça a changé : au fil du temps, on s’est mis à utiliser ce langage.
A l’inverse, on n’a plus trop recours à ces notions de musique savante et musique populaire qu’on utilisait à l’époque. Aujourd’hui, on préfère parler de pratique professionnelle ou amateur.
Il me semble en effet que pour des gens qui passent beaucoup de temps à faire de la musique et qui connaissent très bien leur instrument, la distinction entre savant et populaire n’a plus trop de sens. Alors, peut-être que la notion d’approche populaire serait plus adaptée pour désigner des gens qui jouent dans le milieu punk, avec une musique très codifiée, qui continuer à réhabilite une tradition populaire au fil des années. Cette musique n’aspire pas forcément à évoluer, à se transformer, mais à faire perdurer des codes : c’est peut-être ce qui en fait une pratique populaire.
Y : En revanche, un problème de cette scène punk-hardcore tient à mon sens dans la contradiction entre des aspirations émancipatrices et libertaires et la reproduction de schéma vus et revus. Que ce soit en terme de conception de la musique ou dans l’esthétique en général - par exemple, dans la manière de s’habiller.
Et pourtant, les « outils » que vous utilisez, ceux qu’on rattache à l’expression Do It Yourself, sont nés avec le punk, non ?
Y : Pour être franc, le terme DIY a fini par m’insupporter. Je n’en peux plus de le voir utilisé à toutes les sauces. Et puis, cette pratique existait bien avant que ce terme ne lui soit accolé. Cette espèce d’autonomie par rapport à ce que tu fais, c’est en fait quelque chose qui perdure depuis la nuit des temps.
Le pire, c’est qu’on a l’impression que le terme se restreint de plus en plus à un style de musique, et non plus une manière de faire plus générale.
Mais est-ce que dans la musique en général, et dans les labels en particuliers, la plupart des « outils » d’autonomie ne sont pas nés au début du mouvement punk ?
E : Côté musique, je retiens surtout une initiative comme Bondage Production, qui date des années 1980. Les gens qui étaient derrière ont développé des pratiques autonomes pour monter leur propre label, avec les Bérus et tout ce qui s’ensuit.
De toute manière, nous ne nous sommes pas vraiment inspiré d’exemples particuliers. C’est beaucoup plus simple que ça. Il n’y avait pas franchement de « programme politique », on avait juste envie de faire des trucs que personne ne nous avait demandé de faire et d’être le plus autonomes possible. Juste parce que c’est génial de pouvoir organiser un concert par toi-même.
Y : En même temps, ça naît aussi d’un contexte. Un contexte dans lequel tu te sens étranger au fonctionnement marchand, dans lequel tu t’aperçois que d’autres personnes sont dans le même cas et qu’elles ont trouvé ce type de solution. Nous n’avons rien inventé, simplement adapté à notre sauce en trouvant des équilibres.
Quand Goscinny a créé son journal, c’était en opposition à toutes les maisons d’édition. Il a pris les choses en main parce qu’il n’arrêtait pas de se faire virer. Comme Hitchcock qui assez vite a décidé de faire de l’auto-production, ce qui lui permettait de garder la mainmise sur tout la fabrication du film.
Financièrement, comment fonctionne les Potagers Natures ?
Y : De façon très simple. On sort un disque, et l’argent récupéré est réutilisé pour un autre disque. Cela marche plus ou moins. En ce moment, nous sortons deux-trois disques par an. Et nous passons aussi par des collaborations - dans ce cas, plusieurs labels réunissent ensemble un peu d’argent pour sortir un disque. Ça fonctionne bien et ça permet de mieux distribuer le disque.
Et combien de personnes participent à la structure ?
E : Yann a toujours été le plus impliqué, et un certain nombre de gens participent à l’occasion. Certains sont même venus habiter Bordeaux et ont fait de la musique avec nous, et puis sont finalement repartis. C’est variable.
Y : C’est l’organisation de concerts qui nous prend le plus de temps - pour cela, on est plus nombreux. Côté label, par contre, le plus gros du travail est aujourd’hui effectué par moi, ainsi qu’un peu par Enrique.
E : Mais sortir un disque n’implique pas forcément une débauche de travail de notre part. Souvent, ce sont les groupes eux-mêmes qui font pratiquement tout : le mastering, la pochette, contacter le fabricant du disque...
Vous n’avez jamais pensé à vivre des Potagers Natures, voire d’Api Uiz ?
Y : Pour vivre d’un groupe, il faut faire beaucoup de concerts. Et qui dit beaucoup de concerts dit beaucoup de tensions au sein d’un groupe – souvent, ça casse vite. On essaie de faire le contraire. De préserver le groupe.
En ce qui concerne le label, c’est plus compliqué. Bondage, par exemple, vendait beaucoup de disques. Et il fallait un type pour gérer tout ça, quelqu’un qui n’était pas musicien – Marsu en l’occurrence. De notre côté, nous sommes avant tout des musiciens. Si j’aime bien l’idée de l’archivage, ça reste une occupation secondaire. Et vendre des disques n’est pas ma vocation première.
E : De toute façon, nos méthodes de fonctionnement ne nous permettent pas une pérennisation financière. On a compris ça au fil des années et des périodes de tension...
Y : Il y en eu un sacré paquet...
E : Mais si on fait le bilan, douze ans plus tard, on voit bien que ça n’aurait pas pu être viable économiquement. Pas avec nos manières de faire. C’est fragile, c’est comme ça.
Y : Et c’est sans doute pas plus mal qu’on n’ait pas réussi à garantir une stabilité financière. Il aurait fallu mettre trop de choses de côté. Faire des trucs qui ne nous plaisent pas.
E : Mais le fric n’est plus une donnée qu’on néglige. Contrairement aux débuts du label : l’argent n’était alors pas du tout un paramètre important. On se demandait juste : « Comment faire pour que les parents nous filent assez de fric pour sortir un disque ? » On a changé d’univers à ce niveau.
Par exemple, nous essayons depuis quelques années de donner une petite participation à la plupart des gens qui travaillent sur un disque, surtout si ça représente un investissement en temps important. Ce qui est notamment le cas du mixage.
À une époque, ce n’était pas envisageable. Et ça nous aurait semblé saugrenu d’avoir des relations d’argent (aussi bénignes soient-elles). Ça a changé. Yann, tu disais récemment que tu méritais une rémunération parce que tu passais beaucoup de temps à vendre des disques. Et ce n’est pas absurde. Mais ça peut entrer en contradiction avec nos manières de fonctionner et dénaturer nos activités.
Y : Si je suis payé 150 € pour jouer aux Instants Chavirés, ce sera toujours moins d’heures passées à faire des sondage pour Ipsos. Parce que je fais ce taf de merde à côté. Et 150 euros, ça correspond à peu près à 15 heures de travail chez Ipsos. Du coup, je remplace ces quinze heures perdues par deux jours de répète. En clair : gagner de l’argent par la musique permet de faire plus de musique. On est quelques uns dans cette situation, avec des boulots nazes ; seul Enrique a un poste stable.
Vous avez déclaré il y a un petit moment : « Édition de disque, programmation de concerts et réflexion politique ont le même degré d’importance. Ils participent de la même dynamique qui est d’ouvrir par nous même notre propre espace d’expression multiple. » Vous le pensez toujours ?
E : Il y a beaucoup de choses qu’on faisait de manière spontanée au début. Et l’expérience est venue confirmer qu’on avait raison de procéder ainsi.
À Bordeaux, au bout d’un moment, on est vraiment entrés en opposition avec une tradition rock un peu con, au ras des pâquerettes, tenant un discours centré sur la fête, le divertissement superficiel, le spectacle. Hors cela, l’unique ambition était de monter faire des concerts à Paris et de produire des disques. La plupart des soi disant experts du rock en sont encore là. Les articles sur le rock local de Florent Mazzoleni, par exemple, sont des platitudes grossières qui cachent à peine une volonté de promouvoir la marque Bordeaux, métropole attractive, et donc compétitive.
Dans les années 1990, quelques groupes du coin ont chopé une petite notoriété. Et certains ont adopté une attitude de m’as-tu-vu. On s’est assez vite sentis un peu marginaux, parce que ce n’était pas notre ambition ; on ne rêvait pas d’être chroniqués dans des magazines insipides bourrés de pubs...
Le pire, c’est quand a été créée cette école de rock de Bordeaux, la Rock School Barbey. C’était concomitant à l’arrivée de Juppé : tu as ce mec profondément de droite qui arrive dans ta mairie, une mairie à droite depuis 1945, tu en as ras le cul, t’as des problèmes en permanence parce que tu peux pas jouer tard, les endroits ferment etc. ; et là, voilà un espèce de gros centre mégalo qui fait son apparition et qui s’appelle même pas « école de rock » mais « rock school ». Wahou... Et toute une partie des groupes de Bordeaux voyaient comme une consécration le fait de se produire en première partie de « grands » groupes dans cet endroit. Sans parler de la vulgaire récupération lors d’évènements comme « Bordeaux Rock ». On s’est vraiment construit en opposition à tout ça.
À l’époque, je lisais Le Monde Diplo et je commençais à découvrir des travaux qui m’incitaient à écrire sur ce milieu rock. C’était assez vindicatif. Et quand je suis arrivé à Paris, j’ai découvert des journaux comme PLPL. Bref, je voyais qu’il y avait dans le journalisme des gens qui critiquaient leur propre milieu. Et il me semblait évident que c’était d’abord aux gens d’un milieu donné de faire émerger une critique sur ce même milieu. Parce que c’est les mieux placés. De même que je ne me vois pas critiquer la sociologie, il y a peu de chances que la sociologie se mettre à critiquer la scène rock.
Je me disais : pourquoi tout est plat dans la presse musicale ? Pourquoi chaque fois qu’il y a un article de musique c’est sur les chaussures que tu portes, le fait que tu sois super rock & roll et que t’aies eu deux dates à Paris ou à Londres ? Je trouvais ça tout sauf constructif. En réponse, l’idée a été de tenter une critique plus subtile. Par exemple, il me semblait important de rappeler que la notoriété n’est pas le but ultime. Que la consécration ne consiste pas à jouer dans une grosse salle avec des gros groupes, mais plutôt de faire vivre une scène, de faire de la musique de manière cohérente.
Tout ça a évolué. Au fil du temps, quand des gens se sont greffés aux Potagers, le « on » que j’utilisais dans les textes a commencé à poser problème. Tout le monde n’était pas d’accord. Et le fait de publier des textes agressifs sur la scène locale, posait des problèmes.
Quand on a répondu à la proposition d’entretien de JC Menu pour Eprouvettes, par exemple, ça s’est mal passé. Après coup, beaucoup de nos amis se sont vexés. On ne l’avait pas joué assez collectif.
Y : Et ils avaient raison de ne pas être contents. Ça a fait ressortir quelque chose qui était un peu dans le flou. Notamment le fait qu’il est difficile de faire parler d’une seule voix un collectif tel que celui-ci.
E : Personnellement, je m’étais dit à cette occasion que ce serait bien de reposer une dernière fois « les bases politiques ». D’autant que cette dimension était de plus en plus reniée par beaucoup de gens dans notre entourage.
En tout cas, il y a eu un gros clash à cette époque-là. Il y avait une vingtaine de personnes qui gravitaient autour des Potagers, dans l’organisation de concerts, le mixage des albums, et certains se sont montrés assez vindicatifs.
Bref, il y a eu un moment où on a fini par décider qu’on ne mettrait plus de textes politiques sur le site, que c’était fini. Et c’est vrai que ce « on » était un peu péremptoire, un peu gênant. Peut-être aussi que sur la longueur on s’est dit qu’il n’y avait plus besoin de tant expliciter les choses, qu’elles existaient de manière implicite. Qu’il n’y avait pas forcément besoin de sortir des grandes théories post-situationnistes pour valider ce qu’on faisait spontanément.
Il y a un essoufflement, après tant de temps à jouer de la musique ensemble ?
Y : Les premières années, il y a quelque chose de nouveau, d’assez frais : le rapport au plaisir est plus simple et plus direct. T’es heureux de faire de la musique. Mais c’est plus laborieux quand tu fais ça tout le temps et que tu approches la quarantaine. Il te faut plus de rigueur pour garder cette fraicheur. Pour aller en répétition, il faut parfois se foutre des coups de pied au cul.
C’est aussi le cas pour les concerts ou les tournée : ça devient vite laborieux. Parfois je me dis que je préférerais être avec mon fils que, par exemple, tourner en Espagne avec le groupe. Quand on avait vingt ans, c’était différent : on n’avait que ça à foutre. Sur une semaine, je passais quatre jours à répéter.

- Api Uiz en concert
Avec Api Uiz, on joue des morceaux de plus en plus alambiqués, de plus en plus ambitieux, notamment en matière de composition. Il faut suivre, tenir la corde. Dans ces conditions, tout se paye, notamment le temps passé à ne pas jouer, à ne pas écouter, à ne pas y penser. Au départ, c’était plus intuitif, on n’intellectualisait pas : on jouait de la musique parce que c’était le seul truc qui nous plaisait.
Autre sujet : le micro-label Mon Cul c’est du tofu met tous les morceaux en téléchargement libre. Et vous ?
Y : Sauf exception rare, nous avons toujours choisi de mettre les albums en téléchargement gratuit sur le site. On a commencé à le faire très tôt. Sachant que notre distribution est très artisanale, c’est un bon moyen que la musique soit écoutée.
E : On part de l’idée que les gens qui viennent sur le site connaissent ce qu’on fait. Et que ce n’est pas le fait de nous écouter sur Internet qui les empêchera d’acheter le disque. Ce que montrent la plupart des études.
Je me souviens d’une tribune ridicule publiée il y a un certain temps par les labels bordels bordelais. Ils affirmaient que le téléchargement libre remettait en question leur existence, ce type de baratin. Ce discours nous paraissait (et nous paraît encore) complètement à côté de la plaque.
Cette présence sur Internet se répercute dans l’affluence aux concerts ?
Y : C’est difficile à savoir. Parce que l’affluence dépend déjà de la manière dont le concert est organisé, de l’horaire, de la date, etc.
Par contre, il y a peut être un autre phénomène à prendre en compte : à force de télécharger, certains ont tendance à rester devant leur ordinateurs. Dans ces conditions, le fait de sortir voir un concert devient moins évident.
E : Autre point important : à force de télécharger, on finit par ne plus tout écouter. Ça prend du temps de vraiment écouter une musique, et quand tout s’amasse sur ton ordi...
Y : Oui, c’est à double tranchant. D’un côté, il y a cet espèce de fantasme de la consommation absolue, d’avoir accès à tout. De l’autre, il y a une espèce de déception : tu n’écoutes pas vraiment, ou pas de la même manière.
Est-ce que ça ne suit pas un processus déjà entamé avec le passage du vinyle au CD ?
Y : C’est sûr qu’avec le CD, tu gagnais quelque chose qu’il n’y avait pas dans le vinyle, et vice-versa. Le CD n’offrait pas seulement la possibilité d’avoir des plages de musique de 60 minutes sans devoir tourner une face, il était également plus fiable à produire. Un pressage de vinyle se rate souvent, ce n’est pas le cas d’un CD. Par contre, tu n’as pas le grain du vinyle.
Pour en revenir à Internet, les transformations ne concernent pas que l’aspect diffusion. Il y a aussi l’explosion de tous les outils d’enregistrement chez soi, l’informatique qui s’améliore. Tu peux faire un enregistrement de bonne qualité sans devoir passer par des studios. Ça offre une profusion d’expression artistiques originales. On voyait déjà ça dans les années 1970, avec l’explosion du punk, quand plein de gens se sont emparés de l’instrument et de la scène pour s’exprimer de manière originale. Beaucoup de groupes qui n’avaient pas appris à jouer proposaient des choses intéressantes. Mais ça s’est essoufflé. C’est pareil aujourd’hui : il y une forme d’uniformisation. Tout le monde peut enregistrer, tout le monde a accès à une multitude d’influences, mais tout le monde fait la même chose. La qualité d’expression musicale ne suit pas. Il y a un paradoxe. L’outil est là, mais pas le reste.
Vous vous revendiquez d’une musique populaire. Et en même temps vous appartenez à un courant plus ou moins « noise », qui a un côté peu accessible pour les profanes.
E : La musique populaire n’est pas forcément liée à un phénomène de masse, de consensus. Pour nous, s’en revendiquer revenait à dire : on n’a pas eu de cours de solfèges, on a juste pris une guitare, et on fait des trucs avec nos moyens, dans nos apparts.
Ceci dit, j’ai récemment discuté de cette question avec un ami musicien, Arnaud Rivière, qui fait une musique concrète assez extrême. Or, quand tu parles de musique bruitiste ou de musique concrète, ce n’est pas censé être une musique dite populaire. Et pourtant, quand on a fait une tournée avec lui en Espagne l’année dernière, je me suis rendu compte que nous qui étions catalogué rock avions un certain nombre de codes à respecter pour pouvoir être compris et appréciés, davantage qu’Arnaud Rivière. Lui suscitait l’intérêt plus facilement, plus simplement que nous. Tu pouvais n’avoir jamais écouté ce type de musique et être interpellé par les sons, les bruitages. Ça m’a semblé paradoxal. Et je me suis dit que lui faisait de la musique populaire, au sens d’accessible. Qu’il pouvait par exemple débarquer dans une école et faire réagir les gamins. Et que ce n’était pas forcément notre cas. Une question à creuser.
*
En rapport sur A11 :
Entretien avec Fantazio : « Ce qui m’intéresse, ce sont les formes bâtardes »
Des images vagues aux idées claires - Entretien avec les Wave Pictures
Entretien avec Loran, des Bérus : « Les politiciens font tout pour annihiler dès la naissance le germe de l’insoumission. »