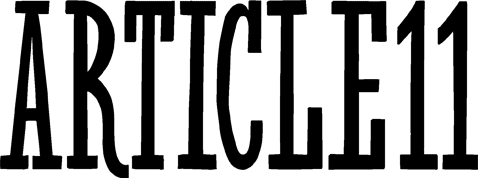mardi 3 septembre 2013
Sur le terrain
posté à 18h12, par
4 commentaires
Augustin Marcader est technicien administratif au contrôle médical d’une Caisse primaire. Des années qu’il turbine là, chez les poulagas de la Sécu. « Souffrance » au « travail », la redondance l’a toujours fait marrer. Parfois même, elle l’inspire. Cette fois-ci, il est question de cette frousse normée, imposée, qui infiltre jusqu’aux murs de la cantoche...
Cette chronique a été publiée dans le numéro 12 de la version papier d’Article11
*
C’est au coin-repas que j’ai réalisé que nous étions cernés. Levant les yeux de mes pâtes au pesto et au parmesan, je fixais pour la centième fois cette idiote figée en plein grattage d’occiput face à une question existentielle : « C’est quoi, un bon mot de passe ? » Le sous-titre de l’affiche rappelait que le mot de passe est un « élément essentiel pour sécuriser l’info ». À côté, une autre pancarte surplombait le four à micro-ondes, indiquant le numéro d’urgence à composer pour joindre le service d’écoute, de soutien et d’accompagnement psychologique de « Psya », cabinet spécialisé en prévention et gestion des risques psychosociaux. J’interrompis ma mastication pour dire aux collègues : « Vous avez remarqué ? Toutes les affiches du coin-repas ont un rapport avec la peur. » Des preuves supplémentaires ? Sur un autre mur, un placard pondu par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie nous mettait en garde sur le fait que nous passions « 80 % de notre temps dans des locaux fermés où l’air est plus pollué qu’à l’extérieur ». Et d’inviter les salariés de la Sécu à aérer et climatiser régulièrement leur burlingue pour en assainir l’air.
Mes collègues accueillirent ma remarque avec un intérêt plutôt tiède. Tout ça frôlait l’indifférence. Ou la lassitude. Remplissant un verre d’eau, je restai à nouveau perplexe devant cette autre affiche au-dessus du lavabo, vestige de l’épidémie de feue la grippe H5N1, listant « les gestes simples pour limiter les risques de transmission » du virus.
La trouille, encore.
Depuis quelques années, la peur est devenue un élément incontournable de notre environnement professionnel. Au niveau institutionnel, c’est tout l’encadrement qui nous serine à longueur de réunions que si nous ne redoublons pas d’efforts dans nos missions de service public, c’est notre beau système de solidarité nationale qui va boire le bouillon ; et le privé nous bouffera tout cru. Peu importe, en passant, que nos dites missions de service public finissent, à force de gangrène néolibérale, par accélérer le sabordage d’une Sécu que nous sommes censés sauver du naufrage. L’anxieux, m’avait un jour expliqué un ami psychiatre, est celui qui, au fond du trou, creuse avec l’énergie du désespoir pour espérer s’en sortir.
Dans les contrôles médicaux, organes d’un flicage aussi démesuré qu’imbécile, nous creusons donc, pour combler un déficit qui sans cesse grandit, sorte d’insatiable trou noir, de béance d’antimatière bectant tout ce qui passe à sa portée. Encore aurions-nous pu creuser tous en cœur, harmonisant nos coups de pelle et gueulant quelque cantique à la manière des forçats d’un autre âge. Même pas ! Nos trous sont devenus des affaires individuelles, résultat d’un management pensé pour atomiser le tissu social d’une vie de bureau. Démarche qualité, sécurisation des données, secret médical, respect des échéances, reporting : le quotidien d’un salarié de la Sécu est noyé sous un fatras de recommandations, de pratiques et de mises en garde qui le maintiennent dans un état d’isolement et d’insécurité permanents. Multiplication des mots de passe, des codes d’accès (trois codes pour interroger ma messagerie téléphonique !) et des cartes magnétiques, exercices d’alerte incendie, vigile au bas de l’immeuble, c’est avec une inlassable application qu’on nous pique le cul à coups d’aiguillons anxiogènes, histoire de rappeler que le danger, l’usurpation1 ou la menace peut survenir de partout.
Une telle idéologie finit forcément par attaquer les bases fragiles de toute vie sociale. « Si vous avez un problème, Augustin, m’avait lancé le responsable de service Gourmet à mon arrivée dans le service, sachez que ma porte est toujours ouverte. » C’était il y a plus de dix ans. À cette époque pas si lointaine, les gens travaillaient la porte du bureau ouverte. Les couloirs bruissaient du clapotis des claviers, de crachats d’imprimante, de bribes de conversation. Bref, la vie, même médiocre, même monotone, transpirait des bureaux. Légèrement fanfaron, j’avais alors milité pour une pause-café collective, histoire que nous causions un peu entre collègues. Las, l’idée n’avait pas plu au Pendule (un escogriffe à la démarche « pendulaire », sous-fifre zélé de Gourmet – parti à la retraite depuis) et je m’étais fait couper les jarrets en plein élan. À la niche, Augustin !
Et puis, à la manière d’un frêle cumulus venant voiler le soleil, les portes des bureaux se sont fermées. Une à une. On prétextait les courants d’air, le besoin de concentration, quand il s’agissait en fait de lentement démembrer notre petit corps social. Et aujourd’hui, l’isolement est quasi-total. Résultat : on ne sait plus ce qui se passe dans le bureau du voisin. Quand on lui rend visite pour taxer quelques enveloppes ou une dosette de café, on évite de trop traîner ; les yeux sont partout et on sait les langues qui vont avec. Au petit règne du chacun chez soi s’est greffé celui du chacun pour soi.
Ce n’est pas méchant, vous diront les gens, juste une question d’adaptation. Et puis quoi, comme le noterait notre fin analyste, ce bon docteur Létrille : « On n’est pas chez les Bisounours, ici ! »
Le paradis des Bisounours ? Même le plus perché des normopathes reconnaîtrait que nous n’en avons jamais été aussi éloignés. Détail révélateur : le verrouillage électronique installé sur les portes de notre commandement local. Car non seulement les lourdes de Gourmet et consorts sont désormais fermées, mais elles ne s’ouvrent plus que par le biais d’un badge. Ces mesures de sécurité, ridiculement draconiennes, ont fait suite à un petit débordement advenu il y a quelques années. Je le revois encore, cet assuré social : tête rasée, cou de taureau, des battoirs comme des cuisses de bœuf. Le type était sorti de l’espace dévolu à l’accueil pour pénétrer - ô infraction suprême ! - dans les parties réservées au staff only, avant de poser son cul tout plein d’inertie sur le lino du couloir. « Je ne bougerai pas tant que je n’aurai pas été vu par le médecin-chef. »
On aurait dit le renard dans le poulailler... Je les revois, les plus courageux de mes collègues, risquer leur tête par l’entrebâillement de leur porte comme autant de coucous pointant leur bec hors du nid, et toiser avec angoisse cette irruption de chair exogène. Et moi qui passais par là. Le hasard. Qui entends les commentaires outrés, inquiets. Qu’est-ce qu’il fout là, lui ? Il n’a pas le droit d’être ici. Faut appeler la police ! J’ai hésité, puis je me suis assis par terre, à côté du monsieur. Je l’ai salué. Il m’a dit qu’il ne bougerait pas, qu’il avait une tumeur au cerveau et qu’il voulait qu’on s’occupe de son dossier. J’ai dit que je comprenais et que j’allais attendre avec lui, des fois que les flics… Les flics, il s’en foutait ! Qu’ils viennent ! On est restés un moment, assis dans le couloir, sans rien dire. Dans mon dos, à force de palabres, et peut-être de rappels aux fondamentaux du service au public, ils ont finalement convaincu le médecin-chef de le recevoir. Reçu, écouté et conseillé, l’intrépide assuré a fini par regagner ses pénates. Un vrai agneau. N’empêche, quelques semaines plus tard, des techniciens sont venus sécuriser les bureaux de nos cadres sup. Et en haut lieu, certains se sont permis de saluer mon « courage ». Je leur ai pardonné : on est toujours grotesque en temps de guerre.
***
Épisodes Précédents
1/ Véro
2/ Le Docteur Létrille
3/ Mobilisation
4/ Entretien d’évaluation
5/ Si vous lisez ce mail
6/ Privilèges
7/ Origines
1 Au nom de la lutte (bidon) contre la fraude, les assurés répondant à une convocation sont obligés de montrer une pièce d’identité.