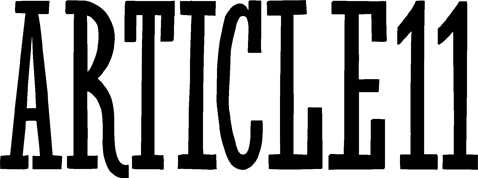Retraité depuis peu mais toujours militant (notamment à la Confédération paysanne), Michel Piel a été producteur de porc pendant trente ans à Saint-Pern, petite commune de Bretagne. D’un élevage hors-sol « conventionnel », il est progressivement passé à un élevage bio en plein air. Itinéraire d’un désengagé du productivisme ; ou comment travailler moins pour vivre et produire mieux.
Comment es-tu devenu producteur de porc ?
Je suis né dans une famille d’agriculteurs, dans la commune où je vis actuellement et où j’ai été paysan pendant trente ans. Je n’étais pas nécessairement destiné à faire ce métier. Mes parents n’avaient qu’une petite exploitation et, dans les années 1970, il était déjà très difficile de trouver une ferme pour s’installer. En 1976, je me suis pourtant lancé en hors-sol1, en complément de la ferme de mes parents : le lisier2 produit par mes cochons était utilisé pour fertiliser leurs terres. Les animaux étaient élevés dans des bâtiments très sophistiqués, et toute leur alimentation provenait de l’extérieur.
Je me considérais à cette époque comme un Ouvrier Spécialisé de l’agroalimentaire. J’appliquais bêtement des règles, un programme... Je me passais par exemple de vétérinaire parce que je connaissais par cœur les antibiotiques et que je savais – à ma manière – comment les utiliser. J’avais la seringue dans une poche et les antibios dans l’autre. À la fin, nous n’arrivions même plus à manger nos propres cochons ; d’une certaine manière, nous étions devenus des empoisonneurs.
« A la fin, nous n’arrivions même plus à manger nos propres cochons ; d’une certaine manière, nous étions devenus des empoisonneurs. »
Ce type d’installation était pourtant prôné par les responsables professionnels, chantres de l’agriculture productiviste. Issus de formations agricoles hypertechniques, nous nous contentions de suivre. Nous sommes donc devenus des producteurs spécialisés, convaincus d’ainsi sauver le métier d’agriculteur. Ce que nous ne savions pas, ou que nous ne voulions pas savoir, c’est que nous étions peu à peu formatés pour travailler dans des conditions de plus en plus industrielles. Sur le moment, cela semblait être un choix ; en fait, nous étions tombés dans un piège.
Un piège dont tu es peu à peu sorti...
Cela a pris du temps. Avant de me mettre à mon compte, j’avais été salarié dans des porcheries de plusieurs centaines de truies. Et il n’était pas question pour moi de travailler dans ces conditions-là. Voilà pourquoi je m’étais installé avec seulement cent truies naisseuses : la partie « naissage » [faire naître les porcelets] est la plus intéressante et la plus technique dans la chaîne du cochon. Par la suite, j’ai investi dans un bâtiment pour engraisser les porcelets, et je suis devenu naisseur-engraisseur, parce que la partie « engraissement » représente peu de travail pour beaucoup de plus-value.
Dans les années 1980, j’ai commencé à douter de cette orientation. Le nombre de personnes travaillant sur la ferme a progressivement augmenté, et nous nous sommes constitués en Gaec3 – avec le renfort de mes deux frères. C’est aussi à cette époque que nous avons cessé de construire des bâtiments en béton, avec caillebotis intégral4. De toute façon, à cause des crises du porc des années 1982-1983, personne ne pouvait plus investir dans ce type d’équipement... Comme les systèmes en plein air demandent dix fois moins d’investissements, nous avons alors augmenté notre effectif de cochons tout en passant à un élevage en extérieur.
Nous étions parmi les premiers à adopter ce système en France. Nous avons cherché à valoriser notre cochon, de meilleure qualité que l’industriel : vu notre situation – à 30 kilomètres de Rennes –, la vente directe s’imposait. Au début des années 1990, nous nous sommes associés à dix autres paysans de la Confédération paysanne : ensemble, nous faisions des volailles, des œufs, du cidre, des produits laitiers... Et bien sûr du porc. L’idée était de commercialiser nos produits autrement, pour en tirer une meilleure plus-value, maintenir notre revenu et - pourquoi pas - créer des emplois.
Nous avons ainsi monté un premier magasin à la ferme. Un bouleversement total. Dans les dix années suivantes, l’exploitation est passée de 160 à 50 truies, de l’agriculture industrielle à l’agriculture biologique, et de trois à huit emplois directs. Parce qu’une agriculture de qualité - soit une alimentation saine pour le consommateur – permet à des hommes de vivre correctement de leur travail.
Dans le système productiviste, l’objectif est de produire du cochon de manière rentable, dans des quantités de plus en plus importantes. Chez nous, c’est différent. Un cochon bio est vendu deux à trois fois plus cher que son pendant industriel, ce qui nous permet de nous y retrouver5. À l’inverse, le cochon industriel s’écoule aujourd’hui - peu ou prou - à 1,45 € du kilo, une somme inférieure aux 1,60 € nécessaires à sa production. Ce n’est pas tenable.
C’est même complétement incohérent...
Le cochon n’est pas une production aidée et soutenue, les cours du porc subissent donc très fortement la loi de l’offre et de la demande. Quand ça va bien, tout le monde fait du cochon – qui arrive en quantité importante sur le marché. Du coup, les prix baissent, et des paysans arrêtent. Ce qui diminue la production. Résultat : les prix augmentent à nouveau. C’est un cercle vicieux...
Nous sommes aujourd’hui confrontés à un système parfaitement aberrant : en cas de crise, ce n’est pas le volume de production – le nombre de cochons sur le marché – qui diminue, mais le nombre de paysans. Ces derniers sont devenus une variable d’ajustement pour le marché. Les élevages ayant investi des sommes considérables il y a vingt ans ne peuvent pas se permettre d’arrêter du jour au lendemain. Ils sont donc souvent repris pour un franc symbolique - par des coopératives, des banques ou le business agroalimentaire. Ils conservent le même mode de production, qui va dans la direction voulue par l’industrie agroalimentaire, mais les hommes sont embauchés en tant que main d’œuvre bon marché, ou tout simplement virés. Sauf qu’un paysan ou un éleveur qui arrête ne touche pas de chômage, n’a droit à rien du tout.
« Les paysans sont devenus une variable d’ajustement pour le marché »
L’endettement, c’est le pire : tu te retrouves pieds et poings liés... C’est la situation de la plupart des producteurs. Ce n’est heureusement pas notre cas : un jeune qui rejoint notre Gaec n’a besoin que d’un capital de 40 à 50 000 euros ; normalement, il lui faudrait dix fois cette somme pour se lancer. Sans compter les terres. Nous n’avons pas obtenu ces résultats facilement : pendant des années nous nous sommes contentés d’un revenu de 500 euros par mois – aujourd’hui, c’est plutôt 1 500. Mais nous sommes obsédés par le fait de mettre nos idéaux en accord avec la réalité, ce qui nous a permis de tenir.
Il ne devait pas y avoir beaucoup de producteurs bio lorsque vous vous êtes lancés, dans les années 1990 ?
Dans un département comme l’Ille-et-Vilaine, ils se comptaient sur les doigts d’une main. Rien d’étonnant : se lancer dans le bio n’est pas si simple. L’alimentation du bétail devant également être bio, cela impose d’assainir des terres usées par des années de productivisme, et notamment par les lisiers qui les ont asphyxiées. Nous avons aussi adapté le nombre d’animaux aux surfaces, et trouvé d’autres solutions pour diminuer nos coûts alimentaires – pour nourrir les cochons, nous utilisons par exemple des pertes de céréales bio destinées au petit-déjeuner des humains. À la ferme, nous recherchons en permanence les produits les moins transformés possibles, de manière à réduire les charges et les coûts directs sur l’alimentation de nos porcs.
C’est là le seul moyen de prendre en considération un problème plus global : la souveraineté alimentaire des populations mondiales. Si nous travaillons au niveau local, départemental ou régional sur des projets agricoles qui nous concernent directement, nous ne devons pas non plus oublier que ces derniers ont des implications plus larges. Si on veut s’en sortir, il faut que chacun puisse manger correctement et suffisamment à l’échelle de la planète. Nos choix pèsent sur la survie d’autres populations.
Un enjeu dont participe l’alimentation des animaux d’élevage ?
La souveraineté alimentaire se base sur un principe simple : tous les peuples devraient pouvoir produire et consommer l’alimentation qu’ils souhaitent et dont ils ont besoin pour vivre. Je vais prendre un exemple, pour illustrer ce que cela implique. Le développement de l’agroalimentaire en Bretagne s’est opéré sur des bases hors-sol ; l’alimentation de ces cochons doit bien être produite quelque part. En l’espèce : dans les pays du Sud. La plupart du temps, il s’agit de soja. Lequel est justement emblématique de la destruction des cultures vivrières : au lieu de cultiver ce dont ils ont besoin pour vivre, les paysans de Sud produisent ce dont le Nord a besoin pour nourrir ses élevages. Les ressources du Sud sont ainsi directement utilisées pour produire plus que nécessaire au Nord. Avec ce modèle, on menace directement la souveraineté alimentaire de certains pays, alors que les pays développés s’enferrent dans une dépendance dangereuse pour les producteurs, les hommes et l’environnement.
Il y a un autre problème, lié à l’alimentation : qui dit animaux dit (logiquement) déjections. Le nombre de cochons est beaucoup trop important en France, le volume de leurs déjections aussi. Elles saturent les sols, notamment en nitrate, sont emportées par l’eau et l’érosion, et finissent dans la mer et dans nos rivières. D’où le problème – par exemple – des algues vertes en Bretagne6. En amont comme en aval, on détruit ainsi un certain équilibre : c’est inacceptable. On ne peut pas accepter de continuer à crever ici d’avoir trop à bouffer tandis que d’autres crèvent de ne plus avoir à manger, tout ça pour qu’on nourrisse le bétail en détruisant au passage notre environnement et le leur.
« On ne peut pas accepter de continuer à crever ici d’avoir trop à bouffer tandis que d’autres crèvent de ne plus avoir à manger, tout ça pour qu’on nourrisse le bétail en détruisant au passage notre environnement et le leur. »
Nous devons changer notre façon de produire, mais aussi de consommer ; ne serait-ce que parce que 70 % des terres agricoles dans le monde sont utilisées directement ou indirectement pour fournir l’alimentation du bétail. La consommation de viande est non seulement mauvaise pour notre santé, mais aussi pour l’environnement : il faut entre sept et dix fois plus de terres pour produire une alimentation à base de produits carnés qu’à base de végétaux. Nous ne pourrons jamais nourrir toute la planète si chacun adopte le régime alimentaire des pays développés ; pour y parvenir, il faudrait que ces derniers réduisent leur consommation de viande et qu’elle soit produite différemment. J’ai dit « réduire », et non « stopper » : dans une ferme, les animaux sont essentiels pour alimenter le sol en compost et en matières organiques.
Il faut aussi réinstaller des paysans dans les pays riches, et recréer du travail dans le monde rural. Cela implique de changer l’alimentation, les modes de production, de prendre en compte des questions politiques et d’occupation des terres dans l’aménagement du territoire, de se pencher sur la restauration collective (qui devrait utiliser des produits locaux), sur la protection de l’eau... Économiquement, c’est très clair qu’on y gagnerait. Pour prendre notre eemple : en produisant trois fois moins que des exploitations conventionnelles, on a créé quatre fois plus d’emplois. Cinquante truies nous permettent de faire vivre huit personnes : c’est inimaginable pour qui se place dans une optique productiviste7.
Justement : quelle est la situation de la filière porcine « conventionnelle » ?
Cette production cumule aujourd’hui les handicaps. D’une part, elle n’est pas protégée par la PAC – à la différence des filières laitières ou céréalières, qui bénéficient de prix garantis. D’autre part, elle est très dépendante du marché des céréales ; or, le prix de ces dernières a encore flambé cette année. Pour aggraver le tout, les éleveurs de porcs « conventionnels » sont dans une situation de surproduction structurelle, avec des prix de vente beaucoup trop bas, complètement déconnectés des coûts de production. Ils vont droit dans le mur.
Pour éviter cela, il faudrait réajuster l’offre et la demande. Cesser de produire en excès. Rééquilibrer les productions sur le territoire. Changer l’attribution des aides, pour qu’elles aillent aux hommes et non à des produits ou à des volumes de production. Tout cela permettrait de garantir un revenu minimum au paysan, afin qu’il cesse de se préoccuper constamment du lendemain. Garantir un revenu, c’est aussi rémunérer un paysan pour ce qu’il fait de non-palpable : l’entretien des paysages, les produits de qualité, l’occupation du territoire...
Il faut enfin que le citoyen se réapproprie certaines questions politiques. Pour qu’on trouve le courage et la volonté de réellement réformer cette politique agricole qui ne ressemble plus à rien. D’aller à l’encontre des normes de l’OMC et de certaines règles internationales. Si on veut changer l’orientation de l’agriculture, il faut changer le cadre, le socle politique sur laquelle elle est basée ; ça, les agriculteurs ne pourront pas le faire seuls.
« Il faut entre sept et dix fois plus de terres pour produire une alimentation à base de produits carnés qu’à base de végétaux. »
Cela nous concerne tous ?
Évidemment. Quand le consommateur ne se soucie que du coût réel, à « court terme », il privilégie les produits issus de l’agriculture industrielle, et non ceux de l’agriculture familiale, paysanne et biologique. Logique : les premiers semblent moins chers. Sauf que... Ces prix de vente ne tiennent pas compte du coût astronomique de l’agriculture industrielle, nos impôts étant largement utilisés pour traiter ses effets négatifs. Il s’agit du coût de la dépollution de l’eau, de celui du changement climatique et de l’effet de serre liés à ces modes de production, du coût du chômage induit par la destruction de la petite paysannerie et des économies rurales, du coût de l’augmentation des cancers au sein d’une population consommant sans cesse des produits gavés de pesticides et d’antibiotiques... Ou encore du coût des catastrophes naturelles. Les inondations, par exemple, sont en grande partie liées à la disparition des talus et des haies, ainsi qu’au bétonnage de nos campagnes.
Ces coûts-là ne sont jamais pris en compte dans les prix, puisqu’ils sont supportés par l’ensemble de la société. Ce devrait pourtant être le cas, puisqu’ils sont directement liés au modèle de production agricole industriel. Une fois intégrés à l’addition, ils représenteraient des sommes faramineuses. Bien plus importantes que le prix à la vente d’une alimentation produite dans des conditions correctes.
C’est d’ailleurs pour ça que le mot « paysan » correspond pleinement à ma manière de voir ce métier, en englobant le plus de paramètres possibles : l’occupation du territoire, la production d’une alimentation de qualité, le respect des hommes qui travaillent, la prise en compte des autres populations de la planète... C’est une identité qui doit impliquer un revenu suffisant : il faut pérenniser ce qu’on défend. C’est à ce niveau que les paysans doivent se réapproprier leur métier et leurs décisions.
Pour en arriver là, il va falloir passer par plusieurs prises de conscience. Celle des citoyens, d’abord : ils doivent comprendre que l’usage de leur porte-monnaie détermine des choix de société. Celle des paysans, évidemment : pratiquer une autre agriculture, cela signifie favoriser l’installation de nouveaux venus, devenir plus autonomes et se répartir les moyens de production – les animaux, les terres et ce qui tourne autour. Et celle des politiques, enfin : il faut attribuer différemment l’argent public, en privilégiant une agriculture de qualité. Beaucoup d’expériences isolées montrent que cela fonctionne et qu’on pourrait généraliser un tel modèle. Il suffit de le vouloir.
1 Dans ce mode de production intensif, les animaux sont élevés dans des bâtiments où toutes les fonctions sont automatisées.
2 Le lisier est un mélange de déjections d’animaux d’élevage (urines, excrément) et d’eau.
3 Le Groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) est la réunion, sous forme sociétaire, de plusieurs exploitations agricoles.
4 Il s’agit d’une structure en béton, avec des lattes au travers desquelles passent les déjections, ensuite déversées dans une fosse.
5 Le prix de vente en carcasse du cochon de Michel Piel est d’environ 3,20 € du kilo, pour un coût de production de 2,80 €. Puisqu’il écoule son cochon en vente directe, il n’a pas à reverser de quote-part à des intermédiaires et à la grande distribution (20 à 25 % du prix de vente final du produit).
6 Proliférant en Bretagne et nocives pour l’environnement, les algues vertes sont notamment conséquences de l’épandage de lisier.
7 Un autre producteur de la région, rencontré à la même époque, confiait ne pas s’en sortir avec 120 truies ; il était seul à travailler sur l’exploitation, mais s’inscrivait dans une optique industrielle.