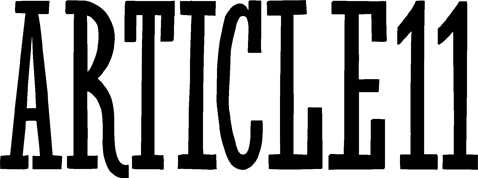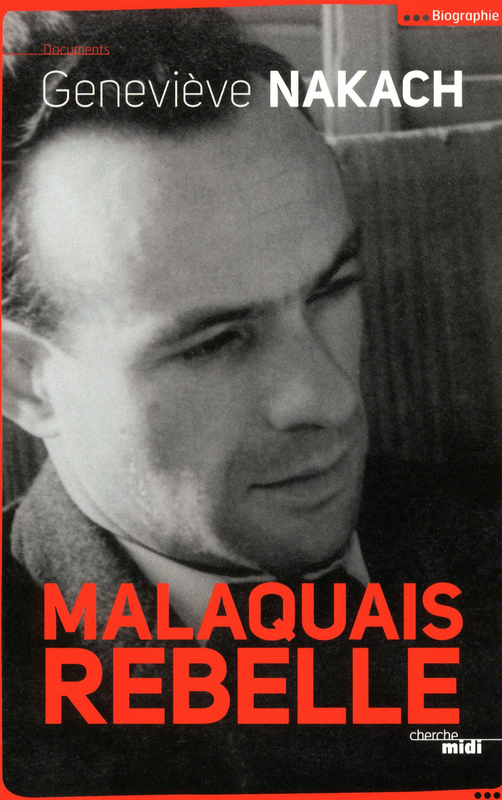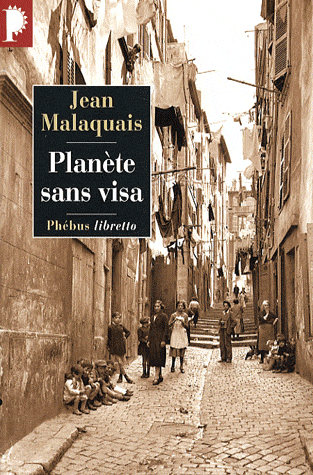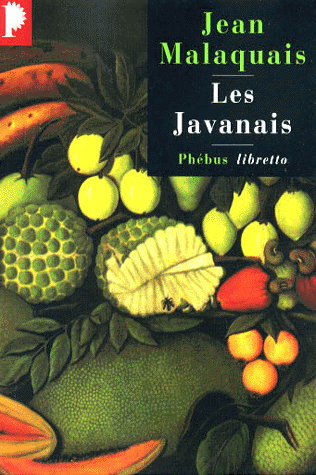lundi 22 décembre 2014
Littérature
posté à 17h35, par
10 commentaires
C’est un auteur méconnu. Trop méconnu. Jean Malaquais a beau avoir écrit deux romans considérés comme des classiques (Les Javanais et Planète sans visa), avoir traduit Norman Mailer et s’être vu adouber par de prestigieux pairs, il s’est éteint en 1998 dans une relative indifférence. Un tort que la biographie de Geneviève Nakach, Malaquais rebelle, tente de réparer. Compte-rendu.
J’ai terminé tout à l’heure la biographie de Geneviève Nakach, Malaquais rebelle1. Avec une larme versée sur les dernières lignes. Un bonheur de lecture, un bonheur de rencontre s’arrachaient à moi, et en même temps que je parcourais les dernières lignes, le bonhomme fermait le guichet un hiver de 1998.
Cet hiver-là, j’étais à Paris et tout ce qui m’importait avait un prénom de fille. Avant de me rendre au café où nous avions rendez-vous, j’avais frôlé, en même temps que la mort d’un vif espoir amoureux, des milliers de badauds qui baguenaudaient, de quidams pressés et affairés. Je leur avais retourné la même indifférence grise dans la brume qui émanait des profondeurs de la Seine et qui tombait sur le fourmillement nocturne du quartier Saint Paul. J’étais accaparé par son sourire, l’horizon déchu de toutes mes convoitises. « Je ne t’aime pas », me dit-elle en prélude à notre soirée. Ce n’était pas une surprise. La persistance de mon sentiment réclamait une mise au point. Elle la fit. Mais ces mots, même avec ce large sourire qui irradiait son beau visage et dont elle ne s’était pas départi tout au long de notre conversation, ces mots m’avaient mis knock-out. J’étais sonné quand j’ai regagné mon appartement de la rue Broca. Sonné et seul, je tranchais la nuit d’un pas mélancolique. Arrivé à hauteur de Jussieu, les chants pleins de ferveurs d’une procession de catholiques m’ont arraché à ma prostration chaloupée. Je marchais désormais, avec une absolue certitude, sur le pas cadencé de la mort.
Dans le même temps, à Genève, un immense bonhomme rendait son dernier souffle et j’avais ce grand tort, à l’âge qui était le mien (30 ans), d’être tout uniment absorbé par une fille et de n’attacher à la grande littérature que la vertu réparatrice des torts considérables que me causaient mon agitation hormonale. Depuis, l’agitation est moindre. Reste ce constat : à 30 ans j’ai manqué Malaquais pour des prénoms de filles. Cette biographie a en partie réparé mon tort.
Hier, j’ai terminé le livre qui lui était consacré. J’ai serré l’ouvrage entre mes deux mains, comme on donne l’accolade et je ne sais au juste à qui de Malaquais ou de sa biographe s’adressait ce geste d’admiration cordiale. Aux deux il me semble, car pour tirer le portrait de Jean Malaquais, d’un homme et écrivain de cette trempe, il fallait un biographe à la mesure, non seulement du talent, mais aussi de la personnalité impétueuse, tonitruante et incorruptible du sujet.
Pour dire mes rares frustrations concernant ce remarquable travail, il y a l’absence de photographies. J’aurais également aimé en savoir (plus) sur son séjour sur le front espagnol, mais j’ai admis que Geneviève Nakach manquait simplement de matière.
Pour le reste, cette biographie m’a comblé. Les épisodes de la vie de Jean Malaquais sont exposés avec une grande clarté, avec netteté et précision quand la matière ne fait pas défaut à la biographe. C’est que Malaquais était d’un caractère taiseux, discret sur le chapitre de sa vie intime. Malgré cela, le confort évident de lecture tient à la qualité d’écriture de la biographe. C’est clair parce que l’écriture est limpide, c’est précis, ça tient en haleine, c’est passionnant, parce que la limpidité n’exclut pas de belles envolées, de beaux développements et parce que le souci de neutralité et de véracité du biographe autorisent quelques interprétations, quelques hypothèses dans un bon dosage entre le fait et la réflexion interprétative. Les conjectures, auxquelles se livre la biographie, viennent précisément, au moment idoine, enrichir l’exposé factuel, sur des questions qu’il est souvent de première nécessité de traiter. Je pense notamment à la question cruciale dans la vie de cet homme : pourquoi ce silence de Malaquais à compter de 1953 ? Geneviève Nakach y répond sur plusieurs pages passionnantes. Elle s’appuie sur des faits, sur la sensibilité et sur le caractère de Malaquais, sur l’histoire intime d’un homme et d’un écrivain chahuté par les chambardements et les tragédies de la grande histoire. Elle sollicite sa propre sensibilité, à la littérature, particulièrement à la littérature de Malaquais ; cette sensibilité, la sienne, est assez grande, pour qu’elle rende, avec une parfaite maîtrise, la singulière complexité d’une vie en regard de l’extrême fragilité du processus créatif. Geneviève Nakach n’exclut, d’ailleurs pas, dans la « démoralisation », dont Malaquais lui-même fit part à Jacques Chancel, qu’elle ait pu avoir maille à partir, dans la souffrance avec la raison. C’était aller aussi loin que possible et c’était une question incontournable, dans la vie d’un écrivain qui au cours de longues et d’interminables journées qui ont fini par se compter en années, déchiquetait, tous les soirs, les pages qu’il avait péniblement noircies tout le jour. C’est d’ailleurs en 1964 qu’il fit cette lettre qui figure en toute fin d’ouvrage. On y décèle le poids d’une culpabilité qui dans toutes ses composantes, affectives, historiques, littéraires, politiques, aurait bien pu paralyser la créativité d’un homme.
C’était le parti-pris de Geneviève Nakach d’insister un peu plus sur la littérature, un peu moins sur le versant politique du personnage. « Il faut s’en tenir à ce que l’on sait et ne pas se laisser entraîner dans une poursuite sans fin, disait Lao-Tseu. La seule connaissance valable est globale, intuitive. »
Jean Malaquais est mort, à 90 ans, comme il est né dans le ventre de sa mère, en rebelle. Il a eu un succès d’estime, critique plutôt que populaire. Ses amis, ses admirateurs se comptaient plutôt parmi les grandes personnalités politiques et littéraires du siècle. Il eut ainsi d’indéfectibles amitiés avec Norman Mailer, Maximilien Rubel, Marc Chirik, André Gide. Il en eut aussi de passagères avec l’immense Victor Serge, Edmund Wilson, Paul Mattick2, etc. Car c’était le siècle foisonnant de l’internationalisme, des révolutions, un siècle d’idées, d’espoirs, d’alphabétisme, d’armes aux poings, un siècle qui n’était pas encore vidé de son humanité. C’était une époque où un jeune juif de Varsovie (Malacki/Malaquais) qui avait entrepris de courir le monde « avant qu’il ne disparaisse » s’échouait de longues heures à la bibliothèque Sainte Geneviève après avoir foulé le sol de Roumanie, de Turquie, Tombouctou, l’Espagne où il avait fait le trimard, le débardeur, le mécano, le mineur etc...
À la bibliothèque, il venait s’y chauffer et lire, après une journée harassante à déballer aux Halles des cageots de poulets qui lui chiaient sur la tête. Il tomba un jour sur un article de Gide qui évoquait de façon consternante son « infériorité » parce qu’il n’avait jamais été pauvre et qu’il le regrettait. Avec le toupet et la véhémence d’un caractère déjà trempé, Malaquais, l’apatride, le dépossédé, l’indésirable fit, une lettre ardente au grand Gide, l’écrivain planétaire. C’était un siècle où Gide au faîte de sa gloire admit de bonne grâce d’être mouché par un blanc-bec à la plume déjà bouillante, une époque où une sommité littéraire recevait cet inconnu, l’encourageait à écrire, s’en faisait un ami, subvenait à ses besoins, lui sauvant la mise à deux reprises, l’arrachant une première fois à la pauvreté, une seconde fois aux nazis. C’était une époque où cette improbable rencontre donnait une amitié de toute une vie et ouvrait grand les portes de la littérature à un jeune apatride impétueux qui se révélerait un écrivain incomparable. Une époque où le coup d’essai du blanc bec fut un coup de maître. Premier roman et premier prix littéraire, le Renaudot, qui lui fut décerné pour Les javanais3 alors qu’il était sur le front, avec des hommes de sa condition. C’était un temps où certaines figures politiques internationales rendaient justice aux arts, et ne manquaient pas de considérations pour un parfait inconnu, Malaquais en l’occurrence, qui adressa à Trotski son roman à peine édité. C’était une époque où un révolutionnaire de renommée mondiale fit non seulement une réponse mais aussi un article élogieux de 11 pages au texte d’un lumpen anonyme. « Il est bon que sur terre il y ait non seulement la politique, mais aussi l’art. Il est bon que l’art soit inépuisable dans ses virtualités, comme la vie elle-même. Dans un certain sens, l’art est plus riche que la vie, car il peut agrandir ou réduire, peindre de couleurs vives, ou au contraire, se limiter au fusain, il peut présenter un seul et même objet de différents côtés et l’éclairer de manière variable » écrit Trotski dans un texte de 1939 qu’il intitule « UN NOUVEAU GRAND ÉCRIVAIN : JEAN MALAQUAIS. »
*
Parmi les nombreux essais, les nouvelles, les journaux, les romans et les correspondances de Jean Malaquais, s’impose toujours cette impérieuse exigence de l’auteur et du révolutionnaire de ne jamais « écrire sur rien » . Il le coucha lui-même sur (le) papier, alors que la guerre faisait rage et qu’il était occupé à sauver sa peau de juif : « Dieu de la littérature, épargnez-moi de donner dans la putasserie des littérateurs » (Journal de guerre/Journal d’un métèque).
Rien ne fut pourtant épargné à Jean Malaquais, ni la plus calamiteuse exploitation de l’homme par l’homme, ni le statut d’apatride, ni la conscription, ni la chasse aux juifs, et cependant il ne cessait pas de tenir en haute estime la littérature et il avait le souci constant d’en produire une à la mesure de son caractère, puissante. Cette discipline rigoureuse, trempée dans le perfectionnisme, a donné entre 1938 et 1953 une œuvre d’une grande intensité qui ne pouvait pas échapper aux révolutionnaires de la génération suivante. C’est ce dont témoigne Raoul Vaneigem dans quelques lignes qu’il a eu l’amabilité de me remettre à l’époque où je cherchais des informations en vue de les remettre à la Société Jean Malaquais :
« Alors que je participais en mai 1968 à l’occupation de l’Institut Pédagogique National (IPN) avec les amis du CMDO (Comité pour le maintien des occupations), j’ai accueilli, parmi les camarades qui venaient nous témoigner leur soutien un homme à l’allure assez timide qui s’est présenté :
× Vous ne me connaissez pas mais je tenais à vous féliciter de ce que vous faites... Je m’appelle Jean Malaquais.
À quoi j’ai répondu :
× Détrompez-vous. Je vous connais et je vous apprécie. J’ai lu Le nommé Louis Aragon ou le patriote professionnel.Debord et les amis ont manifesté le même enthousiasme. À l’époque, je n’avais pas lu Les javanais, Planète sans visas ni ses autres livres, mais Malaquais n’en jouissait pas moins de cette sympathie que l’on accorde spontanément à ceux dont on sait - sans avoir besoin d’une enquête - qu’ils sont de la « même barricade. »
Je ne me souviens guère de quoi nous avons discuté mais la chaleur de l’accueil l’a manifestement ému. Des promesses de se revoir ont dû être échangées. Le tumulte des événements les a toujours postposées. Ce qui subsiste en moi est le souvenir d’un homme qui n’a jamais cessé de combattre seul, avec une résolution inébranlable, contre un monde inhumain. Cette profonde humanité qui émanait de lui, si brève que fût notre rencontre, j’ai la faiblesse de penser qu’elle constitue une arme indestructible contre la barbarie dont les hordes nous assaillent de toutes parts.
Excusez la modestie de ma contribution à l’hommage que les luttes autogestionnaires à venir ne manqueront pas de rendre à ceux que la solitude et le désespoir n’ont jamais convaincu de prendre, contre la vie, ce parti de la mort que propage le totalitarisme du profit et qui, hélas, gangrène souvent le camp adverse. »