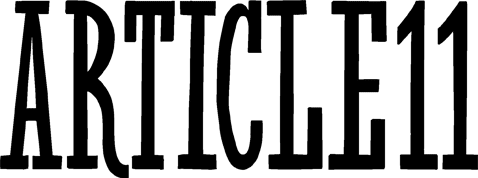mercredi 11 septembre 2013
Inactualités
posté à 16h15, par
3 commentaires
Partout, des communautés humaines – réunissant gens du cru et d’ailleurs – s’insurgent contre l’exploitation capitaliste du temps et de l’espace. La résistance aux aménageurs libère d’autres possibles pour la planète. Après « Il n’y a pas de luttes locales » (dans le n°11 d’A11) et « Richesse des possibles dans les luttes de territoire » (n°12), voici l’ultime volet d’une réflexion en trois parties.
Ce texte a été publié dans le numéro 13 de la version papier d’Article11, imprimé en juillet 2013. C’est l’ultime opus d’une série en trois parties, intitulée « Une Zone à Défendre : La planète ». L’épisode 1, « Il n’y a pas de luttes locales », a été mis en ligne lundi (à lire ICI) et l’épisode 2, « Richesse des possibles dans les luttes de territoire » (à lire ICI), hier.
*
Le 2 août 2012, à la tête d’un groupe de manifestants, un triporteur équipé d’un puissant mégaphone fait irruption piazza della Vittoria à Tarente1. Le cortège interrompt l’habituelle grand-messe funéraire de travailleurs défendant leur usine condamnée à la fermeture. Et il contraint à la fuite les secrétaires nationaux des trois principales confédérations syndicales. L’usine en question doit fermer sur ordre de la magistrature. Il s’agit de l’Ilva (ex-Italsider), la plus grosse aciérie d’Italie. Dans cette région des Pouilles, où le chômage touche 50 % de la population active, elle représente, directement ou indirectement, plus de 21 000 emplois. Point crucial : ses émanations sont responsables de la mort par cancer d’au moins 283 personnes en treize ans.
Contre l’union sacrée des syndicats, des partis de gauche et de la famille Riva propriétaire de l’usine (qui a affrété des cars pour certaines manifestations), le triporteur (Apecar Piaggio) est devenu le symbole d’un mouvement rassemblant des travailleurs de l’usine et des habitants de la région. Tous unis autour du mot d’ordre : « Nous ne voulons pas échanger notre droit au travail contre le droit de respirer. » Ces militants se sont réunis au sein du « Comité des citoyens et travailleurs libres et pensants », lequel exige que l’usine soit fermée tant qu’elle est dangereuse et que les ouvriers soient payés durant l’intervalle. D’une trentaine de personnes, dont quelques anciens des luttes des années 1970, le comité, de manifs en manifs (et malgré les interdictions frappant la tenue de celles-ci), a fini par rassembler deux bons milliers de personnes et par pouvoir compter sur le soutien d’environ un millier d’ouvriers (10 % des effectifs de l’usine).
On ne s’étonnera pas que ce combat ait éveillé nombre de sympathies dans la vallée de Suse, où les militants No-Tav sont confrontés à des employés de coopératives de la post-gauche qui creusent une montagne bourrée d’amiante et d’uranium en invoquant la nécessité de travailler. Mais il faut remonter bien loin en arrière pour trouver de semblables cas d’ouvriers menacés de fermeture ne se cramponnant pas purement et simplement à la défense de l’emploi, mais intégrant dans leur lutte des exigences qui sortent du cadre strict de l’usine. L’héritage des luttes des années 1970 n’est sans doute pas étranger à ce phénomène : à l’époque, les assemblées d’usine intervenaient sur tout le territoire, dans les questions de logement, de pollution, de coût de la vie2...
Le combat de 2012, lui, ne se caractérise pas par la centralité ouvrière : le mouvement de l’Apecar s’est imposé et développé non pas dans l’usine, même s’il est intervenu à ses portes, mais sur les places de la ville. Certes, la participation d’ouvriers s’est révélée décisive pour contrer l’unanimité productiviste syndicat-patronat. Mais c’est la présence en son sein d’habitants de la ville de tous milieux sociaux (avec une forte présence populaire) qui a permis de faire sentir, au moins en Italie, qu’une nouvelle manière de poser la question de la production se dessinait. Que produire ? Pour quoi faire ? À quel prix humain ? Ces questions, malgré l’involution actuelle3, ont commencé à être formulées jusqu’à pénétrer dans la vie de milliers de gens, qui ne sont pas prêts de les oublier. Espérons que se tissent de telles alliances ailleurs en Europe, mais aussi dans des pays comme la Chine, le Bangladesh ou le Brésil, où la surexploitation s’allie à la pollution.
Ainsi retrouve-t-on à Tarente l’un des traits essentiels des luttes de territoire, cette communauté rassemblant de multiples composantes en termes d’âge, de culture, de fonction dans la production, et que sa lutte même ancre dans des questions à la fois concrètes et universelles. Une communauté de gens « libres et pensants » qui se cherchent une langue et un imaginaire (le triporteur comme symbole du faible qui enfonce les défenses du fort) en rupture avec les langues de bois et les imaginaires trop idéologiques des luttes précédentes. Ce qui n’empêche pas d’en reprendre les rêves, et leur charge offensive : l’exigence d’être payé même si l’usine ne fonctionne plus apparaît comme l’un des nouveaux visages du revenu détaché de l’activité, revendication née dans les fabriques italiennes des années 1970.
Indignados espagnols, Occupy étasunien, printemps « érable », étudiants chiliens et britanniques, émeutiers turcs et brésiliens : face aux différents mouvements qui essaiment depuis le magnifique coup d’envoi des insurrections arabes, certains adoptent une posture hypercritique4. Cette dernière s’appuie sur une forme de marxisme fossilisé, qui continue à placer le salut final de l’humanité dans les mains d’une catégorie socio-économique : la « classe ouvrière ».
Or, s’il est une leçon à tirer des luttes ouvrières du siècle dernier, y compris sous leurs formes les plus radicales, c’est que la « classe qui abolit toutes les classes » ne saurait être définie en termes socio-économiques. Le projet ouvrier de s’émanciper en tant qu’ouvrier (et donc en le restant) aura été sa force et sa limite : jamais, même dans ses formes les plus autonomes, il n’a posé la question du dépassement de la condition ouvrière, de la division du travail, de la nature des richesses méritant d’être produites. La restructuration mondiale, la segmentation de la production, l’importance prise par la sphère de la circulation dans le processus de valorisation ou l’essor du general intellect mettent désormais en lumière une faiblesse présente dès le début dans le marxisme vulgaire : l’idée fausse qu’une position particulière dans la production donnerait à ceux qui l’occupent – et à eux seuls – le pouvoir de défendre les intérêts de l’humanité, simplement en défendant leurs propres intérêts.
Aujourd’hui, ceux à qui on a fait, pour reprendre la formule de Marx, non pas « un tort particulier » mais « un tort général », ne sont pas forcément exécutants salariés dans la production matérielle. Selon la place qu’ils occupent dans la production, ils peuvent apporter telle richesse culturelle ou telles capacités aux processus de lutte. Mais ce qui compte, à la fin, si l’on doit définir un sujet capable de transformer le monde, c’est d’abord la constitution dans la pratique d’une communauté de subjectivités sociales très diverses, dont la manière d’être ensemble se situe déjà hors des logiques dominantes. Ce qui compte ensuite, ce sont les processus auxquels cette communauté s’oppose, ceux du capitalisme tardif, dans sa fuite en avant vers le néant : la marchandisation du vivant, le développement exponentiel de la technoscience, la destruction des territoires… En défendant les arbres de Gezi Park ou la qualité de l’air de Tarente, des Stambouliotes et des Tarentais s’opposent aux mêmes logiques. Dans une société devenue de part en part usine à produire de la valeur, les forces sociales qui changeront la face du monde ne se se définissent pas aujourd’hui par leur place dans la production, mais par leur capacité à construire du commun contre un ennemi commun.
*
NDLR : Cet article est illustré en page d’accueil par un détail d’une peinture de Marcel Dzama, peintre canadien contemporain.
1 On peut visionner la scène ici .
2 Ainsi que le notent les amis ouvriéristes de Mouvement Communiste dans le numéro 37 de la revue du même nom. Leur récit synthétique de l’affaire tarentaise m’a fourni des précisions bienvenues.
3 Une partie du mouvement a milité pour un référendum envisageant la fermeture de l’Ilva. Il a finalement eu lieu, mais a fait un flop : moins de 20 % de votants, quorum non atteint. La magistrature étant revenue sur sa décision d’interdiction, l’usine fonctionne toujours plus ou moins.
4 Voir par exemple « Occuper Wall Street, un mouvement tombé amoureux de lui-même », article de Thomas Frank publié par Le Monde diplomatique en janvier 2013.